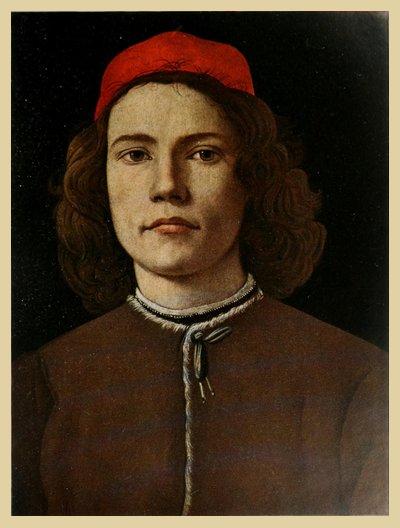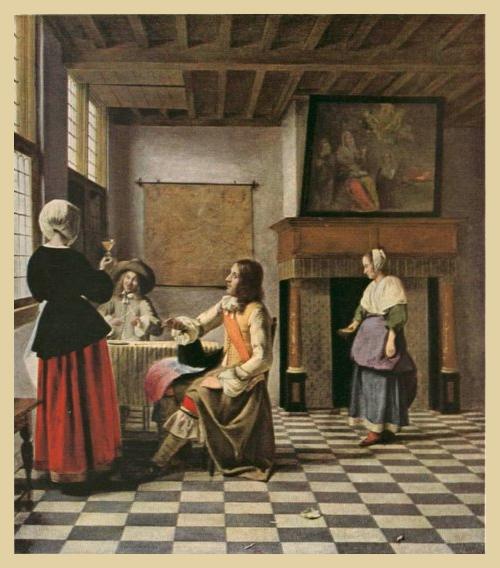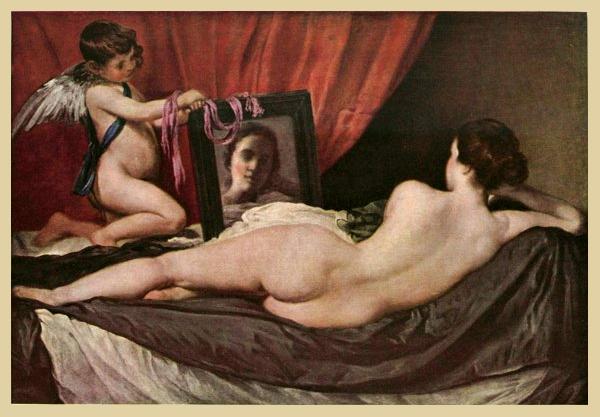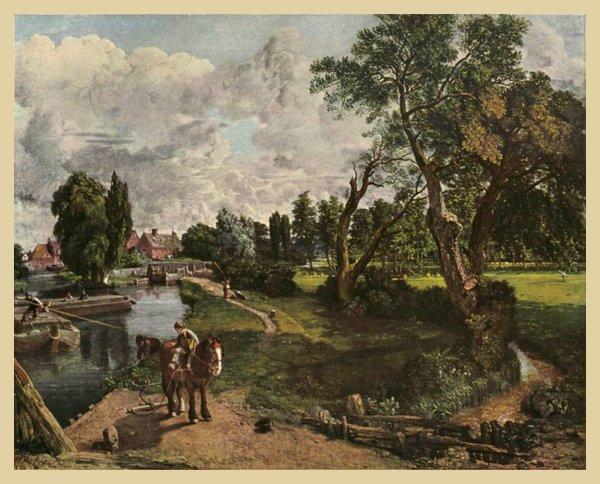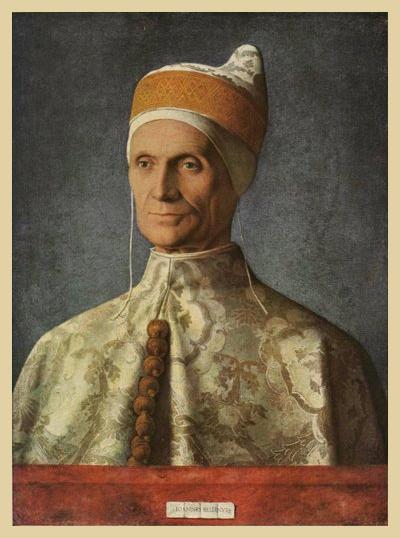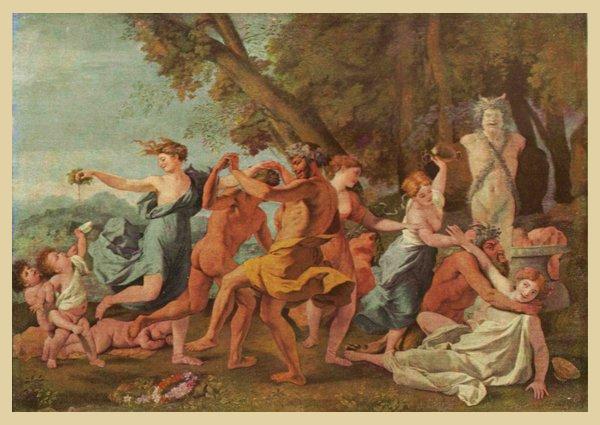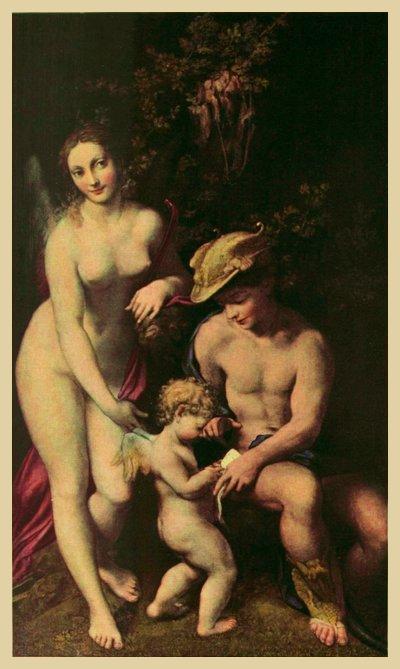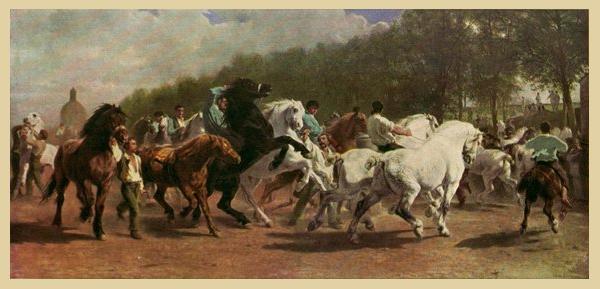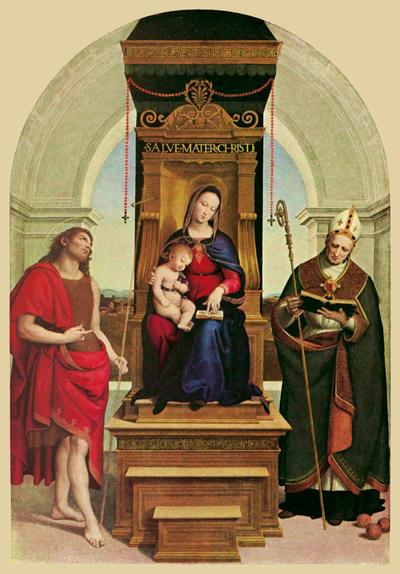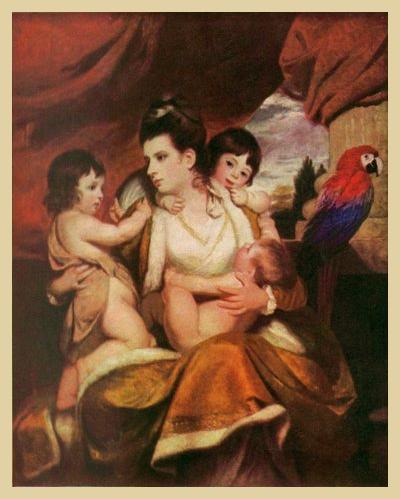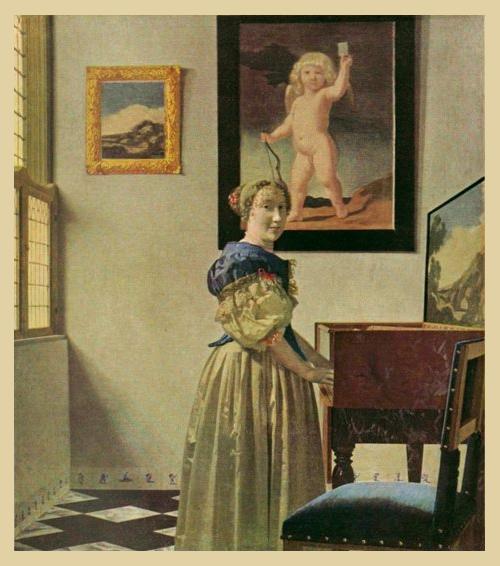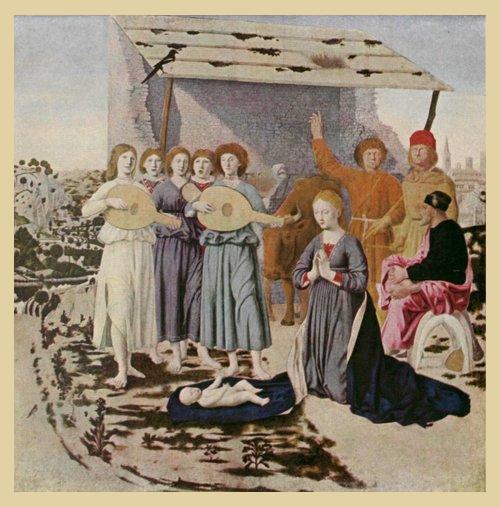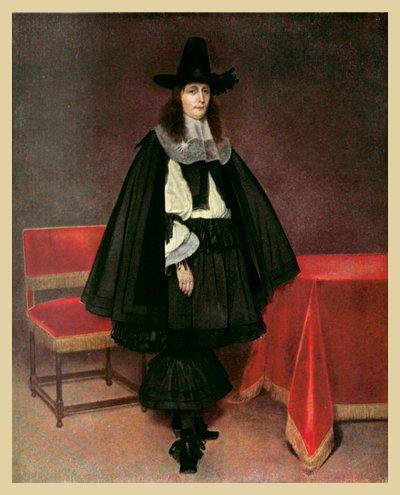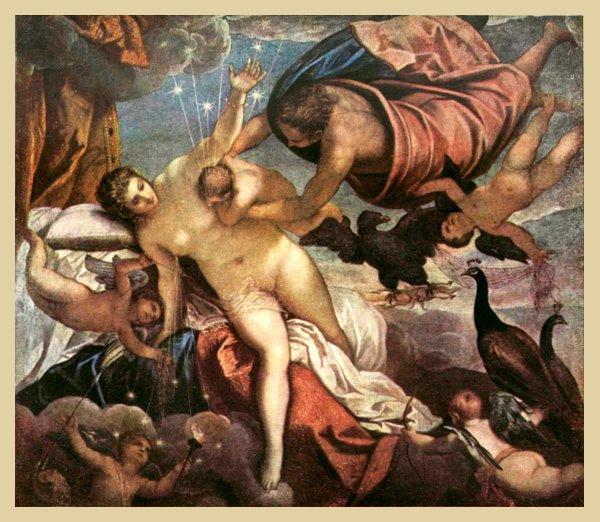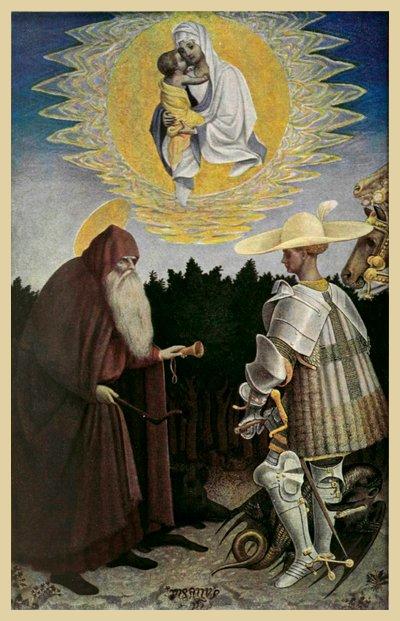10 sept. 2020
9 sept. 2020
1 + 2 + 3 + ⋯ + ∞ = -1/12?
The Ramanujan Summation:
1 + 2 + 3 + ⋯ + ∞ = -1/12?
Mark Dodds
“What on earth are you talking about? There’s no way that’s true!” — My mom
This
is what my mom said to me when I told her about this little
mathematical anomaly. And it is just that, an anomaly. After all, it
defies basic logic. How could adding positive numbers equal not only a
negative, but a negative fraction? What the frac?
Before
I begin: It has been pointed out to me that when I talk about sum’s in
this article, it is not in the traditional sense of the word. This is
because all the series I deal with naturally do not tend to a specific
number, so we talk about a different type of sums, namely Cesàro
Summations. For anyone interested in the mathematics, Cesàro summations
assign values to some infinite sums that do not converge in the usual
sense. “The Cesàro sum is defined as the limit, as n tends to infinity,
of the sequence of arithmetic means of the first n partial sums of the
series” — Wikipedia. I also want to say that throughout this article I
deal with the concept of countable infinity, a different type of
infinity that deals with a infinite set of numbers, but one where if
given enough time you could count to any number in the set. It allows me
to use some of the regular properties of mathematics like commutativity
in my equations (which is an axiom I use throughout the article).
Srinivasa Ramanujan (1887–1920) was an Indian mathematician
For
those of you who are unfamiliar with this series, which has come to be
known as the Ramanujan Summation after a famous Indian mathematician
named Srinivasa Ramanujan, it states that if you add all the natural
numbers, that is 1, 2, 3, 4, and so on, all the way to infinity, you
will find that it is equal to -1/12. Yup, -0.08333333333.
Don’t believe me? Keep reading to find out how I prove this, by proving two equally crazy claims:
1. 1–1+1–1+1–1 ⋯ = 1/2
2. 1–2+3–4+5–6⋯ = 1/4
First
off, the bread and butter. This is where the real magic happens, in
fact the other two proofs aren’t possible without this.
I start with a series, A, which is equal to 1–1+1–1+1–1 repeated an infinite number of times. I’ll write it as such:
A = 1–1+1–1+1–1⋯
Then I do a neat little trick. I take away A from 1
1-A=1-(1–1+1–1+1–1⋯)
So
far so good? Now here is where the wizardry happens. If I simplify the
right side of the equation, I get something very peculiar:
1-A=1–1+1–1+1–1+1⋯
Look
familiar? In case you missed it, thats A. Yes, there on that right side
of the equation, is the series we started off with. So I can substitute
A for that right side, do a bit of high school algebra and boom!
1-A =A
1-A+A=A+A
1 = 2A
1/2 = A
This
little beauty is Grandi’s series, called such after the Italian
mathematician, philosopher, and priest Guido Grandi. That’s really
everything this series has, and while it is my personal favourite, there
isn’t a cool history or discovery story behind this. However, it does
open the door to proving a lot of interesting things, including a very
important equation for quantum mechanics and even string theory. But
more on that later. For now, we move onto proving #2: 1–2+3–4+5–6⋯ =
1/4.
We
start the same way as above, letting the series B =1–2+3–4+5–6⋯. Then
we can start to play around with it. This time, instead of subtracting B
from 1, we are going to subtract it from A. Mathematically, we get
this:
A-B = (1–1+1–1+1–1⋯) — (1–2+3–4+5–6⋯)
A-B = (1–1+1–1+1–1⋯) — 1+2–3+4–5+6⋯
Then we shuffle the terms around a little bit, and we see another interesting pattern emerge.
A-B = (1–1) + (–1+2) +(1–3) + (–1+4) + (1–5) + (–1+6)⋯
A-B = 0+1–2+3–4+5⋯
Once
again, we get the series we started off with, and from before, we know
that A = 1/2, so we use some more basic algebra and prove our second
mind blowing fact of today.
A-B = B
A = 2B
1/2 = 2B
1/4 = B
And
voila! This equation does not have a fancy name, since it has proven by
many mathematicians over the years while simultaneously being labeled a
paradoxical equation. Nevertheless, it sparked a debate amongst
academics at the time, and even helped extend Euler’s research in the
Basel Problem and lead towards important mathematical functions like the
Reimann Zeta function.
Now
for the icing on the cake, the one you’ve been waiting for, the big
cheese. Once again we start by letting the series C = 1+2+3+4+5+6⋯, and
you may have been able to guess it, we are going to subtract C from B.
B-C = (1–2+3–4+5–6⋯)-(1+2+3+4+5+6⋯)
Because
math is still awesome, we are going to rearrange the order of some of
the numbers in here so we get something that looks familiar, but
probably wont be what you are suspecting.
B-C = (1-2+3-4+5-6⋯)-1-2-3-4-5-6⋯
B-C = (1-1) + (-2-2) + (3-3) + (-4-4) + (5-5) + (-6-6) ⋯
B-C = 0-4+0-8+0-12⋯
B-C = -4-8-12⋯
Not
what you were expecting right? Well hold on to your socks, because I
have one last trick up my sleeve that is going to make it all worth it.
If you notice, all the terms on the right side are multiples of -4, so
we can pull out that constant factor, and lo n’ behold, we get what we
started with.
B-C = -4(1+2+3)⋯
B-C = -4C
B = -3C
And since we have a value for B=1/4, we simply put that value in and we get our magical result:
1/4 = -3C
1/-12 = C or C = -1/12
Now,
why this is important. Well for starters, it is used in string theory.
Not the Stephen Hawking version unfortunately, but actually in the
original version of string theory (called Bosonic String Theory). Now
unfortunately Bosonic string theory has been somewhat outmoded by the
current area of interest, called supersymmetric string theory, but the
original theory still has its uses in understanding superstrings, which
are integral parts of the aforementioned updated string theory.
The
Ramanujan Summation also has had a big impact in the area of general
physics, specifically in the solution to the phenomenon know as the
Casimir Effect. Hendrik Casimir predicted that given two uncharged
conductive plates placed in a vacuum, there exists an attractive force
between these plates due to the presence of virtual particles bread by
quantum fluctuations. In Casimir’s solution, he uses the very sum we
just proved to model the amount of energy between the plates. And there
is the reason why this value is so important.
So
there you have it, the Ramanujan summation, that was discovered in the
early 1900’s, which is still making an impact almost 100 years on in
many different branches of physics, and can still win a bet against
people who are none the wiser.
P.S.
If you are still interested and want to read more, here is a
conversation with two physicists trying to explain this crazy equation
and their views on it’s usefulness and validity. It’s nice and short,
and very interesting.
https://physicstoday.scitation.org/do/10.1063/PT.5.8029/full/
medium.com
3 sept. 2020
28 août 2020
Form, Substance and Difference
 Form,
Substance and Difference
Form,
Substance and Difference
by Gregory Bateson
Let me say that it is an extraordinary honor to
be here tonight, and a pleasure. I am a little frightened of you all, because I
am sure there are people here who know every field of knowledge that I have
touched much better than I know it. It is true that I have touched a number of
fields, and I probably can face any one of you and say I have touched a field
that you have not touched. But I am sure that for every field I have touched,
there are people here who are much more expert than I. I am not a well-read
philosopher, and philosophy is not my business. I am not a very well-read
anthropologist and anthropology is not exactly my business.
But I have tried to do something which Korzybski
was very much concerned with doing, and with which the whole semantic movement
has been concerned, namely, I have studied the area of impact between very
abstract and formal philosophic thought on the one hand and the natural history
of man and other creatures on the other. This overlap between formal premises
and actual behavior is, I assert, of quite dreadful importance today. We face a
world which is threatened not only with disorganization of many kinds, but also
with the destruction of its environment, and we, today, are still unable to
think clearly about the relations between an organism and its environment. What
sort of thing is this, which we call "organism plus environment"?
Let us go back to the original statement for
which Korzybski is most famous—the statement that the map is not the
territory. This statement came out of a very wide range of philosophic
thinking, going back to Greece, and wriggling through the history of European
thought over the last 2000 years. In this history, there has been a sort of
rough dichotomy and often deep controversy. There has been violent enmity and
bloodshed. It all starts, I suppose, with the Pythagoreans versus their
predecessors, and the argument took the shape of "Do you ask what it's
made of—earth, fire, water, etc.?" Or do you ask, "What is its pattern?"
Pythagoras stood for inquiry into pattern rather than inquiry into substance.1 That controversy
has gone through the ages, and the Pythagorean half of it has, until recently,
been on the whole the submerged half. The Gnostics follow the Pythagoreans, and
the alchemists follow the Gnostics, and so on. The argument reached a sort of
climax at the end of the eighteenth century when a Pythagorean evolutionary
theory was built and the discarded—a theory which involved Mind.
The evolutionary theory of the late eighteenth
century, the Lamarckian theory, which was the first organized transformist theory
of evolution, was built out of a curious historical background which has been
described by Lovejoy in The Great Chain of Being. Before Lamarck, the
organic world, the living world, was believed to be hierarchic in structure,
with Mind at the top. The chain, or ladder, went down through the angles,
through men, through the apes, down to the infusoria or protozoa, and below
that to the plants and stones.
What Lamarck did was to turn that chain upside
down. He observed that animals changed under environmental pressure. He was
incorrect, of course, in believing that those changes were inherited, but in
any case, these changes were for him the evidence of evolution. When he turned
the ladder upside down, what had been the explanation, namely, the Mind at the
top, now became that which had to be explained. His problem was to explain
Mind. He was convinced about evolution, and there his interest in it stopped.
So that if you read the Philosophie Zoologique (1809), you will find
that the first third of it is devoted to solving the problem of evolution and
the turning upside down of the taxonomy, and the rest of the book is really
devoted to comparative psychology, a science which he founded. Mind was
what he was really interested in. He had used habit as one of the axiomatic
phenomena in his theory of evolution, and this of course also took him into the
problem of comparative psychology.
Now mind and pattern as the explanatory
principles which, above all, required investigation were pushed out of
biological thinking the later evolutionary theories which were developed in the
mid-nineteenth century by Darwin, Huxley, etc. There were still some naughty
boys, like Samuel Butler, who said that mind could not be ignored in this
way—but they were weak voices, and incidentally, they never looked at
organisms. I don't think Butler ever looked at anything except his own cat, but
he still knew more about evolution than some of the more conventional thinkers.
Now, at last, with the discovery of cybernetics,
systems theory, information theory, and so on, we begin to have a formal base
enabling us to think about mind and enabling us to think about all these
problems in a way which was totally heterodox from about 1850 through to World
War II. What I have to talk about is how the great dichotomy of epistemology
has shifted under the impact of cybernetics and information theory.
We can now say—or at any rate, can begin to
say—what we think a mind is. In the next twenty years there will be other ways
of saying it and, because the discoveries are new, I can only give you my
personal version. The old versions are surely wrong, but which of the revised
pictures will survive, we do not know.
The old unit has already been partly corrected
by the population geneticists. They have insisted that the evolutionary unit
is, in fact, not homogeneous. A wild population of any species consists always
of individuals whose genetic constitution varies widely. In other words,
potentiality and readiness for change is already built into the survival unit.
The heterogeneity of the wild population is already one-half of that
trial-and-error system which is necessary for dealing with environment.
The artificially homogenized populations of
man's domestic animals and plants are scarcely fit for survival.
And today a further correction of the unit is
necessary. The flexible environment must also be included along with the
flexible organism because, as I have already said, the organism which destroys
its environment destroys itself. The unit of survival is a flexible
organism-in-its-environment.
Now, let me leave evolution for a moment to
consider what is the unit of mind. Let us go back to the map and the territory
and ask: "What is it in the territory that gets onto the map?" We
know the territory does not get onto the map. That is the central point about
which we here are all agreed. Now, if the territory were uniform, nothing would
get onto the map except its boundaries, which are the points at which it ceases
to be uniform against some large matrix. What gets onto the map, in fact, is difference,
be it a difference in altitude, a difference in vegetation, a difference in
population structure, difference in surface, or whatever. Differences are the
things that get onto a map.
B ut
what is a difference? A difference is a very peculiar and obscure concept. It
is certainly not a thing or an event. This piece of paper is different from the
wood of this lectern. There are many differences between them—of color,
texture, shape, etc. But if we start to ask about the localization of those
differences, we get into trouble. Obviously the difference between the paper
and the wood is not in the paper; it is obviously not in the wood; it is
obviously not in the space between them, and it is obviously not in the time
between them. (Difference which occurs across time is what we call
"change.")
ut
what is a difference? A difference is a very peculiar and obscure concept. It
is certainly not a thing or an event. This piece of paper is different from the
wood of this lectern. There are many differences between them—of color,
texture, shape, etc. But if we start to ask about the localization of those
differences, we get into trouble. Obviously the difference between the paper
and the wood is not in the paper; it is obviously not in the wood; it is
obviously not in the space between them, and it is obviously not in the time
between them. (Difference which occurs across time is what we call
"change.")
A difference, then, is an abstract matter.
In the hard sciences, effects are, in general,
caused by rather concrete conditions or events—impacts, forces, and so forth.
But when you enter the world of communication, organization, etc., you leave
behind that whole world in which effects are brought about by forces and
impacts and energy exchange. You enter a world in which "effects"—and
I am not sure one should still use the same word—are brought about by differences.
That is, they are brought about by the sort of "thing" that gets onto
the map from the territory. This is difference.
Difference travels from the wood and paper into
my retina. It then gets picked up and worked on by this fancy piece of
computing machinery in my head.
The whole energy relation is different. In the
world of mind, nothing—that which is not—can be a cause. In the hard
sciences, we ask for causes and we expect them to exist and be
"real." But remember that zero is different from one, and because
zero is different from one, zero can be a cause in the psychological world, the
world of communication. The letter which you do not write can get an angry
reply; and the income tax form which you do not fill in can trigger the
Internal Revenue boys into energetic action, because they, too, have their
breakfast, lunch, tea, and dinner and can react with energy which they derive
from their metabolism. The letter which never existed is no source of energy.
It follows, of course, that we must change our
whole way of thinking about mental and communicational processes. The ordinary
analogies of energy theory which people borrow from the hard sciences to
provide a conceptual frame upon which they try to build theories about
psychology and behavior—that entire Procrustean structure—is non-sense. It is
in error.
I suggest to you, now, that the word
"idea," in its most elementary sense, is synonymous with
"difference." Kant, in the Critique of Judgment—if I
understand him correctly—asserts that the most elementary aesthetic act is the
selection of a fact. He argues that in a piece of chalk there are an infinite
number of potential facts. The Ding an sich, the piece of chalk, can
never enter into communication or mental process because of this infinitude.
The sensory receptors cannot accept it; they filter it out. What they do is to
select certain facts out of the piece of chalk, which then become, in
modern terminology, information.
I suggest that Kant's statement can be modified
to say that there is an infinite number of differences around and within
the piece of chalk. There are differences between the chalk and the rest of the
universe, between the chalk and the sun or the moon. And within the piece of
chalk, there is for every molecule an infinite number of differences between
its location and the locations in which it might have been. Of this
infinitude, we select a very limited number, which become information. In fact,
what we mean by information—the elementary unit of information—is a difference
which makes a difference, and it is able to make a difference because the
neural pathways along which it travels and is continually transformed are
themselves provided with energy. The pathways are ready to be triggered. We may
even say that the question is already implicit in them.
T here
is, however, an important contrast between most of the pathways of information
inside the body and most of the pathways outside it. The differences between
the paper and the wood are first transformed into differences in the
propagation of light or sound, and travel in this form to my sensory end
organs. The first part of their journey is energized in the ordinary
hard-science way, from "behind." But when the difference enter my
body by triggering an end organ, this type of travel is replaced by travel
which is energized at every step by the metabolic energy latent in protoplasm
which receives the difference, recreates or transforms it, and passes it
on.
here
is, however, an important contrast between most of the pathways of information
inside the body and most of the pathways outside it. The differences between
the paper and the wood are first transformed into differences in the
propagation of light or sound, and travel in this form to my sensory end
organs. The first part of their journey is energized in the ordinary
hard-science way, from "behind." But when the difference enter my
body by triggering an end organ, this type of travel is replaced by travel
which is energized at every step by the metabolic energy latent in protoplasm
which receives the difference, recreates or transforms it, and passes it
on.
When I strike the head of a nail with a hammer,
an impulse is transmitted to its point. But it is a semantic error, a
misleading metaphor, to say that what travels in an axion is an
"impulse>" It could correctly be called "news of a
difference."
Be that as it may this contrast between internal
and external pathways is not absolute. Exceptions occur on both sides of the
line. Some external chains of events are energized by relays, and some chains
of events internal to the body are energized from "behind." Notably,
the mechanical interaction of muscles can be used as a computational model.2
In spite of these exceptions, it is still
broadly true that the coding and transmission of differences outside the body
is very different from the coding and transmission inside, and this difference
must be mentioned because it can lead us into error. We commonly think of the
external "physical world" as somehow separate from an internal
"mental world." I believe that this division is based on the contrast
in coding and transmission inside and outside the body.
The mental world—the mind—the world of
information processing—is not limited by the skin.
Let us now go back to the notion that the
transform of a difference traveling in a circuit is an elementary idea. If this
be correct, let us ask what a mind is. We say the map is different from the
territory. But what is the territory? Operationally, somebody went out with a
retina or a measuring stick and made representations which we then put upon
paper. What is on the paper map is a representation of what was in the retinal
representation of the man who made the map/ and as you push the question back,
what you find is an infinite regress, an infinite series of maps. The territory
never gets in at all. The territory is Ding an sich and you can't do
anything with it. Always the process of representation will filter it out so
that the mental world is only maps of maps of maps, ad infinitum.3 All
"phenomena" are literally "appearances."
Or we can follow the chain forward. I receive
various sorts of mappings which I call data or information. Upon receipt of
these I act. But my actions, my muscular contractions, are transforms of
differences in the input material. And I receive again data which are transforms
of my actions. We get thus a picture of the mental world which has somehow
jumped loose from our conventional picture of the physical world.
This i s
not new, and for historic background we go again to the alchemists and
Gnostics. Carl Jung once wrote a very curious little book, which I recommend to
all of you. It is called Septem Sermones ad Mortuos, Seven Sermons to
the Dead.4
In his Memoirs, Dreams and Reflections, Jung tells us that his house was
full of ghosts, and they were noisy. They bothered him, they bothered his wife,
and they bothered the children. In the vulgar jargon of psychiatry, we might
say that everybody in the house was as psychotic as hooty owls, and for quite
good reason. If you get your epistemology confused, you go psychotic, and Jung
was going through an epistemological crisis. So he sat down at his desk and
picked up a pen and started to write. When he started to write the ghosts all
disappeared, and he wrote this little book. From this he dates all his later
insight. He signed it "Baslides," who was a famous Gnostic in
Alexandria in the second century.
s
not new, and for historic background we go again to the alchemists and
Gnostics. Carl Jung once wrote a very curious little book, which I recommend to
all of you. It is called Septem Sermones ad Mortuos, Seven Sermons to
the Dead.4
In his Memoirs, Dreams and Reflections, Jung tells us that his house was
full of ghosts, and they were noisy. They bothered him, they bothered his wife,
and they bothered the children. In the vulgar jargon of psychiatry, we might
say that everybody in the house was as psychotic as hooty owls, and for quite
good reason. If you get your epistemology confused, you go psychotic, and Jung
was going through an epistemological crisis. So he sat down at his desk and
picked up a pen and started to write. When he started to write the ghosts all
disappeared, and he wrote this little book. From this he dates all his later
insight. He signed it "Baslides," who was a famous Gnostic in
Alexandria in the second century.
He points out that there are two worlds. We
might call them two worlds of explanation. He names them pleroma and the
creatura, these being Gnostic terms. The pleroma is the world in which
events are caused by forces and impacts and in which there are no
"distinctions." Or, as I would say, no "differences." In
the creatura, effects are brought about precisely by difference. In fact, this
is the same old dichotomy between mind and substance.
We can study and describe the pleroma, but
always the distinctions which we draw are attributed by us to the
pleroma. The pleroma knows nothing of differences and distinction; it contains
no "ideas" in the sense in which I am using the word. When we study
and describe the creatura, we must correctly identify those differences which
are effective within it.
I suggest that "pleroma" and
"creatura" are words which we could usefully adopt, and it is
therefore worthwhile to look at the bridges which exist between these two
"worlds." It is an oversimplification to say that the "hard
sciences" deal only with the pleroma and that the sciences of the mind
deal only with the creatura. There is more to it than that.
First, consider the relation between energy and
negative entropy. The classical Carnot heat engine consists of a cylinder of
gas with a piston. This cylinder is alternately placed in contact with a
container of hot gas and with a container of cold gas. The gas in the cylinder
alternately expands and contracts as it is heated or cooled by the hot and cold
sources. The piston is thus driven up and down.
But with each cycle of the engine, the difference
between the temperature of the hot source and that of the cold source is
reduced. When this difference becomes zero, the engine will stop.
The physicist, describing the pleroma, will
write equations to translate the temperature difference into "available
energy," which he will call "negative entropy," and will go on
from there.
The analyst of the creatura will note that the
whole system is a sense organ which is triggered by temperature difference. He
will call this difference which makes a difference "information" or
"negative entropy." For him, this is only a special case in which the
effective difference happens to be a mater of energetics. He is equally
interested in all differences which can activate some sense organ. For him, any
such difference is "negative entropy."
O r
consider the phenomenon which the neurophysiolgists call "synaptic
summation." What is observed is that in certain cases, when two neurons, A
and B, have synaptic connection to a third neuron, C, the firing of neither
neuron by itself is sufficient to fire C; but that when both A and B fire
simultaneously (or nearly so), the combined "impulses" will cause C
to fire.
r
consider the phenomenon which the neurophysiolgists call "synaptic
summation." What is observed is that in certain cases, when two neurons, A
and B, have synaptic connection to a third neuron, C, the firing of neither
neuron by itself is sufficient to fire C; but that when both A and B fire
simultaneously (or nearly so), the combined "impulses" will cause C
to fire.
In pleromatic language, this combining of events
to surmount a threshold is called "summation."
But from the point of view of the student of
creatura (and the neruophysioligist must surely have one foot in the pleroma
and the other in creatura), this is not summation at all. What happens is that
the system operates to create differences. There are two differentiated classes
of firings by A: those firings which are accompanied by B and those which are
unaccompanied. Similarly there are two classes of firings by B. The so called
"summation" when both fire, is not an additive process from this
point of view. It is the formation of a logical product—a process of
fractionation rather than summation.
The creatura is thus the world seen as mind,
whenever such a view is appropriate. And whenever this view is appropriate,
there arises a species of complexity which is absent from pleromatic
description: creatural description is always hierarchic.
I have said that what gets from territory to map
is transforms of difference and that these (somehow selected) differences are
elementary ideas.
But there are differences between differences.
Every effective difference denotes a demarcation, a line of classification, and
all classification is hierarchic. In other words differences are themselves to
be differentiated and classified. In this context I will only touch lightly on
the matter of classes of difference, because to carry the matter further would
land us in problems of Principia Mathematica.
Let me invite you to a psychological experience,
if only to demonstrate the frailty of the human computer. First note that
differences in texture are different (a) from differences in color. Now
note that differences in size are different (b) from differences in
shape. Similarly rations are different (c) from subtractive differences.
Now let me invite you, as disciples of
Korzybski, to define the differences between "different (a),"
"different (b)," and "different (c)" in the
above paragraph. The computer in the human head boggles at the task. But not
all classes of difference are as awkward to handle
One such class you are all familiar with.
Namely, the class of differences which are created by the process of
transformation whereby the differences immanent in the territory become
differences immanent in the map. In the corner of every serious map you will
find these rules of transformation spelled out—usually in words. Within the
human mind, it is absolutely essential to recognize the differences of this
class, and, indeed, it is these that form the central subject matter of
"Science and Sanity."
An hallucination or a dream image is surely a
transformation of something. But of what? And by what rules of transformation?
Lastly there is that hierarchy of differences
which biologists call "levels." I mean such differences as that
between a cell and a tissue, between tissue and organ, organ and organism, and
organism and society.
Th ese
are the hierarchies of units or Gestalten, in which each sub unit is a
part of the unit of next larger scope. And, always in biology, this difference
or relationship which I call "parT of" is such that certain
differences in the part have informational effect upon the larger unit, and
vice versa.
ese
are the hierarchies of units or Gestalten, in which each sub unit is a
part of the unit of next larger scope. And, always in biology, this difference
or relationship which I call "parT of" is such that certain
differences in the part have informational effect upon the larger unit, and
vice versa.
Having sated this relationship between
biological part and whole, I can now go on from the notion of creatura as mind
in general to the question of what Is a mind.
What do I mean by "my" mind?
I suggest that the delimitation of an individual
mind must always depend upon what phenomena we wish to understand or explain.
Obviously there are lots of message pathways outside the skin, and these and
the messages which they carry must be included as part of the mental system
whenever they are relevant.
Consider a tree and a man and an ax. We observe
that the ax flies through the air and makes certain sorts of gashes in a
pre-existing cut in the side of the tree. If now we want to explain this set of
phenomena, we shall be concerned with differences in the cut face of the tree,
differences in the retina of the man, differences in this central nervous
system, differences in his efferent neural messages, differences in the
behavior of his muscles, differences in how the ax flies, to the differences
which the ax then makes on the face of the tree. Our explanation (for certain
purposes) will go round and round that circuit. In principle, if you want to
explain or understand anything in human behavior, you are always dealing with
total circuits, completed circuits. This is the elementary cybernetic thought.
The elementary cybernetic system with its
messages in circuit is, in fact, the simplest unit of mind; and the transform
of a difference traveling in a circuit is the elementary idea. More complicated
systems are perhaps more worthy to be called mental systems but essentially
this is what we are talking about. The unit which shows the characteristic of
trial and error will be legitimately called a mental system
But what about "me"? Suppose I am a
blind man, and I use a stick. I go tap, tap, tap. Where do I start? Is
my mental system bounded at the handle of the stick? Is it bounded by my skin?
Does it start halfway up the stick? Does it start at the tip of the stick? But
these are nonsense questions. The stick is a pathway along which transforms of
difference are being transmitted. The way to delineate the system is to draw
the limiting line in such a way that you do not cut any of these pathways in
ways which leave things inexplicable. If what you are trying to explain is a
given piece of behavior, such as the locomotion of the blind man, then, for
this purpose, you will need the street, the stick, the man; the street, the
stick, and so on, round and round.
But when the blind man sits down to eat his
lunch, his stick and its messages will no longer be relevant—if it is his
eating that you want to understand
And in addition to what I have said to define
the individual mind, I think it necessary to include the relevant parts of
memory and data "banks." After all, the simplest cybernetic circuit
can be said to have memory of a dynamic kind—not based upon static storage but
upon the travel of information around the circuit. The behavior of the governor
of a steam engine at Time 2 is partly determined by what it did at Time 1—where
the interval between Time 1 and Time 2 is that time necessary for the
information to complete the circuit.
We get a picture, then, of mind as synonymous
with cybernetic system—the relevant total information-processing,
trial-and-error completing unit. And we know that within Mind in the widest
sense there will be a hierarchy of subsystems, any one of which we can call an
individual mind.
But this picture is precisely the same as the
picture which I arrived at in discussing the unit of evolution. I
believe that this identity is the most important generalization which I have to
offer you tonight.
In considering units of evolution, I argued that
you have at each step to include the completed pathways outside the
protoplasmic aggregate, be it DNA-in-the-cell, or cell-in-the-body, or
body-in-the-environment. The hierarchic structure is not new. Formerly we
talked about the breeding individual or the family line or the taxon, and so
on. Now each step of the hierarchy is to be thought of as a system,
instead of a chunk cut off and visualized as against the surrounding
matrix.
This identity between the unit of mind and the
unit of evolutionary survival is of very great importance, not only theoretical,
but also ethical.
It means, you see, that I now localize something
which I am calling "Mind" immanent in the large biological system—the
ecosystem. Or, if I draw the system boundaries at a different level, then mind
is immanent in the total evolutionary structure. If this identity between
mental and evolutionary units is broadly right, then we face a number of shifts
in our thinking.
Moreover, the very meaning of
"survival" becomes different when we stop talking about the survival
of something bounded by the skin and start to think of the survival of the
system of ideas in a circuit. The contents of the skin are randomized at death
and the pathways within the skin are randomized. But the ideas, under further
transformation, may go on out in the world in books or works of art. Socrates
as a bioenergetic individual is dead. But much of him still lives in the
contemporary ecology of ideas.5
It is also clear that theology becomes changed
and perhaps renewed. The Mediterranean religions of 5000 years have swung to
and fro between immanence and transcendence. In Babylon the gods were transcendent
on the tops of hills; in Egypt, there was god immanent in Pharaoh; and
Christianity is a complex combination of these two beliefs.
The cybernetic epistemology which I have offered
you would suggest a new approach. The individual mind is immanent but not only
in the body. It is immanent also in pathways and messages outside the body; and
there is a larger Mind of which the individual mind is only a subsystem. This
larger Mind is comparable to God and is perhaps what some people mean by
"God," but it is still immanent in the total interconnected social
system and planetary ecology.
Freudian psychology expanded the concept of mind
inwards to include the whole communication system within the body—the
automatic, the habitual, and the vast range of unconscious process. What I am
saying expands mind outwards. And both of these changes reduce the scope of the
conscious self. A certain humility becomes appropriate, tempered by the dignity
or joy of being part of something much bigger. A part—if you will—of God.
If you put God outside and set him vis-a-vis his
creation and if you have the idea that you are created in his image, you will
logically and naturally see yourself as outside and against the things around
you. And as you arrogate all mind to yourself, you will see the world around
you as mindless and therefore not entitled to moral or ethical consideration.
The environment will seem to be yours to exploit. Your survival unit will be
you and your folks or conspecifics against the environment of other social
units, other races and the brutes and vegetables.
If this is your estimate of your relation to
nature and you have an advanced technology, your likelihood of survival
will be that of a snowball in hell. You will die either of the toxic
by-products of your own hate, or, simply, of over-population and overgrazing.
The raw materials of the world are finite.
If I am right, the whole of our thinking about
what we are and what other people are has got to be restructured. This is not
funny, and I do not know how long we have to do it in. If we continue to
operate on the premises that were fashionable in the prescybernetic era, and
which were especially underlined and strengthened during the Industrial
Revolution, which seemed to validate the Darwinian unit of survival, we may
have twenty or thirty years before the logical reductio ad absurdum of
our old positions destroy us. Nobody knows how long we have, under the present
system, before some disaster strikes us, more serious than the destruction of
any group of nations. The most important task today is, perhaps, to learn to
think in the new way. Let me say that I don't know how to think that
way. Intellectually, I can stand here and I can give you a reasoned exposition
of this matter; but if I am cutting down a tree, I still think "Gregory
Bateson" is cutting down the tree. I am cutting down the tree.
"Myself" is to me still an excessively concrete object, different
from the rest of what I have been calling "mind."
The step to realizing—to making habitual—the
other way of thinking so that one naturally thinks that way when one reaches
out for a glass of water or cuts down a tree—that step is not an easy one.
And, quite seriously, I suggest to you that we
should trust no policy decisions which emanate from persons who do not yet have
that habit.
There are experiences and disciplines which may
help me to imagine what it would be like to have this habit of correct thought.
Under LSD, I have experienced, as have many others, the disappearance of the
division between self and the music to which I was listening. The perceiver and
the thing perceived become strangely united into a single entity. This state is
surely more correct than the state in which it seems that "I hear the
music." The sound, after all is Ding an sich, but my perception of
it is a part of mind.
For me another —clueanother moment when the
nature of mind was for a moment clear—was provided by the famous experiments of
Adelbert Ames, JR. These are optical illusions in depth perception. As Ames'
guinea pig, you discover that those mental processes by which you create the
world in three-dimensional perspective are within your mind but totally
unconscious and utterly beyond voluntary control. Of course, we all know that
this is so—that mind creates the images which "we" then see. But
still it is a profound epistemological shock t have direct experience of this
which we always knew.
Please do not misunderstand me. When I say that
the poets have always known these things or that most of mental process is
unconscious, I am not advocating a greater use of emotion or a lesser use of
intellect. Of course, if what I am saying tonight is approximately true, then
our ideas about the relation between thought and emotion need to be revised. If
the boundaries of the "ego" are wrongly drawn or even totally
fictitious, then it may be nonsense to regard emotions or dreams or our
unconscious computations of perspective as "ego-alien."
We live in a strange epoch when many
psychologists try to "humanize" their science by preaching an
anti-intellectual gospel. They might, as sensibly, try to physicalize physics
by discarding the tools of mathematics.
It is the attempt to separate intellect
from emotion that is monstrous, and I suggest that it is equally monstrous—and
dangerous—to attempt to separate the external mind from the internal. Or to
separate mind from body.
Blake noted that "A tear is an intellectual
thing," and Pascal asserted that "The heart has its reasons of
which the reason knows nothing." We need not be put off by the fact that
the reasonings of the heart (or of the hypothalamus) are accompanied by
sensations of joy or grief. These computations are concerned with matters which
are vital to mammals, namely, matters of relationship, by which I mean
love, hate, respect, dependency, spectatorship, performance, dominance, and so
on. These are central to the life of any mammal and I see no objection to
calling these computations "thought," though certainly the units of
relational computation are different from the units which we use to compute
about isolable things.
But there are bridges between the one sort of
thought and the other, and it seems to me that the artist and poets are
specifically concerned with these bridges. It is not that art is the expression
of the unconscious, but rather that it is concerned with the relation between
the levels of mental process. From a work of art it may be possible to analyze
out some unconscious thoughts of the artist, but I believe that, for example,
Freud's analysis of Leonardo's Virgin on the Knees of St. Anne precisely
misses the point of the whole exercise. Artistic skill is the combining of many
levels of mind—unconscious, conscious, and external—to make a statement of
their combination. It is not a matter of expressing a single level.
Similarly, Isadora Duncan, when she said,
"If I could say it, I would not have to dance it," was talking
nonsense, because her dance was about combinations of saying and moving.
Indeed, if what I have been saying is at all
correct, the whole base of aesthetics will need to be re-examined. It seems
that we link feelings not only to the computations of the heart but also to
computations in the external pathways of the mind. It is when we recognize the
operations of creatura in the external world that we are aware of
"beauty" or "ugliness." The "primrose by the river's
brim" is beautiful because we are aware that the combination of
differences which constitutes its appearance could only be achieved by
information processing, i.e., by thought. We recognize another
mind within our own external mind.
And last, there is death. It is understandable
that, in a civilization which separates mind from body, we should either try to
forget death or to make mythologies about the survival of transcendent mind.
But if mind is immanent not only in those pathways of information which are
located inside the body but also in external pathways, then death takes on a
different aspect. The individual nexus of pathways which I call "me"
is no longer so precious because that nexus is only part of a larger mind.
The ideas which seemed to be me can also become
immanent in you. May they survive—if true.
From Steps to an Ecology of Mind,
1972, Chandler Publishing Co.; Balantine Books, a division of Random House, New
York. This was the Nineteenth Annual Korzybski Memorial Lecture, delivered
January 9, 1970, under the auspices of the Institute of General Semantics. It
is here reprinted from the General Semantics Bulletin, No. 37, 1970, by
permission of the Institute of General Semantics.
1.
R. G. Collingwood has given a clear account of
the Pythagorean position in The Idea of Nature, Oxford, 1945.
2.
It is interesting to note that digital computers
depend upon transmission of energy "from behind" to send "news"
along wire from one relay to the next. But each relay has its own energy
source. Analogic computers, e.g., tide mechanics and the like, are
commonly entirely driven by energy "from behind." Either type of
energization can be used for computational purposes.
3.
Or we may spell the matter out and say that at
every step, as a difference is transformed and propagated along its pathways,
the embodiment of the difference before the step is a "territory" of
which the embodiment after the step is a "map." The map-territory
relation obtains at every step.
4.
Written in 1916, translated by H. G. Baynes and
privately circulated in 1925. Republished by Stuart and Watkins, London, and by
Random House, 1961. In later work, Jung seems to have lost the clarity of the Seven
Sermons. In his "Answer to Job," the archetypes are said to be
"pleromatic." It is surely true, however, that constellations of
ideas may seem subjectively to resemble "forces" when their
ideational character is unrecognized.
5.
For the phrase "ecology of ideas," I
am indebted to Sir Geoffrey Vickers<'> essay "The Ecology of
Ideas" in Value Systems and Social Process, Basic Books, 1968. For
a more formal discussion of the survival of ideas see Gordon Pasks' remarks in
Wenner Gren Conference on "Effects of Conscious Purpose on Human
Adaptation," 1968.
Orig. source (10/01)
http://www.rawpaint.com/library/bateson/formsubstancedifference.html
http://www.rawpaint.com/library/bateson/formsubstancedifference.html
26 août 2020
NATIONAL GALLERY
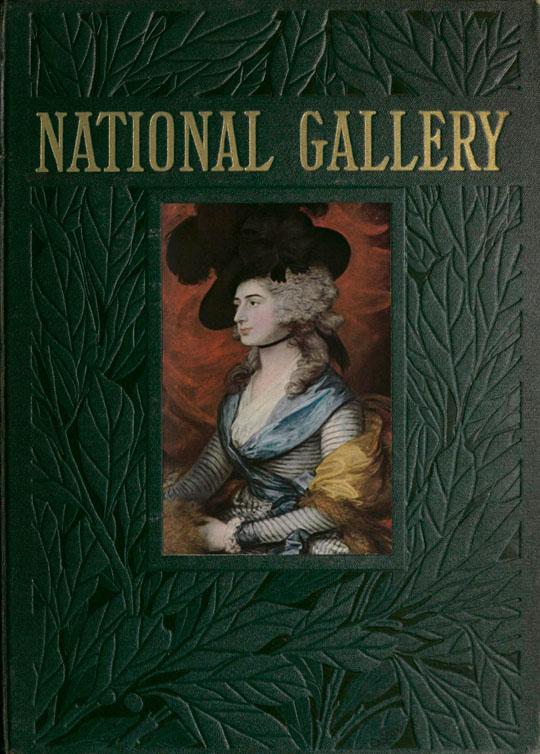
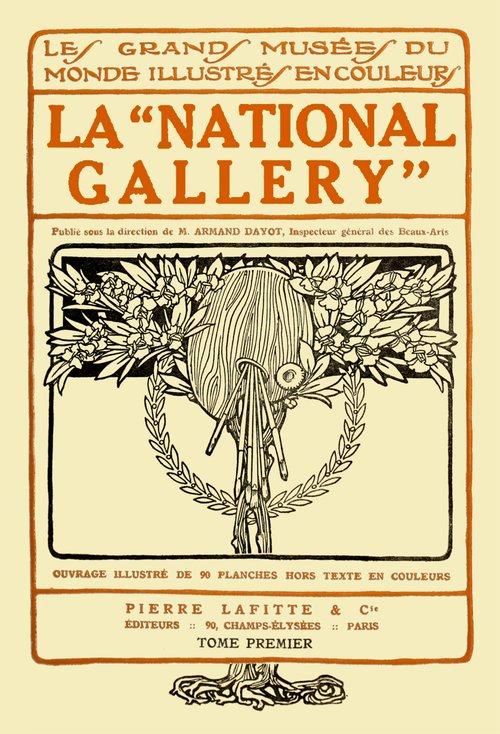
LES GRANDS MUSÉES DU
MONDE ILLUSTRÉS EN COULEURS
MONDE ILLUSTRÉS EN COULEURS
LA “NATIONAL
GALLERY”
Publié sous la direction de M. ARMAND DAYOT, Inspecteur général des Beaux-Arts
OUVRAGE ILLUSTRÉ DE 90 PLANCHES HORS TEXTE EN COULEURS
PIERRE LAFITTE & Cie
ÉDITEURS :: 90, CHAMPS-ÉLYSÉES :: PARIS
1912
ÉDITEURS :: 90, CHAMPS-ÉLYSÉES :: PARIS
1912
TOME PREMIER
COPYRIGHT 1912
BY PIERRE LAFITTE & Cie
BY PIERRE LAFITTE & Cie
AVERTISSEMENT
LA “NATIONAL GALLERY” n’est peut-être pas l’un des plus
importants musées d’Europe, mais elle est à coup sûr l’un
des plus intéressants. D’autres sont plus riches en tableaux
mondialement célèbres: Amsterdam s’enorgueillit de ses
Rembrandt, le Prado de ses Velazquez, l’Académie de Venise
de ses Titien; aucun, le Louvre excepté, ne présente une telle
variété, une telle harmonieuse répartition dans les œuvres de
toutes les époques et de toutes les écoles. Si leur nombre n’est
pas considérable, la sélection apparaît irréprochable et chaque
maître y est représenté par des toiles de première valeur.
L’Angleterre, comme la France, doit ces trésors au goût artistique
de ses rois qui mettaient leur gloire à enrichir leurs palais de
belles peintures. Louis XIV et Charles Ier furent d’incomparables
amateurs d’art, et si la “National Gallery” possède aujourd’hui
cette merveilleuse collection de chefs-d’œuvre, c’est en partie
à ce magnifique et malheureux Stuart qu’elle le doit.
Cette richesse de la “National Gallery” s’est encore accrue
par des dons particuliers très importants, et aujourd’hui c’est
véritablement l’histoire de l’art tout entière, complète et admirablement
classée que le visiteur retrouve en parcourant les
vingt-cinq salles de ce magnifique musée.
JEAN VAN EYCK
ARNOLFINI ET SA FEMME
SALLE IV.—PRIMITIFS FLAMANDS
5
Arnolfini et sa femme
LE tableau représente le couple d’Arnolfini et de sa femme dans
leur chambre nuptiale. Tout y est net, propre, rangé, comme il
sied à un intérieur de la Flandre méticuleuse. Le jeune ménage
a des habitudes d’ordre: sous les courtines à plis droits, le lit étale sa
courtepointe bien tirée. Au plafond est accroché un lustre dont les
cuivres étincelants trahissent les soins d’une diligente ménagère. Au
fond, contre le mur, s’aperçoit un miroir cylindrique de cuivre où se
reflètent la pièce et les personnages. Ceux-ci ne sont pas moins
soignés: ils sont vêtus de bonnes et solides étoffes qui dénotent
l’aisance. Les costumes, à vrai dire, sont ridicules, celui de l’homme
surtout: ils sont de cette époque dont Viollet-le-Duc disait «qu’ils
semblent issus de l’étude du laid et du difforme». Engoncée dans son
vaste chapeau, la maigre silhouette d’Arnolfini nous apparaît plus
falote encore sous l’ampleur inusitée de son manteau. La femme n’est
pas plus séduisante avec son vêtement étriqué par le haut et
démesurément large à partir de la ceinture. Sa coiffure ne l’avantage
pas non plus: cette sorte de coiffe aplatie sur le front et dissimulant
les cheveux enlève toute grâce au visage. Mais quelle expression dans
l’attitude et quelle vérité dans les physionomies! La jeune femme
pose affectueusement sa main dans celle de son époux. La douceur
des regards dit bien le sentiment mutuel qui anime ces deux êtres:
tendresse sérieuse et protectrice chez l’homme, affection reconnaissante
chez la femme à qui sont promises les joies prochaines de la
6
maternité. A leurs pieds se tient un caniche, symbolisant la fidélité
conjugale.
Arnolfini, comme son nom l’indique, était Italien. Envoyé à Bruges
comme représentant d’une grande maison de commerce de Florence,
il occupait dans la ville flamande une situation considérable, assez
analogue à celle de nos consuls modernes. En sa qualité de Florentin,
il aimait les arts et, sans que la preuve irréfutable en soit faite, on a
tout lieu de croire qu’il commanda pour son pays différents tableaux
à Jean Van Eyck. Durant son séjour en Flandre, il épousa Jeanne de
Chenany, jeune fille d’excellente famille et fort bien dotée, celle-là
même que représente le tableau.Pendant assez longtemps, on a cru reconnaître dans ce couple, le portrait de Jean Van Eyck et de sa femme, et l’on s’est basé, pour défendre cette opinion, sur l’inscription que porte la peinture: Johannes de Eyck fuit hic, et que l’on traduit ainsi: «Jean de Eyck fut celui-ci.» A cela, d’autres critiques répondent avec non moins de raison que la phrase latine signifie également «Jean de Eyck fut ici», ce qui ne prouve pas qu’il était le personnage du tableau, mais plus vraisemblablement son auteur.
En outre, si nous ne possédons aucun moyen d’identifier les traits du peintre, il nous est par contre très facile de nous convaincre par comparaison que la jeune femme représentée ici ne peut être celle de Jean Van Eyck. Celui-ci a laissé de sa femme un magistral portrait, actuellement au musée de Bruges, et on n’y constate aucun point de ressemblance avec celle-ci. Il semble donc acquis qu’il s’agit bien d’Arnolfini et de sa femme et non pas du célèbre auteur de l’Adoration mystique de l’Agneau.
Nous avons pensé que nul peintre n’était mieux indiqué que Jean Van Eyck pour figurer en tête de la série des chefs-d’œuvre de la “National Gallery”. Tout le marque pour cette place de choix: son merveilleux talent et surtout l’influence prépondérante qu’il exerça 7 non seulement sur la peinture flamande, mais encore sur la peinture universelle. N’oublions pas qu’on lui doit, sinon l’invention, du moins l’utilisation de l’huile mélangée à la peinture. Avant lui, on ne peignait qu’à la détrempe, procédé qui exigeait une très grande rapidité d’exécution et dont le moindre défaut était de sécher très lentement.
La “National Gallery” est particulièrement riche en œuvres de Jean Van Eyck, d’œuvres authentiques s’entend, car les tableaux attribués à cet artiste abondent dans les musées d’Europe. Les quelques portraits qu’elle possède sont admirables, mais le plus populaire, le plus parfait aussi, est celui d’Arnolfini et de sa femme.
Ce tableau éprouva des vicissitudes diverses au cours des siècles. On ne sait comment il sortit des mains de son premier propriétaire. Sans doute, il passa dans celles du duc de Bourgogne, Philippe le Bon, protecteur et ami de Van Eyck: en tout cas nous le trouvons, au XVIe siècle, dans la galerie de Marguerite d’Autriche, suzeraine des Flandres, qui raffolait de peinture. Par quelle étrange suite d’aventures échoua-t-il dans la boutique d’un barbier de Bruges, c’est ce qu’on ne saurait dire. Plus tard, le tableau prit la route d’Espagne dans les coffres de Marie de Hongrie; puis, sans aucune raison connue, il retourne en Belgique, dans une maison particulière où il orne la chambre d’un officier anglais, blessé à Waterloo, qui l’achète, l’emporte en Angleterre et, à sa mort, en fait don à la “National Gallery”.
Ce tableau, peint sur bois, figure aujourd’hui dans le grand musée anglais, à la salle des Primitifs flamands.
Hauteur: 0.84.—Largeur: 0.62.—Figures 0.67.
BOTTICELLI
PORTRAIT DE JEUNE HOMME
SALLE III.—ÉCOLE TOSCANE
11
Portrait de jeune homme
PARLER de Botticelli, c’est évoquer une des plus glorieuses
périodes de l’Histoire de l’art que le monde ait jamais connues,
c’est faire revivre toute une œuvre de fraîcheur, de joliesse,
de mysticité chrétienne et de charme païen, c’est rappeler cette
prodigieuse floraison spontanée dont Laurent de Médicis favorisa
l’épanouissement et qui porta ces rameaux illustres qui s’appellent
Léonard de Vinci, Michel-Ange, Ghirlandajo et Botticelli.
Dans cette brillante cohorte florentine, honneur de la peinture
universelle, Sandro Botticelli n’occupe pas la place la moins
honorable. S’il ne produit pas l’étrange fascination que provoque
Léonard de Vinci, ni la titanique puissance de Michel-Ange, il a plus
de fermeté que Ghirlandajo, avec moins de sécheresse dans la ligne
et plus d’onctueux dans la couleur. Dessinateur de premier ordre, il
conserve quelque chose de la suavité de son maître, Filippo Lippi, le
doux peintre des Madones et des Adorations. Son pinceau cherche
toujours sur la palette, les couleurs délicates, de même que son
crayon s’attarde plus volontiers aux créations gracieuses et tendres.
Toute sa vie, il est resté le peintre du Printemps; toutes ses
œuvres ont cette jeunesse, cette grâce adorable de nymphes blondes
s’ébattant dans les fleurs. Sa perfection et sa pureté sont devenues
classiques; son génie subtil, sa nature de mysticisme élégant, son
réalisme nuancé d’antique constituent une personnalité à part,
séduisante à étudier dans ses moindres détails.12 D’un génie très souple et très divers, Botticelli appliqua ses éminentes qualités de dessinateur et de coloriste aux sujets les plus différents; il peignit avec la même supériorité les scènes religieuses et les tableaux mythologiques. Un air de famille se reconnaît en toutes ses œuvres; ses déesses portent sur le front un cachet mystique qui les fait ressembler à des Vierges surprises de se trouver en quelque Olympe et ses Madones les plus idéales ont un je ne sais quoi de particulier sur le visage, une joliesse sous la couronne blonde des cheveux, qui dégage un subtil et délicat parfum de paganisme.
Botticelli fut essentiellement un Florentin, comme Dante lui-même, et c’est à Florence, dans sa ville natale, qu’on peut l’apprécier complètement. A part un bref séjour à Rome, où il peignit des fresques pour la Sixtine, il ne quitta guère sa patrie qu’il aimait et où l’attachaient ses relations artistiques et son dévouement aux Médicis.
Laurent le Magnifique, prince froid et dur comme tous ceux de son époque, possédait cependant une âme ouverte aux beautés de la poésie et des arts; son palais était l’asile d’un groupe brillant où voisinaient, avec les artistes, les philosophes et les savants.
Taine, dans son Voyage en Italie, en parle ainsi: «Laurent de Médicis accueille les savants, les aide de sa bourse, les fait entrer dans son amitié, correspond avec eux, fournit aux frais des éditions, patronne les jeunes artistes qui donnent des espérances, leur ouvre ses jardins, ses collections, sa maison, sa table, avec cette familiarité affectueuse et cette ouverture de cœur sincère et simple, qui mettent le protégé debout à côté du protecteur.»
Sous l’influence de ce puissant et bienveillant patronage, Sandro Botticelli s’épanouit magnifiquement. Aimé pour son caractère facile et tendre, il ne trouva dans ses rivaux de gloire, que des amis. La vie lui fut douce et il connut tout jeune les joies de la célébrité. Florence l’admirait et tout ce que la ville possédait de distingué 13 se disputait la faveur de poser devant lui. Et c’est alors que se révèle son merveilleux talent de portraitiste. N’eût-il pratiqué que ce genre, son nom serait resté gravé en traits immortels sur le livre d’or de la peinture et la Naissance de Vénus et le Printemps ne sauraient faire aucun tort à ces admirables portraits, si purs de dessin, si précieux de couleur, si vivants d’expression.
Il peignit la famille de ses protecteurs, les Médicis. On ne saurait rien voir de plus parfait que les portraits de Julien de Médicis et de sa chère Simonetta, dont la physionomie charmante lui servit plusieurs fois de modèle dans ses tableaux. Botticelli excellait surtout dans les portraits de femmes; il en traduisait, avec un art supérieur, le charme délicat et il y ajoutait cette gracilité qui le distingue. S’il aimait moins peindre les hommes, il ne déployait pas moins de virtuosité à exprimer le caractère de son modèle.
Est-il rien de plus vivant, de plus sincère, de plus brillant que ce Portrait de jeune homme que nous donnons ici? Où trouver un dessin plus ferme, un modelé plus savant, des chairs plus réalistes? Et cependant, sur cette effigie d’adolescent aux traits accusés, presque durs, on aperçoit cette chose indéfinissable, faite de douceur et de grâce qui nous rend le modèle sympathique et qui nous fait reconnaître au premier coup d’œil le tour prestigieux de Botticelli.
La “National Gallery” possède cinq œuvres authentiques de Botticelli; celle-ci est parmi les plus belles. Elle fut acquise par les Stuarts et elle figure aujourd’hui dans la salle III réservée à l’école toscane.
Hauteur: 0.37.—Largeur: 0.28.—Figure grandeur nature.
P. DE HOOCH
INTÉRIEUR HOLLANDAIS
SALLE XII.—COLLECTION PEEL
17
Intérieur Hollandais
PETER DE HOOCH est le plus charmant de ces artistes
hollandais qu’on a pris l’habitude de désigner sous le
nom de «petits maîtres.» Petits maîtres par l’insignifiance
et quelquefois la vulgarité des sujets, par l’absence de
toute pensée philosophique, de toute émotion, mais artistes supérieurs
pour la perfection de la technique, pour l’habileté de
l’exécution, pour la vérité de l’observation, pour l’admirable rendu
du détail. Parmi ces «petits maîtres» délicieux, Peter de Hooch
peut passer pour un «grand maître». Il possède les qualités
énoncées plus haut et qui sont l’apanage de tous, mais
il y ajoute ce que les autres ne possédèrent pas, le sentiment
de l’élégance et un certain laisser-aller de bonne compagnie,
grâce auquel ses personnages ne ressemblent pas tous à des
portefaix du port d’Amsterdam. Il n’a pas non plus son pareil
pour jouer avec la lumière, dont il s’est fait, en quelque sorte,
le prestidigitateur, la distribuant ou la mesurant avec un art
extraordinaire.
N’est-ce pas la lumière, en effet, qui joue le principal rôle
dans cet Intérieur hollandais que nous reproduisons ici? Par les
larges fenêtres aux vitres cernées de plomb, elle entre à flots
dans la pièce, éclairant à la fois les poutrelles du plafond et
les dalles du pavé, ne laissant aucun espace obscur. On conçoit
la difficulté, dans de pareilles conditions, de peindre un tableau
18
quelconque, sans le secours des ombres et des oppositions, et
c’est parce qu’il se plaisait à accumuler et à vaincre les difficultés
de ce genre que Peter de Hooch nous apparaît comme
un extraordinaire virtuose.Est-il possible, avec aussi peu de moyens, de donner plus de vie et d’intensité joyeuse à la scène intime qui se passe autour de la table, près de la fenêtre? Ce que font les personnages, il est assez malaisé de le dire. Nous voyons une jeune femme élevant un verre comme si elle allait boire: bien qu’on ne l’aperçoive que de dos, elle paraît chanter une chanson à en juger par l’attitude des deux hommes assis, dont l’un fait le geste de jouer du violon sur sa pipe tandis que l’autre a l’air de battre la mesure avec sa main.
L’inclination de Peter de Hooch pour l’élégance se traduit par l’introduction dans chacune de ses toiles, d’un personnage tenant du militaire et du galantin, et qui affecte les allures d’un gentilhomme. Mais on devine que l’artiste n’a pas choisi ses modèles à la cour de Versailles; il s’est assurément contenté de quelque fils de marchand jouant à l’homme de qualité, car il n’est pas possible de montrer moins de grâce sous des habits plus mal ajustés. Ce qui fait l’incomparable valeur des tableaux de Peter de Hooch, c’est l’admirable compréhension de la lumière que possédait ce peintre. A ce titre il l’emporte de beaucoup sur les peintres hollandais et flamands de son époque.
Gérard Dow n’avait pas ce maniement facile et brillant des rayons qui fait de Peter de Hooch un véritable prestidigitateur. Le seul qui pourrait lui être comparé sans trop de désavantage est Van der Meer de Delft qui semble avoir surpris lui aussi une part de ce secret.
Peter de Hooch l’emporte encore par une traduction beaucoup plus libre et beaucoup plus large de la vie hollandaise. 19 Aussi précis que Gérard Dow et Metsu, il évite de tomber comme eux dans la minutie exagérée du détail. Il y a plus d’ampleur dans sa peinture, plus d’élévation dans son style.
Mais le point par où il se rattache très étroitement à la grande famille hollandaise est dans le choix même des sujets, pris exclusivement dans le terre-à-terre de la vie quotidienne.
Il ne cherche pas en dehors de lui ni au-dessus de lui matière à tableau. Cette matière il la prend où il la trouve, à portée de sa main, et il la traite comme tous les Hollandais et Flamands d’avant et d’après lui, avec un sens du réalisme et un besoin de précision qui sont le plus grand des charmes de cette peinture minutieuse.
Il serait superflu d’y chercher une pointe quelconque d’idéalisme ou simplement une pensée de morale. Telle n’a jamais été la préoccupation de Peter de Hooch. Dans ses intérieurs, dans ses scènes d’auberge, dans tous les tableaux en un mot où il a peint la vie hollandaise, il n’a cherché ni à instruire, ni à faire penser, encore moins à moraliser.
Avant le XVIIe siècle, les Hollandais et Flamands abordaient encore fréquemment la peinture religieuse et, bien qu’ils n’y fussent pas d’une très grande inspiration, du moins y manifestaient-ils l’effort d’une pensée pieuse. Mais l’époque des dons de tableaux aux églises étant passée, les peintres de ces pays se confinèrent dans cette peinture de chevalet qui nous a valu de si nombreux chefs-d’œuvre.
L’Intérieur hollandais fut acquis assez récemment par la “National Gallery”. C’est un bijou de première valeur, qui figure dans la salle consacrée aux œuvres de la collection Peel.
Hauteur: 0.74.—Largeur: 0.64.—Figures: 0.40.
VELAZQUEZ
VÉNUS ET CUPIDON
SALLE XIV.—ÉCOLE ESPAGNOLE
23
Vénus et Cupidon
SUR un lit de repos, Vénus la blonde déesse est étendue. Elle est
vue de dos, dans une pose abandonnée qui détend tous les
muscles de son corps admirable. Son bras droit appuyé sur
l’oreiller soutient la nuque aux reflets d’or; la jambe gauche est allongée
tandis que de la jambe droite repliée, on n’aperçoit que le pied.
Sur le fond de draperie rouge qui ferme le lit, se détache la gracieuse
silhouette de Cupidon; une écharpe de soie bleue traverse en
baudrier sa poitrine et porte le carquois chargé de flèches:
ses ailes blanches s’agitent joyeusement pendant qu’il présente à
Vénus, d’un air mutin, un miroir où se reflète l’image de la déesse
des amours.
Cette page magistrale est un rare chef-d’œuvre, d’autant plus
précieux que Velazquez eut rarement le loisir de traiter des sujets
mythologiques et surtout de les exprimer sous cette forme, avec cet
emploi du nu qui fait penser aux Vénitiens de la grande époque.
S’évader des scènes religieuses était déjà une nouveauté, presque une
impiété, à une époque et dans un pays où le peintre ne devait être
que le glorificateur de la Foi et le fidèle serviteur de l’Église; mais
oser montrer une nudité et prêter tant de charmes lascifs à une
divinité païenne devait forcément choquer l’Espagne de Philippe IV,
régentée par l’Inquisition. Il fallut beaucoup de courage à Velazquez
pour risquer cette audace et sans doute se fia-t-il à l’amitié dont
l’honorait son mélancolique souverain. Il est bon de dire aussi que
24
l’artiste ajoutait à son talent de peintre le mérite d’une naissance
distinguée et l’éclat de fonctions administratives à la cour qui lui
permettaient certaines privautés. On ne l’inquiéta donc pas, mais le
parti religieux, tout-puissant à Madrid, tenait Velazquez en suspicion
et ne se privait pas d’intriguer contre lui. Sans que nul document le
démontre, on peut être assuré que le superbe tableau de Vénus et
Cupidon recueillit fort peu de suffrages et qu’il dut être considéré
comme la manifestation d’une âme corrompue.Aujourd’hui, où de telles disputes sont impossibles, nous voyons cette œuvre sous son vrai jour, avec sa vraie signification et nous admirons sans réserve cette géniale fantaisie du peintre officiel de la cour d’Espagne. Quelle admirable créature, en effet, que cette femme dans la splendeur vigoureuse de sa jeunesse et de sa beauté! Quel galbe dans ce dos et quelle finesse nerveuse et élégante dans le modelé de la jambe! Et surtout quelle vie ardente sous cet épiderme aux tons de velours où il semble que l’on voit courir le sang et palpiter les artères! Tout est charme et grâce dans ce beau corps; il faudrait du parti pris pour y apercevoir de la lasciveté; c’est uniquement le poème de la jeunesse triomphante.
Et quel art dans la composition! Comme tout est harmonieusement combiné pour donner tout son éclat à cette chair vibrante et souple! Le corps repose sur une large courtepointe de couleur grise qui fait valoir admirablement sa blancheur nacrée, de même que la charmante silhouette de Cupidon, rosée et blonde, se dore de la pourpre qui lui sert d’écran.
Comme Velazquez est Espagnol, il a choisi en Espagne le modèle de la splendide Vénus couchée. Elle a toute la souplesse des Castillanes à la taille mince et l’opulence des formes qui sont l’apanage des femmes sur l’autre versant des Pyrénées. C’est bien également un authentique visage d’Espagnole que reflète le miroir; visage aux joues pleines, où l’harmonie des lignes et la régularité des traits se 25 marient à une énergie dans l’expression qui est la caractéristique de la beauté castillane.
Ce tableau est particulièrement remarquable en ce qu’il nous montre Velazquez sous un aspect nouveau. On a l’habitude de le considérer uniquement comme un portraitiste et bien des gens se l’imaginent seulement occupé à peindre un roi morose et laid ou de petites infantes roses et frêles, embarrassées dans de rigides costumes d’apparat. Aucun génie, peut-être, ne fut aussi souple que celui de Velazquez; il aborda tous les genres avec la même maîtrise; et le même peintre qui fit les admirables portraits que l’on sait, a signé la prodigieuse toile de la Reddition de Bréda; et avec la même souplesse, il peignit des nains, des bouffons, des mendiants qui sont aussi artistiquement beaux que les plus chamarrés des gens de cour. Aussi, Velazquez restera-t-il comme l’un des plus étonnants artistes dont fasse mention l’histoire de la peinture.
Vénus et Cupidon occupe à la “National Gallery” la salle XIV réservée à l’école espagnole.
Hauteur: 1.23—Largeur: 1.75.—Figures grandeur nature.
LE TINTORET
SAINT GEORGES
TERRASSANT LE DRAGON
SALLE VII.—ÉCOLES DE VENISE ET DE BRESCIA
29
Saint Georges terrassant le dragon
LA scène représente un rivage découpé pittoresquement par la
mer bleue et fermé dans le fond par une haute muraille
crénelée. De grandes masses de verdure donnent au paysage
un aspect romantique auquel ajoute un ciel tumultueux, coupé de
lueurs et de ténèbres, où roulent de lourdes nuées chargées d’orage.
Le cadre est admirablement approprié au drame qui se joue dans ce
décor. Un monstre horrible, vomi par le flot, s’est abattu sur le
rivage où se promène une princesse, venue probablement de la ville
dont on aperçoit les tours. Déjà, sa présence s’est cruellement
manifestée: une victime, étendue sur le sol, témoigne de la férocité
du monstre. Affolée, la princesse fait des efforts désespérés pour
fuir; elle s’embarrasse dans les plis de son vêtement et sans doute
deviendrait-elle à son tour la proie de la bête, si un secours
providentiel n’arrivait à point pour la sauver. Monté sur un cheval
fougueux, le bienheureux saint Georges fonce droit sur le monstre et
de sa longue lance il le transperce et le rejette à la mer.
Dans ce tableau célèbre, Tintoret a concrétisé, pour ainsi dire,
la belle légende chrétienne du Ciel protégeant la Foi contre les
attaques du Démon. La Foi se trouve représentée sous les traits de
cette princesse blonde, belle, parée de vêtements somptueux qui
symbolisent l’éclat de la vertu. Quant au Démon, l’artiste nous le
montre sous la forme la plus hideuse et la plus terrifiante, sous un
aspect capable d’inspirer à tout jamais l’horreur du péché.30 L’allégorie n’est pas seulement ingénieuse, Tintoret l’a traitée avec une vigueur et une habileté qui tiennent du prodige. Le grand Vénitien, qui se plaisait à loger dans une même toile des centaines de personnages, est parvenu à donner, dans ce tableau de dimensions restreintes, l’impression d’un drame complet réduit à trois protagonistes. Quel art dans la composition, où tout est mouvement, où tout s’accorde à augmenter l’intensité de la scène, la princesse qui s’enfuit, le cavalier qui fonce, le monstre qui se tord sous le fer meurtrier et le ciel même, où il semble que l’on voit rouler la masse épaisse des nuages.
Tintoret avait déjà traité le même sujet avec une variante. Dans le Saint Georges et la Princesse, qui se trouve au Palais ducal à Venise, la Foi, représentée par la princesse, est victorieuse du Dragon sur le cou duquel elle est assise à califourchon et qu’elle maîtrise à l’aide d’un ruban qui lui sert de bride. Derrière elle, saint Georges étend les mains comme pour bénir, tandis qu’un moine, placé à droite du tableau, contemple gravement cette scène.
Quelque remarquable que soit cette deuxième interprétation, elle est inférieure à celle que nous donnons ici, véritable chef-d’œuvre dont s’enorgueillit le grand musée anglais.
Il convient de signaler aussi le merveilleux coloris de cette toile, si harmonieux dans son éclat. Par malheur, l’action des siècles en a terni le brillant en quelques parties, mais ce qui en reste suffirait, à défaut d’autres œuvres, pour classer Tintoret parmi les plus grands coloristes du monde.
C’est une gloire peu commune que d’avoir acquis ce titre, pour un artiste qui vient à la même époque et dans la même ville que Titien et Véronèse. Élève du premier, il montra de telles qualités qu’il éveilla la jalousie du maître et dut quitter son atelier. Cela n’empêcha pas Tintoret de devenir un peintre de premier ordre et de supporter sans désavantage la redoutable comparaison avec 31 Titien. Sur les murs de son atelier, il avait écrit: «La forme de Michel-Ange, la couleur du Titien.» Tintoret réunit également ces deux qualités: il démontra victorieusement que, malgré le brio de la couleur, on pouvait être un dessinateur impeccable; et certes, il est, de tous les Vénitiens, le peintre le plus correct, le plus probe, le plus parfait.
A ces qualités fondamentales, il ajoutait une facilité d’exécution qui tenait du prodige. Cette extraordinaire facilité lui permit de peindre pour des prix très modiques un nombre considérable de tableaux, destinés aux confréries et aux églises de Venise. Tout d’abord, on ne prit pas au sérieux cet homme qui travaillait si vite et pour n’importe quel prix, si minime fût-il; ses contemporains jugeaient que le travail est la vie de l’artiste et que le gain n’est qu’une question secondaire qu’il envisagera plus tard, à l’heure du succès.
Le succès vint, et il fut glorieux. Venise ne tarda pas à l’honorer à l’égal du Titien et de Véronèse; il fut le peintre officiel des doges et des patriciens et on lui confia la décoration du Palais Ducal, sur les murs duquel il peignit sa prodigieuse fresque du Paradis.
Saint Georges terrassant le Dragon fit partie de la collection de Charles Ier d’Angleterre. Il figure aujourd’hui à la «National Gallery» dans la salle VII, réservée aux écoles de Venise et de Brescia.
Hauteur: 1.57.—Largeur: 1 m.—Figures: 0.60.
SIR JOSHUA REYNOLDS
LES GRACES COURONNANT L’HYMEN
SALLE XVIII.—VIEILLE ÉCOLE ANGLAISE
35
Les Grâces couronnant la statue de l’Hymen
ON ne peut pas dire de Reynolds qu’il fut le plus grand peintre
anglais de son temps, mais il compte parmi les plus brillants
et les plus parfaits. Gainsborough eut des qualités supérieures
aux siennes, Romney aussi nous charme par plus de grâce
aisée; mais Reynolds, né sous une heureuse étoile, reçut de la nature
des dons précieux qui, sans aller jusqu’au génie, lui permirent cependant
de produire des chefs-d’œuvre. Sa carrière d’artiste est avant tout
un miracle de la volonté. Sans avoir de dispositions exceptionnelles
pour la peinture, il devint un grand peintre à force de persévérance et
d’énergie, de même qu’il fût devenu un grand ingénieur, un savant, ou
un écrivain si les circonstances l’avaient incliné vers l’une ou l’autre de
ces professions. Reynolds fut avant tout un opiniâtre. Encore enfant,
il disait: «Je serai peintre si vous me fournissez le moyen d’être un
bon peintre.» On lui mit en main des pinceaux et son labeur acharné,
sa conscience, son étude approfondie des maîtres firent le reste. Dès
ses débuts, il détermina la voie qu’il voulait suivre; il se résolut à être
portraitiste. Et cette décision une fois prise, rien ne put le détourner
de son objet: «Mon but unique dans la vie est de peindre des
portraits et de les peindre le mieux possible.» Heureux les hommes à
qui les fées, dans leur berceau, ont déposé comme présent cette énergie
tenace que ne rebute aucun obstacle! L’avenir leur appartient et, avec
la fortune, souvent la gloire leur est promise.
L’une et l’autre échurent à Reynolds, il réalisa complètement son
36
rêve. Il fut le portraitiste le plus vanté de son époque et ne rechercha
pas d’autres lauriers. Même dans les tableaux où il aborda l’allégorie,
les personnages qu’il met en scène sont des portraits et le décor dont
il les agrémente n’y joue qu’un rôle secondaire et décoratif, uniquement
destiné à faire mieux valoir les avantages de ses modèles.Tel est le cas pour le tableau reproduit ici. Ces trois Grâces vêtues à la dernière mode londonienne du XVIIIe siècle n’ont rien de l’esthétique usitée dans ce genre de sujets; ce sont de véritables Anglaises que nul trait n’apparente aux classiques beautés que peintres et sculpteurs ont l’habitude de nous montrer. Blondes comme il sied à des filles du Nord, élancées, fines, elles ont cette fraîcheur délicate et cette grâce aristocratique dont l’Angleterre possède de si nombreux et si charmants modèles. Ces trois Grâces sont trois sœurs, filles de Sir W. Montgomery: celle de gauche, qui est agenouillée et tend des fleurs à ses compagnes, est Mrs. Beresford; celle du milieu, dont le genou ployé s’appuie sur le soubassement de la stèle, est Mrs. Gardiner, mère de Lord Blessington; enfin, nous reconnaissons la marquise Townsend dans la superbe jeune femme qui, dans ses mains levées, déploie la guirlande odorante et fleurie destinée à l’Hymen.
L’allégorie n’est donc qu’un prétexte et l’on s’en aperçoit bien. Reynolds l’a traitée à la mode du temps, conformément aux canons intronisés par la peinture française et surtout par Boucher. Le paysage est un joli décor de feuillages dorés par l’automne et l’on y voit, derrière la divinité armée de son flambeau, un magnifique rideau de pourpre tendu entre deux arbres, que l’on devine posé là comme un écran pour rehausser l’éclat de ces beautés blondes. Toutes les concessions ont été faites au goût de l’époque; Reynolds n’a pas même oublié l’aiguière ciselée que l’on aperçoit invariablement, on ne sait trop pourquoi, dans toutes les compositions allégoriques de ce temps.
Tel qu’il est, invraisemblable et apprêté, ce tableau n’en a pas moins un charme captivant. Ce qui attire surtout—et c’est bien là ce 37 qu’a voulu Reynolds—c’est la physionomie des personnages, de ces trois sœurs qui sont le sujet véritable et important de la composition.
Très habile metteur en scène, l’artiste a disposé ses modèles en des attitudes variées qui donnent à son œuvre une impression de mouvement grâce auquel il a esquivé la symétrie fâcheuse de trois portraits côte à côte.
Il convient d’admirer aussi l’heureuse distribution des couleurs, réparties en teintes douces et discrètes, d’une suprême distinction. Le coloris fut d’ailleurs la constante préoccupation de Reynolds. Dès sa jeunesse, il s’était livré à de laborieuses études des maîtres, et surtout des Vénitiens, ces maîtres entre les maîtres pour la splendeur de la palette. Il s’était évertué à surprendre leur technique, à s’assimiler leurs procédés. Il convient d’avouer cependant que, s’il les imita, ce ne fut que de façon très imparfaite; on ne pénètre pas aussi aisément dans le secret des dieux. Trop souvent ses recherches du secret des Vénitiens se firent aux dépens de ses clients dont les portraits, merveilleux à leur apparition, vieillirent plus vite que les modèles eux-mêmes; les fonds se décomposèrent et le coloris superficiel devint fantomatique. Fort heureusement, bon nombre de ses toiles ont échappé à cette disgrâce et conservent encore aujourd’hui l’éclat suprême des premiers jours. Mais, même dans les plus maltraitées par le temps, l’harmonie de la ligne demeure et classe Sir Joshua Reynolds dans la lignée des grands peintres anglais.
Les Grâces couronnant l’Hymen fut exposé à la Royal Academy en 1774. Ce tableau fut donné par le comte de Blessington à la «National Gallery», où il figure aujourd’hui dans la salle réservée à la vieille école anglaise.
Hauteur: 2.33—Largeur: 2.89.—Figures en buste grandeur naturelle.
HOLBEIN
CHRISTINE DE MILAN
SALLE XV.—ÉCOLE ALLEMANDE
41
Christine de Milan
L’ORIGINE de ce magnifique portrait est curieuse et l’histoire en
est célèbre.
Holbein était venu d’Angleterre à Milan, sur les ordres de
Henri VIII, pour peindre la jeune Christine de Danemark, à peine
âgée de seize ans et déjà veuve, dont le Barbe-Bleue couronné prétendait
faire sa femme. Ambassadeur en même temps que peintre,
Holbein s’acquitta de sa mission auprès de la princesse. Mais trop
certaine du sort qui l’attendait en Angleterre, celle-ci refusa net la
couronne qu’on lui offrait:—Je n’ai qu’une tête, répondit-elle au peintre, et je tiens à la conserver sur mes épaules.
Malgré son jeune âge, cette princesse ne manquait ni d’à-propos ni de bon sens. Mais si elle éconduisit Holbein, messager matrimonial, elle consentit volontiers à poser devant un peintre dont la célébrité était universelle. Holbein se mit à l’œuvre et exécuta l’admirable portrait que nous reproduisons.
La jeune femme est debout, revêtue d’un costume sombre noué à la ceinture par un ruban. Sur ce vêtement elle porte un manteau de velours noir doublé de fourrures. Aucun ornement ne corrige la sévérité de la tenue: la duchesse porte encore le deuil de son époux, le duc de Milan, récemment décédé. Seules, la fine collerette et les poignets en dentelle éclairent le tableau. Sur la tête est posée une sorte de capuce noire qui l’enveloppe entièrement et emprisonne les 42 cheveux et les oreilles, suivant la disgracieuse mode de cette époque.
Fidèle à un procédé qui lui était habituel et que risquent seuls les grands artistes, Holbein a placé son personnage sur un fond presque aussi sombre que le sujet lui-même. Ce procédé a l’avantage de donner toute l’importance aux deux points essentiels du portrait: le visage et les mains qui, de cette manière, se détachent en vigueur. Dans ce portrait, où tout est admirable, ce visage et ces mains sont deux pures merveilles.
Sans être belle ni même régulière, la figure de la duchesse possède un charme réel qui permet de comprendre la convoitise d’Henri VIII. Il y a de l’intelligence dans les yeux, de la douceur et de la bonté dans la légère moue des lèvres. Mais ce qui se trouve exprimé avec un art incomparable, c’est la vie intérieure du modèle traduite en quelques traits légers, au moyen de frottis à peine perceptibles qui disent tout, le front plein de pensées, l’attention sérieuse et jusqu’aux sentiments de l’âme. Quant aux mains à demi fermées sur les gants, elles sont d’un galbe sans égal et on ne peut leur comparer que les mains d’Antoine Arnauld, par Philippe de Champaigne, au musée du Louvre. Fines, allongées, elles trahissent l’aristocratique naissance de la jeune femme. Elle est noble d’ailleurs dans toute sa personne. Malgré l’ampleur de son manteau, on devine une taille bien prise et des formes parfaites. Et nous pouvons certifier que telle fut Christine de Milan: car Holbein n’avait pas pour habitude de flatter ses modèles. Inexorable transcripteur de la nature, il peignait son personnage comme il le voyait, sans jamais dissimuler aucune de ses imperfections ou de ses tares. Aussi ses portraits, en dehors même de leur valeur artistique, acquièrent une importance documentaire de premier ordre.
Tel est l’attrait de cette Christine de Milan que l’œil s’obstine sur le visage et sur les mains et qu’il oublie de fouiller dans la pénombre où se dissimulent les vêtements. Et cependant l’art précis du peintre s’est exercé avec une maîtrise supérieure dans ces parties volontairement 43 obscures qu’il semble avoir voulu cacher. Quelle science et quelle perfection dans la disposition du manteau, quelle souplesse dans l’agencement des plis! Tout est beau dans cette page magistrale et l’on ne s’étonne plus qu’elle ait été disputée à coups de millions.
Holbein, dont les tableaux atteignent aujourd’hui des prix fabuleux, eut des débuts très difficiles. Il connut la gloire de son vivant, mais elle ne vint pas tout de suite. Longtemps il promena sa précaire existence dans les villes de Suisse, à Bâle, à Lucerne, peignant des portraits à vil prix pour payer sa nourriture ou solder des amendes encourues à la suite de quelque rixe dans les cabarets. Il composait des vitraux, décorait des maisons, acceptait toutes les besognes. «Tous les étrangers, dit un voyageur, s’arrêtent avec plaisir au coin d’une petite rue de Bâle, où il y a une maison, peinte au dehors, depuis le bas jusqu’en haut, de la main d’Holbein; de grands princes se pourraient faire honneur de ce travail; ce n’était néanmoins que le payement que faisait ce pauvre peintre de quelques repas qu’il y avait pris; car c’était un cabaret dont la situation aussi bien que la médiocrité marquaient assez qu’il n’était pas des plus célèbres.»
Bientôt, cependant, il se lia avec les humanistes et les réformateurs très nombreux à Bâle. Il gagna l’amitié d’Erasme et ce fut celui-ci, très influent en Angleterre, qui l’appela à la cour d’Henri VIII et contribua à sa fortune.
Le beau portrait de Christine de Milan, fut acheté par la “National Gallery” 1.800.000 francs et figure dans la salle XV, réservée à l’école allemande.
Hauteur: 1.77.—Largeur: 0.81.—Figure grandeur nature.
LÉONARD DE VINCI
LA VIERGE AUX ROCHERS
SALLE IX.—ÉCOLE LOMBARDE
47
La Vierge aux rochers
LA scène se développe dans une caverne bizarrement découpée,
en décor romantique, et formée de roches et de feuillages. Par
les ouvertures de la caverne s’aperçoivent les eaux d’un lac
bordées de rochers escarpés, et qui reflètent l’azur d’un ciel très pur.
Lumière éclatante au dehors, ombre et fraîcheur au dedans. C’est dans
cette ombre propice que le grand Léonard a placé le groupe divin.
La Vierge, moitié assise, moitié agenouillée, présente le petit Saint
Jean à l’Enfant Jésus qui le bénit de son doigt levé. Un ange à mine
charmante et fine, hermaphrodite céleste tenant de la jeune fille et du
jeune homme, mais supérieur à tous deux par son idéale beauté,
accompagne et soutient le petit Jésus comme un page de grande
maison qui veille sur un enfant de roi, avec un mélange de respect et
de protection. Une chevelure aux mille boucles, annelée et crêpelée,
encadre son fin visage d’une aristocratique distinction. Cet ange, à
coup sûr, occupe un haut grade dans la hiérarchie du ciel; ce doit être
un trône, une domination, une principauté tout au moins. L’Enfant
Jésus, ramassé sur lui-même, dans une pose pleine de savants raccourcis,
est une merveille de rondeur et de modelé. La Vierge a ce
charmant type lombard où, sous la candeur pudique, perce cet enjouement
malicieux que le Vinci excelle à rendre. Cette magistrale
peinture a noirci, surtout dans les ombres, mais n’a rien perdu de son
harmonie, et peut-être même serait-elle moins poétique si elle avait
gardé sa fraîcheur primitive et les tons naturels de la vie.48 Ce tableau, qui paraît dater de 1495, aurait été peint à Milan, par Ambrogio da Predis, sous la surveillance de Léonard lui-même et serait simplement la copie d’une autre toile semblable peinte pour la chapelle de la Conception, à l’église des Franciscains de Milan. Cette toile est celle que l’on peut admirer au Louvre, dans la Grande Galerie, sous ce même titre: La Vierge aux rochers. L’authenticité et la priorité de la Vierge du Louvre est en dehors de toute discussion: en sa présence on est, à n’en pas douter, en face de l’œuvre originale. Mais celle de la “National Gallery” dont ce musée s’enorgueillit si justement, serait-elle donc véritablement l’œuvre d’un copiste ou d’un élève? Il est impossible de le croire, lorsqu’on la contemple attentivement. Qu’Ambrogio da Predis ait collaboré à l’établissement de cette réplique, on peut l’admettre; il avait du talent et Vinci l’estimait. Mais nul autre que le Vinci n’a pu dessiner ces contours si fermes et si purs, conduire ce modelé aux dégradations savantes qui donne aux corps la rondeur de la sculpture avec tout le moelleux de l’épiderme, et rendre ses types favoris d’une façon si fière et si délicate.
Donc, si la Vierge aux rochers de la “National Gallery” n’est pas la Vierge primitive, elle n’en est pas moins une œuvre originale, merveilleuse et bien digne de porter la signature de Vinci. Tout y proclame le maître, nulle part on n’y trouve l’hésitation par où se trahirait la contribution du copiste. D’ailleurs, elle fut décrite en 1584 par Lomazzo, comme se trouvant dans la chapelle de la Conception, à l’église San Francisco de Milan, pour laquelle l’une et l’autre avaient été peintes.
Celle du Louvre, qui date de 1482, allait être livrée et mise en la place qu’elle devait occuper dans l’église, lorsqu’un différend s’éleva entre l’artiste et la Confrérie de la Conception, au sujet du paiement de la toile. Celle-ci prétendait rabattre une somme assez importante sur le prix convenu. Le conflit devint à ce point aigu, que Léonard de Vinci dut faire appel à l’intervention du duc de Milan, dans une lettre 49 récemment découverte dans les archives de cette ville. La discussion se prolongea plusieurs années, si bien que Vinci, de guerre lasse, vendit son tableau, et lorsque, enfin, les deux parties tombèrent d’accord, Léonard consentit à recommencer la toile, en collaboration avec Giovanni Ambrogio da Predis.
Quelques différences sont à noter dans cette œuvre, comparée à celle du Louvre. L’ange y est posé dans une attitude légèrement modifiée; en outre, les trois principaux personnages y sont pourvus d’une auréole d’or qui ne se trouve pas sur la peinture originale et qui semble d’ailleurs avoir été ajoutée après coup.
La Vierge aux rochers existe donc à deux exemplaires également remarquables comme exécution. Et si le Louvre possède sans conteste l’original, la “National Gallery” peut être fière de cette réplique admirable, où se manifeste la prodigieuse virtuosité du plus grand peintre de tous les temps.
La Vierge aux rochers fut apportée en Angleterre en 1777 par Gavin Hamilton; elle figure aujourd’hui à la “National Gallery”, dans la salle IX, réservée à l’école lombarde.
Hauteur: 1.84.—Largeur: 1.13.—Figure grandeur nature.
GAINSBOROUGH
Mrs. SIDDONS
SALLE XVIII—VIEILLE ÉCOLE ANGLAISE
53
Mrs. Siddons
LE modèle de cette toile légendaire était une actrice réputée en
Angleterre, vers la fin du XVIIIe siècle, pour son talent et sa
grande beauté. Elle est représentée assise de trois quarts devant
un fond de draperie rouge. Elle porte une élégante robe rayée de
bleu, garnie aux épaules et à la ceinture d’une sorte d’écharpe de
même couleur. Un grand manteau jaune bordé de fourrure drape
ce corps charmant, se pose négligemment sur les genoux et vient
s’enrouler autour du bras gauche. Avec l’une de ses mains elle maintient
un manchon de fourrures. Un large chapeau à plumes noires
encadre le délicieux visage de Mrs. Siddons, visage d’une admirable
pureté de lignes et d’une idéale délicatesse de traits, encore embelli
par l’abondante parure des cheveux poudrés qui retombent en boucles
soyeuses sur les épaules.
Dans ce magistral portrait se trouvent en quelque sorte réunies les
éminentes qualités de l’art de Gainsborough. Non pas toutes
cependant, car il y aurait injustice à oublier que le grand portraitiste
fut en même temps un remarquable peintre de paysages.Gainsborough était encore enfant lorsque s’éveilla en lui l’amour de la peinture. Avant d’avoir reçu la moindre éducation artistique, il possédait déjà cette extraordinaire facilité, cette sûreté de crayon que l’on admirera plus tard dans son œuvre.
On raconte à ce sujet une anecdote qui se place à l’époque où Gainsborough avait douze ans: l’enfant était assis dans le jardin 54 paternel à l’abri de buissons qui le dissimulaient, et copiait un vieux poirier. Tout à coup, au-dessus du mur de clôture, émergea la tête d’un paysan qui, d’un œil de convoitise, examina les fruits et, se croyant seul, en cueillit un, le plus beau. L’ardente expression du visage de l’homme frappa tellement Gainsborough qu’il la reproduisit séance tenante sur son dessin. Et si fidèle fut la traduction que le père reconnut aussitôt l’auteur du larcin et le lui reprocha.
Après un court passage dans l’atelier d’Hayman, Gainsborough se maria et quitta Sudbury, où il était né, pour se fixer à Ipswich, capitale du comté de Suffolk. Il eut la chance de s’y lier avec Philippe Thicknesse, personnage important de la province, qui le recommanda chaudement et lui procura de nombreuses commandes. Mais une querelle, d’ordre tout à fait étranger à la peinture, mit fin à leurs relations et Gainsborough abandonna Ipswich et s’installa à Bath en 1758. Il y séjourna 16 ans. Bath était alors une station à la mode, quelque chose dans le genre de notre Riviera actuelle; toute la société de Londres s’y donnait rendez-vous pendant la belle saison. Gainsborough vit les commandes affluer: bientôt les portraits en buste, qu’il tarifait au début cinq guinées, se payèrent huit, puis quatorze guinées; quant aux portraits en pied, ils ne montaient pas à moins de cent guinées.
C’est vers cette époque que Gainsborough fut saisi d’une passion subite et extraordinaire pour la musique, passion qui le posséda au point de lui faire négliger la peinture et ses intérêts. Néanmoins, son séjour à Bath marque un changement considérable et un progrès réel dans sa technique, sans doute parce qu’il put voir et étudier, dans les riches demeures des environs, les œuvres des grands maîtres du passé qu’il ne connaissait encore que très imparfaitement.
Aussi dès son arrivée à Londres, en 1774, il est en pleine possession de son talent. La notoriété l’y a déjà précédé et son atelier est assailli par tout ce que la capitale compte de distingué. Les portraits succèdent 55 aux portraits et la plupart sont des chefs-d’œuvre. Il fait déjà partie, depuis la fondation, de l’Académie instituée par Reynolds et ses envois annuels y font l’admiration des amateurs. Il cesse d’y exposer pendant quelque temps à la suite d’une brouille avec Reynolds. Les deux grands peintres se connaissent et professent l’un pour l’autre une estime réciproque, mais leurs caractères très différents s’accordent mal et ils vivent complètement éloignés l’un de l’autre. Gainsborough, qui semble avoir eu les premiers torts, a l’âme impétueuse mais bonne; et quand il sent venir sa mort, il écrit une lettre touchante à son illustre rival et lui demande de conduire ses obsèques. Il mourut le 2 août 1788, à l’âge de soixante et un ans.
Gainsborough, par l’originalité de son talent, l’élégance de sa manière, la qualité de sa couleur, demeurera comme l’une des plus hautes personnifications de l’art anglais.
Écoutons John Ruskin: «La puissance de coloris de Gainsborough a ce qu’il faut pour prendre rang à côté de celle de Rubens; c’est le plus pur coloriste, sans en excepter Reynolds lui-même, de toute l’école anglaise. On verra assez de preuves de l’admiration que j’ai vouée à Turner, mais je n’hésite pas à dire que, dans l’art purement technique de la peinture, Turner est un enfant auprès de Gainsborough. La main de Gainsborough est aussi légère que le vol d’un nuage, aussi rapide que l’éclair d’un rai de soleil. Ses formes sont grandes, simples, idéales. En un mot, c’est un peintre immortel.»
Mrs. Siddons appartint longtemps à la collection du Major Mair, qui avait épousé la petite-fille de la célèbre actrice; il figure aujourd’hui à la “National Gallery” dans la salle XVIII, consacrée à la vieille école anglaise.
Hauteur: 1.25.—Largeur: 0.99.—Figure grandeur nature.
A. VAN DYCK
LES ENFANTS DE CHARLES Ier
GALERIE NATIONALE DES PORTRAITS
59
Les Enfants de Charles Ier
ANTONIO VAN DYCK—Sir Anthony Van Dyck, comme
l’appellent les Anglais—fut attiré en Angleterre par le roi
Charles Ier. Beau cavalier, causeur spirituel, esprit subtil, il
eut vite fait la conquête de la cour et de la ville. Le monarque
l’honora d’une faveur toute particulière, le nomma principal peintre
ordinaire, le créa chevalier et lui donna un logement dans le palais
royal de Blackfriars. Van Dyck ne se montra pas ingrat; il voua à son
généreux protecteur un dévouement qui ressemblait à un culte. Malgré
l’abondance de sa production, son pinceau fut surtout consacré au roi
et à sa famille. Nombreux sont les portraits de Charles Ier, on n’en
compte pas moins de trente-huit; le Louvre en possède un magnifique
exemplaire, d’une célébrité mondiale; la “National Gallery” s’enorgueillit
du portrait équestre du roi, qui ne lui est guère inférieur. Non
moins abondantes sont les effigies des divers enfants du souverain; on
en trouve à Windsor et dans les Musées du Louvre, de Dresde, de
Saint-Pétersbourg, de Turin, de Berlin. Celui que nous donnons ici
est un des plus beaux et en même temps des plus intéressants, en ce
qu’il représente toute la descendance directe du malheureux Stuart.
L’artiste a placé ses jeunes et charmants modèles sur une même
ligne, devant un fond de draperie relevée qui laisse apercevoir les
ombrages d’un parc. Au centre du tableau se tient le prince de Galles,
qui devint plus tard Charles II d’Angleterre; vêtu d’un riche costume
pourpre avec collerette de dentelle et manches à crevés, il appuie sa
60
jolie main d’enfant sur la tête d’un énorme et paisible molosse. Tout
près de lui, à gauche du tableau, est figuré son jeune frère, âgé de
quatre ans, encore en costume de fillette, qui deviendra roi à son tour
sous le nom de Jacques II; la charmante fillette de six ans qu’on
aperçoit à gauche, si mignonne sous sa parure de cheveux blonds et
qui prend déjà des airs de reine, est la princesse Marie qui sera plus
tard la mère de Guillaume III. A droite, l’enfant qui s’empresse auprès
du bébé, n’a guère plus de deux ans; c’est la princesse Élisabeth.
Quant au rose et potelé baby qui se débat dans ses langes pour
atteindre la tête du chien, c’est la princesse Anne, la dernière fille de
Charles Ier, qui mourut en bas âge.Van Dyck, uniquement préoccupé de la ressemblance de ses modèles, s’inquiétait assez peu des artifices de composition employés par certains artistes pour mettre en valeur les personnages. Il avait trop de génie pour recourir à l’habileté. Il lui importe peu de risquer la monotonie en disposant les enfants royaux sur une même ligne; ce qui compte pour lui—pour nous aussi—c’est d’exprimer exactement la physionomie de chacun d’eux. Il est à peine utile de montrer avec quel bonheur il y a réussi, avec quelle intensité il a su peindre la vie sur ces jeunes visages insouciants, aux yeux limpides, que le malheur n’a pas encore effleurés et devant qui ne se dresse pas l’effroyable avenir qui les attend. Il y a déjà, dans ces petits corps à peine formés, cette naturelle aisance, ce suprême parfum d’aristocratie qui distingua toujours la noble race des Stuarts.
Van Dyck peut être considéré comme le roi des portraitistes. D’autres, comme Rembrandt, ont marqué leurs modèles de traits plus vigoureux et plus profonds; aucun peut-être n’a possédé au même degré cette netteté de lignes, cette certitude tranquille qui ne connaît pas la défaillance. Un portrait de Van Dyck peut être comparé à tous les autres de sa main, ils sont tous également supérieurs. Absorbé et souvent distrait par la luxueuse existence qu’il menait à Londres, il lui 61 fut impossible d’exécuter lui-même toutes les commandes dont on l’assaillait. Imitant l’exemple de son maître Rubens, il s’était entouré d’une pléiade d’élèves habiles, formés par lui, qu’il chargeait d’établir la plupart de ses portraits. Mais lorsque le portrait était campé, dégrossi, il le prenait dans ses mains puissantes et, en quelques touches rapides de son pinceau prestigieux, il lui donnait sa forme définitive, il le marquait de sa griffe géniale. Le portrait devenait un authentique Van Dyck.
Il n’en usait pas avec cette liberté quand il peignait le roi Charles, la reine Henriette ou les enfants royaux. Dans ces portraits, tout est bien de sa main; elle se révèle manifestement dans la précise clarté des paysages, dans la lumineuse profondeur des ombres, dans la distinction discrète d’un coloris toujours parfait.
«Le grand Flamand», comme on appelle généralement Van Dyck, a connu cette gloire de n’avoir eu aucun détracteur au cours des siècles. Il y a unanimité d’admiration autour de son œuvre. Reynolds, peintre de portraits lui aussi, le proclamait le plus grand portraitiste qui ait jamais existé et Gainsborough mourant se réjouissait dans l’espoir de retrouver Van Dyck au ciel.
Bien qu’il ait abordé avec une maîtrise égale les sujets mythologiques et religieux, Van Dyck demeure le roi incontesté du portrait et son œuvre lui a acquis une gloire immortelle et une place de premier plan à côté des plus grands noms de la peinture.
Les Enfants de Charles Ier figurent dans la partie de la “National Gallery” consacrée spécialement aux portraits.
Hauteur: 0.58.—Largeur: 0.99.—Figures grandeur demi-nature.
LOUIS DAVID
ÉLISA BONAPARTE
SALLE XVII.—ÉCOLE FRANÇAISE
65
Élisa Bonaparte
DES trois sœurs de Napoléon, Élisa, l’aînée, fut la plus
maltraitée du destin. Moins belle que Pauline et que Caroline,
elle eut encore la disgrâce de se voir déchirer par ses
ennemis, qui étaient nombreux: ils la disaient laide et de physionomie
revêche. Ses amis ne vantent point les charmes de son visage, mais
exaltent son esprit, son intelligence, sa perspicacité politique, sa ferme
volonté. Les uns et les autres s’accordent à constater sa très grande
ressemblance avec son frère Napoléon.
Examinons le portrait de David: tous les traits de l’illustre
capitaine s’y retrouvent. C’est le même menton volontaire et hardi, le
même regard froid, la même chevelure du «Corse aux cheveux
plats». Nous savons qu’Élisa n’était pas belle et nous pouvons croire
que David a fait effort pour adoucir la froideur du visage, mais en
dépit de tout, transparaissent la dureté des yeux et la hauteur un peu
insolente de l’attitude. Taillée en force, la tête posée sur un cou robuste
attaché lui-même à de solides épaules, elle apparaît ce qu’elle sera
toute sa vie: une femme opiniâtre, emportée dans ses exigences
comme dans ses passions. Le frais costume de jeune fille qu’elle porte
ne parvient pas à dissimuler cette rudesse native qui la rapprochait
du caractère de Napoléon. Celui-ci disait à Sainte-Hélène: «Dès son
enfance, Élisa fut fière, indépendante. Elle tenait tête à chacun de
nous. Elle avait de l’esprit, une activité prodigieuse.»Mariée à une époque où l’étoile de son frère commençait à peine 66 de briller, Élisa dut se contenter d’un obscur capitaine, Félix Bacciocchi, un Corse qui habitait Marseille, dans la même maison que la famille Bonaparte. Le ménage débuta dans l’indigence et il fallut que le jeune général de l’armée d’Italie envoyât trente mille francs pour mettre un peu d’aisance dans la vie des deux époux. Bien qu’il n’eût pas approuvé ce mariage, Napoléon, qui fut le meilleur des frères, servit de son mieux Bacciocchi, lui donna de l’avancement, des fonctions, et plus tard une couronne princière. Il fit plus encore pour sa sœur, il la débarrassa de son médiocre mari, dont elle rougissait, en l’envoyant occuper des emplois dans de lointaines ambassades.
Libre de tout lien gênant, Élisa élut domicile chez Lucien, qu’elle aimait plus que ses autres frères et qui venait de perdre sa femme. Elle y joua le rôle de maîtresse de maison et quand les brillantes fêtes que donnait Lucien reprirent leur cours, ce fut elle qui présida aux apprêts de ces nouvelles réceptions mondaines. Dans la société de ce frère préféré, où brillaient quelques hommes remarquables du monde des lettres et des arts, elle trouvait un charme qui lui semblait très doux. Son éducation à Saint-Cyr, avant la Révolution, les conversations de Lucien, ses propres lectures, tout ce passé la disposait aux jouissances intellectuelles bien plus qu’aux futilités dont se contentent les femmes. Elle se donna tout entière à ces plaisirs relevés et nobles avec la violence de sa nature. Dans ses salons se rencontraient tous les beaux esprits du temps: La Harpe, Boufflers, Esménard, Arnault, Andrieux, Joubert, Delille, Chateaubriand qui la proclamait «l’adorable protectrice des lettres et des arts», et surtout Fontanes, qui devint un peu plus que l’ami d’Élisa.
L’ambition politique ne lui vint que plus tard, lorsque Napoléon fut tout-puissant, mais elle s’empara d’elle tout entière. Elle cessa de jouer les pièces de Corneille dans le salon de Lucien et rêva de tenir des rôles plus conformes à son besoin de dominer. Les flatteries de son entourage avaient perverti son esprit et lui avaient inculqué une 67 présomptueuse assurance qui faussait son ancienne bienveillance, et les soirées de Neuilly n’avaient plus aucun attrait pour elle.
C’est avec ces sentiments absolus et ce caractère altier que, devenue princesse, elle gouverna la Toscane, dont Napoléon l’avait faite grande-duchesse. Elle essaya de se rendre populaire, mais sans y parvenir. Ses excentricités, le désordre de sa conduite privée, le faste insolent de sa cour, la dissolution dont elle était environnée, l’impiété qu’elle affichait, tout se réunissait pour éloigner d’elle le cœur de ses sujets. Quant au pauvre Bacciocchi, il traînait à la cour de sa femme une existence effacée et résignée, trop heureux lorsque de nouveaux scandales n’ajoutaient pas au ridicule de sa situation.
Telle est la femme dont David nous a laissé un si vigoureux et si éloquent portrait, demeuré à l’état d’ébauche on ne sait pour quelle raison. Tout le caractère de cette fantasque princesse y est déjà marqué en termes précis, avec une facture impressionnante et un art supérieur. Le coloris de ce tableau est un peu froid, comme l’était toujours le coloris du peintre, mais la tête est bien vivante et justifie la réputation, désormais consacrée, de David portraitiste.
Élisa Bonaparte figure dans la salle XVII consacrée à la peinture française.
Hauteur: 0.91.—Largeur: 0.73.—Figure grandeur nature.
J. CONSTABLE
FLATFORD MILL
SALLE XX.—ÉCOLE ANGLAISE
71
Flatford Mill on the river Stour
LE paysage représente un beau site de campagne, sur les bords
de la Stour, dans le riche comté de Suffolk. A droite, se
développent de vertes prairies éclairées par le soleil et
bordées par des rangées d’arbres. Le long de la rivière court le
sentier qui conduit au moulin de Flatford dont on aperçoit, dans le
fond, les bâtiments et les toitures rouges. Sur le cours d’eau se
meuvent des chalands qui viennent sans doute pour apporter le blé
à moudre ou remporter la farine. De minuscules personnages
s’occupent à la manœuvre ou vaquent à leurs occupations domestiques,
tandis que, sur le bord, un homme fixe une corde aux traits
d’un fort cheval chargé d’amener le chaland à la rive. A califourchon
sur le cheval et à demi retourné en arrière, un enfant suit d’un œil
intéressé les phases de l’opération. Tous ces personnages ne jouent
dans le tableau qu’un rôle épisodique, ils n’y tiennent pas plus
de place que dans les paysages de Claude Lorrain, mais ils
l’animent et l’égaient. Dans le ciel, de lourds nuages sont accumulés,
mais il reste encore assez de lumière pour éclairer la scène d’une
belle lueur, chaude et brillante.
Ce beau paysage compte parmi les meilleurs de Constable, le
plus grand paysagiste de l’Angleterre. La technique en est vigoureuse,
le dessin solide, la pâte nourrie, la couleur exacte et sobre. Les
plans successifs y sont supérieurement déterminés pour l’obtention
d’une irréprochable perspective et la lumière, ce protagoniste
72
essentiel mais difficilement saisissable de tout paysage, y joue son
rôle primordial: elle est partout dans ce tableau, largement épandue
sur la prairie ou discrètement insinuée dans les ombres des haies
qu’elle éclaire et réchauffe; elle s’accroche au faîte des branches, à
la cime des toits, à la tige des fleurs champêtres et colore de gaîté
l’atmosphère subtile qui court dans cette toile.La réputation de Constable comme paysagiste dépassa les frontières de son pays et sans doute aurons-nous l’occasion de signaler, dans de futures notices, l’influence considérable qu’il exerça sur notre école de 1830. Mais, en 1776, à l’époque où il vint au monde, les esprits et les âmes étaient, en Angleterre comme ailleurs, complètement fermés aux beautés de la nature. On ne la comprenait pas, on ne la supportait que comme accessoire dans un tableau, encore la fallait-il peignée, lustrée, élégante, pour servir de cadre à quelque bergerie ou d’écran à quelque personnage en habit d’apparat.
Né sur les bords de la Stour, Constable passa toute sa jeunesse en pleine campagne, à courir dans les champs, aux abords des moulins qui peuplaient la vallée. Comme il le dit plus tard lui-même: «Ce furent les scènes de mon enfance qui firent de moi un peintre.»
Dès son jeune âge, il sentit profondément la nature et désira la peindre. Il y fut encouragé par un ami qu’il s’était fait, un plombier-vitrier intelligent qui employait ses loisirs à brosser des paysages. Les parents du jeune homme songeaient à lui faire embrasser l’état ecclésiastique, mais ne se sentant aucun goût pour entrer dans les ordres, il préféra devenir apprenti meunier dans un de ces moulins qu’il aimait tant. Il n’y resta qu’un an, mais cette année passée en présence de la nature fit plus pour son talent que n’auraient pu lui apprendre tous les enseignements de l’Académie. Aux heures de loisir, il maniait le crayon et le pinceau avec une ardeur de néophyte. Sa famille ne voyait pas sans appréhensions le jeune Constable s’engager dans cette voie: «Mon fils, écrivait le père, 73 se destine à une bien misérable profession.» Lui-même eut des heures de doute. Quand il vint à Londres pour s’assurer «s’il avait des chances de réussir dans la peinture», il ne reçut aucun encouragement aux différentes portes où il frappa. Il était résigné déjà à abandonner son rêve quand il eut le bonheur, en 1799, d’être admis comme élève à l’Académie royale de peinture. A partir de ce jour, sa carrière est décidée, carrière toute de labeur et d’énergie, mais carrière presque obscure, que ne marque aucune distinction particulière. Paysagiste d’instinct, il se soumet volontairement à l’espèce de discrédit qui s’attache à son art. En 1802, il expose à l’Académie royale son premier tableau, sous le titre modeste: Paysage; il passe inaperçu. Il a alors 26 ans. A 43 ans, en 1819, il est élu membre adhérent de l’Académie royale et ne sera titularisé que dix ans plus tard. Son succès réel commence véritablement en 1824, avec son tableau célèbre: Hay Wain (La charrette de foin). Encore n’est-ce pas à Londres, mais à Paris que s’affirme sa réputation. Constable n’en est pas moins heureux d’hériter d’une petite fortune, car sa peinture ne suffit pas à le nourrir. Jusqu’à l’âge de 40 ans, il n’a pas réussi à vendre un seul de ses tableaux en dehors du cercle de ses amis. Et le phénomène tant de fois constaté se produit: ces paysages dont personne ne voulait à cette époque, on se les dispute aujourd’hui dans des enchères fabuleuses.
Le Flatford Mill (Moulin de Flatford) fut peint en 1817. Constable avait alors 41 ans. Dans cette admirable peinture se résument toutes les qualités de l’illustre paysagiste anglais, que Goncourt appelait le grand, le grandissime maître. Elle figure dans la salle XX, réservée à la peinture anglaise.
Hauteur: 1 m.—Largeur: 1.27.—Figures: 0.30.
GIOVANNI BELLINI
LE DOGE LORÉDAN
SALLE VII.—ÉCOLE DE VENISE ET DE BRESCIA
77
Le Doge Lorédan
GIOVANNI BELLINI et son frère Gentile Bellini avaient
appris la peinture dans l’atelier de leur père, Jacopo Bellini,
artiste vénitien de grand talent. Celui-ci, loin de jalouser ses
fils, se montra tout heureux quand il vit leur mérite éclipser le sien
propre. Il les encourageait avec tendresse, car, disait-il, «il faut que
Gentile dépasse Jacopo et que Giovanni l’emporte encore sur Gentile.»
L’avenir justifia la prédiction du père. Des trois Bellini, Giovanni
fut le plus grand et le plus habile en son art. A une époque où son pays
regorgeait d’artistes de talent, il eut la gloire, partagée avec Mantegna,
de présider en quelque sorte à la première renaissance de la peinture
en Italie; il fut le plus délicat et le plus distingué des maîtres. Venu
au monde en un temps où s’élaborait en Europe un mouvement
général d’affranchissement intellectuel et moral, il forma la transition
entre la froide tradition des maîtres ascétiques et le glorieux
épanouissement des Véronèse et des Titien; il fut le maillon qui souda
l’un à l’autre les deux tronçons de cette chaîne. Il conserva quelque
chose de la naïve conception et de l’hiératisme de ses aînés, mais sa
souplesse, sa largeur de dessin, sa vigueur de coloris annoncent déjà
une ère nouvelle, où ses élèves entreront d’un pas victorieux.Mais si, par sa technique, Bellini prépare la voie aux grands Vénitiens de la Renaissance, il reste fidèle, dans le choix des sujets, à la tradition qui lui fut transmise par les siècles. Il est le dernier peintre véritablement religieux de l’école vénitienne. Plus tard il traitera, pour 78 le compte du Conseil des Dix, des sujets relatifs à la vie nationale; mais s’il consent à abandonner ses Vierges et ses Maternités pour célébrer les fastes de la cité, il se refusera toujours à verser, comme Mantegna, dans le paganisme envahissant. Il verra ses jeunes émules ou ses élèves, comme Giorgione et Titien, peindre des églogues court vêtues ou glorifier les dieux et déesses de l’Olympe, sans que lui vienne la pensée de se mettre au goût du jour. Sur le déclin de sa longue vie, il accepte, après bien des atermoiements, une commande d’Isabelle d’Este pour un sujet profane et accepte même un acompte de 25 ducats sur la somme de cent ducats convenue pour le travail. Mais, quand il s’agit de s’exécuter, le vieux peintre temporise, cherche des prétextes, tantôt feignant la maladie, tantôt objectant ses travaux au Palais Ducal, tantôt se confinant à la campagne. Vianello, le représentant d’Isabelle à Venise, se désole, la duchesse se fâche et déclare «ne pouvoir supporter plus longtemps les étranges procédés de Bellini». Elle charge son agent de déposer une plainte contre le peintre entre les mains du doge Lorédan. Celui-ci aime Bellini, peintre officiel de Venise; il intervient officieusement et Bellini, de guerre lasse, répond: «J’ai là une Nativité presque terminée; si la duchesse veut bien l’accepter, j’en serai très heureux.» Et il la lui expédie avec une lettre d’excuses. Ce n’était pas tout à fait ce qu’avait désiré Isabelle d’Este, mais devant la beauté du tableau, tout son ressentiment s’évanouit et elle écrivit au peintre: «Votre Nativité m’est aussi précieuse qu’aucune autre de mes peintures.»
La renommée de Bellini s’était étendue bien au delà des frontières de l’Italie. Albert Dürer, quand il vint à Venise, se plut à le fréquenter et nous trouvons, dans les écrits du grand maître allemand, le témoignage d’une estime qu’il ne prodiguait pas, surtout aux peintres de la péninsule. «Tout le monde me dit, écrit-il, combien il est honnête et j’ai tout de suite été porté vers lui. Il est très vieux (Bellini avait alors quatre-vingts ans), mais il est encore le meilleur pour la peinture.» 79 Il serait difficile pour un peintre de souhaiter une plus glorieuse consécration.
Telle était sa réputation que le sultan Mahomet II, le vainqueur de Constantinople, désira se faire peindre par lui et le demanda à la République de Venise. On ne sait pour quelle raison, son frère Gentile fut envoyé en Orient à sa place. Sans doute, la Seigneurie tenait à conserver près d’elle un artiste qui était le premier de son époque et, de plus, son peintre officiel. Cette qualité comportait, avec une très belle rétribution, d’importantes prérogatives, entre autres celle d’exécuter ou de diriger toutes les peintures dans les palais de la cité, et celle de peindre les Doges au pouvoir. C’est donc à titre de peintre officiel qu’il peignit le portrait du doge Lorédan, que nous donnons ici.
Le premier magistrat de Venise est représenté dans le bizarre et somptueux costume de sa fonction. Sur sa tête est posé un bonnet étroitement serré, qui cache les cheveux et les oreilles et se relève en pointe par derrière. Il est vêtu d’une magnifique robe en soie brochée où se révèle le goût des Vénitiens du XVe siècle pour les belles étoffes. Mais la merveille, dans ce tableau, c’est la tête énergique et sévère du doge; l’œil dur, les lèvres minces et les traits accusés disent assez le caractère ombrageux et cruel qui poussa Lorédan à instituer l’Inquisition d’État et le Conseil des Dix, dont la terrible tyrannie fit trembler Venise pendant deux siècles.
Dans ce portrait, le dessin, le coloris et l’expression du caractère sont également admirables.
Le Doge Lorédan est posé sur un chevalet dans la salle VII, réservée aux écoles de Venise et de Brescia.
Hauteur: 0.61.—Largeur: 0.44.—Figure grandeur nature.
RUBENS
LE JUGEMENT DE PARIS
SALLE X.—ÉCOLE FLAMANDE
83
Le Jugement de Pâris
RUBENS a situé le célèbre épisode mythologique dans un
magnifique paysage agreste où les teintes dorées de l’automne
se marient à la rouge splendeur d’un ciel couchant. On serait
presque tenté d’oublier les acteurs principaux du drame devant la
prodigieuse habileté du peintre qui, en touches d’une vigueur
incomparable, recule sa perspective jusqu’aux plus lointaines
profondeurs de l’horizon. Quand Rubens s’avise d’aborder un genre,
quel qu’il soit, son œuvre se trouve immédiatement marquée de sa
griffe géniale; il se pousse du premier coup jusqu’aux plus hautes
cimes, il proclame en traits de feu son inégalable supériorité.
C’est dans ce prestigieux décor de nature que se déroulent les
phases de cette dispute célèbre dont les effets mirent le feu au
monde antique. On connaît la légende: Junon, Minerve et Vénus,
toutes les trois puissantes déesses de l’Olympe, prétendaient
également au sceptre de la beauté et cette éternelle rivalité, troublait
le séjour des dieux et divisait les immortels. Pour vider une querelle
que leurs pairs n’osaient pas juger, les trois déesses résolurent d’un
commun accord de s’en remettre au jugement d’un habitant de la
terre. L’arbitre choisi fut le jeune Pâris, second fils de Priam et
d’Hécube, le même qui, plus tard, ravit Hélène, femme de Ménélas.
C’est à cette scène du jugement que nous fait assister Rubens dans
son magnifique tableau.Assis sur une roche, au pied d’un arbre, Pâris tient à la main la 84 pomme qu’il décernera à la plus belle; il est lui-même bien digne de porter une telle sentence, car il possède la noblesse et la beauté d’un jeune dieu. Tout près de lui, debout, appuyé contre ce même arbre, Mercure, reconnaissable à son caducée, assiste à tous les détails de cette scène. Il paraît d’ailleurs plus amusé qu’anxieux. Par contre, aux pieds de Pâris, un énorme molosse est endormi, la tête allongée sur ses pattes, absolument indifférent à ce qui se passe autour de lui.
Et, devant leur juge, les trois déesses ont comparu, leur nudité splendide à peine voilée par les manteaux que soutiennent leurs mains. Voici Junon, reine des dieux, vue de dos, le bras droit replié soutenant un manteau de pourpre et tournant sa tête altière vers Pâris, en ayant l’air de revendiquer comme un droit de son rang le prix de la beauté. Sur ses pieds, le paon, son emblématique oiseau, étale sa large queue diaprée et soyeuse. Plus loin, Minerve, les bras relevés autour de sa tête brune, semble vouloir mettre en valeur tous ses avantages. A un arbre, derrière elle, sont accrochés ses attributs guerriers, le bouclier où figure une tête de Gorgone; le casque est posé à terre. Entre Minerve et Junon, se tient Vénus, fille de l’onde, en une pose pleine de modestie, les deux bras croisés sur la poitrine et regardant Pâris qui lui présente la pomme, signe de son triomphe. Tandis que l’attitude de Junon trahit la colère, et celle de Minerve le dépit, on lit sur le visage de la blonde déesse la surprise agréable de sa victoire sur ses deux rivales.
Ce jugement proclame Vénus déesse de la beauté, mais il ne termine pas le différend, il ne fait que l’envenimer. Sans s’en douter, Pâris amasse contre lui et sa race la rancune de deux puissantes divinités et son verdict coûtera à la famille de Priam la perte de Troie. Dès maintenant, nous avons comme un présage de tous les maux qui se préparent: dans le ciel apparaît une sorte de furie échevelée brandissant la torche de l’implacable discorde.
85 Tout est admirable dans ce tableau. Nous avons dit la beauté du paysage, il nous reste à signaler l’harmonieux équilibre de la composition où tout est disposé supérieurement pour répartir l’intérêt. Rubens s’est joué comme à l’habitude de la difficulté; il y a déployé une merveilleuse fécondité d’invention et l’ensemble de l’œuvre est éclatant, superbe, fastueux.
Ce qu’il convient de noter, c’est la conception toute particulière qu’a Rubens de la beauté féminine. Regardez les trois déesses: le peintre a traduit à la flamande la beauté grecque des Olympiens. Ces nobles formes étaient trop pures et trop tranquilles pour son pinceau turbulent; il les a mouvementées, arrondies, soufflées, bossuées de muscles, mais par la couleur il leur a conservé la divinité. C’est bien la chair des dieux, pétrie d’ambroisie et de nectar; rose comme la pourpre royale, blanche comme la neige de l’Olympe. Le torse de la Vénus semble fait avec des micas de Paros et des étincelles d’écume. Jamais la peinture n’a été plus loin pour le rendu de la chair, le grain de l’épiderme et le frisson mouillé de la lumière.
Le Jugement de Pâris figure dans la salle X, consacrée à la peinture flamande et hollandaise.
Hauteur: 1.44.—Largeur: 1.90.—Figures: 0.65.
ROMNEY
UNE DAME ET SON ENFANT
SALLE XIX.—VIEILLE ÉCOLE ANGLAISE
89
Une dame et son enfant
ON pourrait appeler Romney le Nattier de la peinture anglaise.
Comme le maître français, il fut le portraitiste préféré des
femmes, parce que, comme lui, il sut les parer de tous les
charmes, même quand la nature s’était montrée le moins indulgente
pour elles. Nul pinceau ne fut plus conciliant, plus flatteur, plus habile,
car il joignait à son art d’embellir celui, plus difficilement réalisable,
de faire ressemblant. Sous des apparences manifestement avantagées,
ses modèles les plus disgraciés se reconnaissaient et, qui plus est, on
les reconnaissait.
Aussi, la vogue dont jouissait Romney à Londres s’égalait à celle
de Reynolds et de Gainsborough. Toute la «gentry» anglaise se
pressait à son atelier de Cavendish Square. Il était parvenu presque
sans effort, par un heureux concours de circonstances, à ce degré de
réputation. Sa bonne étoile avait guidé sur la voie glorieuse l’apprenti
menuisier de Beckside. Lorsqu’il parut à Londres, venant de sa
province, il n’avait que le goût du dessin, avec peu de science. Son
maître, un certain Steele, n’avait qu’une valeur médiocre et le jeune
artiste en tira tout ce qu’il put, c’est-à-dire bien peu de chose. Mais il
comprit combien il serait hasardeux de tenter la fortune avec un aussi
mince bagage technique, et sa résolution fut vite prise: il alla apprendre
son métier en Italie, au contact des maîtres. Rien ne le retint en
Angleterre, pas même sa famille. Avec une belle désinvolture, qui fait
plus honneur à son esprit de décision qu’à ses qualités de cœur, il
90
abandonna sa femme et ses enfants. Il ne revint pas auprès d’eux
à son premier retour d’Italie, mais il continua à mener une
existence vagabonde et décousue, courant de ville en ville, et vivant de
portraits qu’il exécutait au rabais et que son énorme facilité lui
permettait de brosser en quelques heures. Son voyage en Italie l’avait
enthousiasmé; il y revint et, cette fois, il semble qu’il en ait retiré
plus de fruits. Il s’adonna surtout à l’étude de Raphaël et du Corrège,
ses idoles, et lorsqu’il revint, il se trouva complètement armé pour lutter
avec ses grands rivaux.Dans l’incertitude des premières années, Romney semble indécis sur la voie qu’il suivra. Quelques succès dans le genre historique tendent à l’incliner vers la grande peinture, mais au fond, c’est le portrait qui le sollicite, c’est à la gloire de Reynolds et de Gainsborough qu’il rêve de participer. La première œuvre qui fixa sur lui l’attention du public fut le superbe portrait de Mrs. Yates, en muse tragique; il amena le déclenchement subit du succès. Mais il eut surtout le bonheur de rencontrer sur sa route un de ces rares modèles comme en rêvent tous les peintres: Emma Lyons. D’origine plus que modeste, successivement servante d’auberge et figurante dans les petits théâtres londoniens, Emma Lyons possédait une éblouissante beauté blonde qui fut bientôt célèbre en Angleterre. Cette beauté et l’absolue perfection de son corps la firent choisir par le docteur Graham pour personnifier l’image de la santé, dans une de ses séances publiques. C’est à l’une de ces séances que Sir William Hamilton, ambassadeur d’Angleterre à Naples la vit et s’en éprit. Il l’épousa, l’emmena avec lui en Italie où elle devint l’amie de la reine Caroline et où s’ébaucha le célèbre roman d’amour avec Nelson. «Les traits de la belle Emma, écrit le poète Hayley, exprimaient, comme le style de Shakespeare, tous les sentiments de la nature et toutes les gradations de chaque passion, avec la vérité la plus fascinatrice. Elle exerçait par sa physionomie éloquente un empire prodigieux, que Romney avait du 91 bonheur à observer, et au travers des vicissitudes étonnantes de sa destinée, elle fut toujours fière de lui servir de modèle.» D’autres aussi firent son portrait: Hoppner, Lawrence, Gainsborough, Reynolds, mais Romney interpréta sous des formes multiples sa triomphante beauté. Il fut d’ailleurs toujours le peintre des femmes.
Quelle est cette jeune mère que nous reproduisons ici, serrant amoureusement son enfant dans ses bras? Il nous est impossible de le dire: c’est évidemment une de ces nombreuses dames de la société qui tenaient à être peintes par le portraitiste à la mode. Elle est d’ailleurs charmante, cette jeune femme, dans son attitude de repos et plus charmante encore, la mignonne fillette pelotonnée sur le sein maternel. Il y a de la tendresse, de la pensée, de la vie, dans cette précieuse toile; il y a aussi et surtout cette supérieure entente du coloris qui fait de Romney l’un des meilleurs portraitistes anglais, après Reynolds et Gainsborough.
Une dame et son enfant fut légué à la “National Gallery”, en 1898, par le général J. Julius Johnstone; il figure aujourd’hui dans la salle XIX, réservée à la vieille peinture anglaise.
Hauteur: 0.89.—Largeur: 0.69.—Figure grandeur nature.
NICOLAS POUSSIN
BACCHANALE
SALLE XVI—ÉCOLE FRANÇAISE
95
Bacchanale
LA scène se déroule dans un de ces décors antiques dont Poussin
trouvait les modèles dans la campagne romaine. On est tellement
accoutumé à admirer la belle ordonnance des groupes
du grand peintre français, la pureté classique de ses personnages
que trop souvent on oublie à quelle hauteur il a porté l’art du
paysage. Il est vrai que bon nombre de ses tableaux ont souffert
de l’action des siècles; du fond de ses toiles le bitume est fâcheusement
remonté et noie son décor et parfois même son sujet dans
une sorte de pénombre livide. Mais dans celles qui ont eu le
bonheur de rester intactes, le paysage apparaît, plein de fraîcheur et
de clarté, baigné d’une atmosphère diaphane. Voyez le paysage de la
Bacchanale: il n’est, certes, qu’une partie bien secondaire du
tableau, mais avec son habituelle conscience, Poussin l’a soigné autant
que le tableau lui-même. La perspective s’enfuit, par gradations
savantes, jusqu’aux extrêmes confins de l’horizon, où ondulent les
collines bleues. Poussin, scrupuleux ouvrier du pinceau, n’admettait
pas le laisser-aller trop commun parmi les artistes de son temps.
Honnête homme dans la plus noble acception du terme, il a horreur
de ces fa-presto sans conscience et il les accable d’injures, les
appelant des bœufs, des bêtes, des boucs, et il s’indigne des prix
qu’ils réclament pour leurs «barbouilleries» et de leur voir, avec
si peu d’assiduité au travail «des mains de harpies». Ce n’est
pas ainsi que travaille le grand artiste. Enfermé dans son atelier,
96
il s’abîme dans son œuvre, cherchant toujours le mieux, craignant
sans cesse de n’avoir pas assez poussé sa toile. Il passe parfois cinq
jours à finir une main; certaines figures lui demandent huit jours
d’efforts. Et telle est la supériorité de son art, que tout ce pénible
travail ne s’aperçoit pas et que ses tableaux les plus laborieusement
exécutés paraissent le fruit dune inspiration soudaine, jaillie spontanément.
Est-il rien qui paraisse plus naturel, plus franc, plus primesautier
que cette Bacchanale? Ces groupes animés dans l’action de la ronde
ont-ils l’air d’avoir été cherchés, étudiés, réglés minutieusement dans
leurs moindres attitudes? Non, certes. Tout cela est d’une verve,
d’un mouvement qui surprend chez l’austère Poussin.Au pied d’un arbre aux branches ombreuses, une compagnie de Faunes prend ses ébats avec les Nymphes de la forêt voisine. Couronnés de feuillage et sans doute excités par la boisson, ils entraînent dans la danse deux jeunes femmes qui semblent occupées de tout autre chose que de la ronde. L’une d’elles, vêtue de bleu, se détourne à moitié et, de sa main demeurée libre, exprime le jus d’une grappe dans une écuelle que lui tend un petit Amour. L’autre s’intéresse à la querelle qui vient de s’élever à côté d’elle. A la droite du tableau, un Faune entreprenant a renversé sur l’herbe une superbe Nymphe qui se défend, moitié rieuse, moitié fâchée, contre ses audacieuses caresses. Et sans doute succomberait-elle, si l’une de ses compagnes n’accourait à son secours, en saisissant le Faune par les cheveux et en brandissant une amphore au-dessus de sa tête. Sur une stèle, le vieux Silène assiste à cette scène en ricanant.
Dans ce magnifique tableau, on ne sait ce qu’il faut le plus admirer, de la beauté de la composition ou du charme du détail. L’intérêt s’y trouve harmonieusement réparti; tout y est mouvement, mais un mouvement eurythmique qui n’enlève rien à la pureté des 97 formes ou au naturel des attitudes... Dans les corps de Poussin, tout est anatomiquement vrai et magnifiquement beau: l’art ancien n’a rien produit de plus parfait que les torses des Faunes danseurs et les femmes, sans rien perdre de leur naturel, étalent des formes sculpturales. La Nymphe étendue à terre, notamment, est d’une pureté de lignes digne de la statuaire grecque.
Et quelle fantaisie charmante dans le petit groupe des Amours! Quelle vérité dans l’effort de celui qui tend son bras pour recueillir le vin dans son écuelle et avec quel mouvement naturel il se défend contre son camarade! Quel geste aussi, charmant et si exactement étudié, de celui qui tente de l’écarter en lui passant un croc-en-jambe! C’est également une trouvaille heureuse que cet Amour, étendu à terre, qui dort la tête enfouie dans ses menottes.
D’autres ont eu des dons plus brillants que Poussin, une palette plus chatoyante, aucun peut-être n’est arrivé à produire des œuvres aussi parfaitement conçues et exécutées: il a victorieusement démontré que l’étude et la probité, joints à la recherche constante du vrai, peuvent parfois suppléer au génie.
La Bacchanale se trouve dans la salle XVI, consacrée à l’école française. Elle est passée à la “National Gallery” en 1824, avec la collection Angerstein.
Hauteur: 0.99.—Largeur: 1.42.—Figures petite nature.
PINTURICCHIO
LE RETOUR D’ULYSSE
SALLE VI.—ÉCOLE OMBRIENNE
101
Le Retour d’Ulysse
APRÈS vingt années de fidèle attente, Pénélope voit grandir
à l’horizon, puis entrer dans le port d’Ithaque, la galère
d’Ulysse, son royal époux. La légende est connue: Homère
l’a immortalisée. Ulysse, parti au siège de Troie avec l’armée des
Grecs pour y venger l’injure faite à Ménélas, s’y distingua par sa
sagesse dans les conseils, par sa bravoure dans les combats. C’est à
lui que revient l’honneur du fameux stratagème qui fit tomber Ilion
aux mains des alliés, après neuf ans d’inutiles efforts. La ville prise,
les Grecs mirent à la voile pour le retour; mais Ulysse, séparé du reste
de la flotte par la tempête, erra avec les siens sur toutes les mers
pendant onze ans encore, poursuivi par des divinités hostiles et
commença cette extraordinaire série d’aventures dont Homère nous
a laissé le prodigieux récit.
Pendant ce temps, Pénélope, la fidèle épouse, se consumait au
foyer, tourmentée par sa douleur, harcelée par les intrigants qui
rêvaient de régner sur Ithaque en obtenant sa main. Désireuse de
conserver la couronne à son fils Télémaque, Pénélope usait de
subterfuges pour écarter les soupirants sans les pousser à la révolte.
D’ailleurs, avertie par les secrètes lumières de son cœur qu’Ulysse
reviendrait un jour, elle imagina, non moins habile que son époux,
un artifice qui devait lui donner le repos. Convoquant devant elle ses
soupirants, elle leur signifia qu’elle accepterait un autre époux le
jour où elle aurait terminé une tapisserie destinée à servir de suaire
102
au vieux roi Laerte, son beau-père. Et, de ce jour, elle s’installa
devant son métier, tendant les fils, activant la navette et paraissant
hâter l’ouvrage quand les ambitieux prétendants la venaient visiter.
Mais, la nuit, elle défaisait le travail de la journée et les années
passèrent sans que fût achevée la tapisserie, jusqu’au jour où Ulysse,
revenu, lui ramena la tranquillité avec le bonheur.C’est le moment où le roi d’Ithaque, débarqué de sa galère, pénètre dans l’appartement de sa femme, toujours assise devant son métier, que le peintre a choisi. Avec quelle grâce et quelle charmante naïveté il a interprété cette rencontre émouvante, avec quel admirable mépris de la vraisemblance il a situé son sujet et disposé ses personnages! Le roi d’Ithaque, vêtu dans le goût du plus pur XVe siècle, coiffé d’un petit toquet rouge d’où s’échappent de magnifiques cheveux blonds, n’a pas l’air d’un homme qui vient de courir les plus grands dangers et de vivre les plus dramatiques aventures. Loin d’être un vaillant guerrier vieilli par vingt années d’absence, il apparaît frais, coquet, avec tous les dehors de la jeunesse, comme s’il avait quitté d’hier la douce et fidèle Pénélope. Celle-ci n’est pas moins agréable à regarder; c’est une jeune et superbe femme blonde sur qui les longues angoisses éprouvées ne semblent pas avoir laissé de traces. Elle est encore assise à son métier pendant qu’Ulysse, plein de joie, accourt vers elle. Assise sur le dallage polychrome de la chambre, une servante arrange des fils dans une boîte tandis qu’un chat joue avec une pelote tombée par mégarde. Au-dessus de la tête de Pénélope sont accrochés le carquois et l’arc d’Ulysse, cet arc que nul homme dans le royaume n’était capable de bander. Par la fenêtre grande ouverte s’aperçoivent les maisons d’Ithaque, la mer bleue et la haute galère qui vient de ramener l’époux.
Il n’y a pas que de la naïveté dans ce tableau du Pinturicchio; des qualités de premier ordre s’y affirment. Ce qui distingua le peintre d’Alexandre VI, c’est le mouvement dont il animait ses toiles, la 103 fraîcheur et la distinction des coloris, la fermeté d’un dessin qui laisse déjà pressentir Raphaël. Il ne faut pas juger de tels peintres par comparaison, mais se reporter à l’époque où ils vécurent, examiner les moyens dont ils disposèrent; et alors on reste confondu de la variété, de l’imagination et de la science relative dont ils firent preuve.
Benardino Betto, dit le Pinturicchio, était né à Pérouse, en 1454; il fut l’élève de Pérugin qui, ayant démêlé ses grandes dispositions pour la peinture, l’employa, avec Ghirlandajo, Botticelli et Cosimo Roselli, à la décoration de la chapelle de Sixte IV, au Vatican. De la Sixtine, le doux et élégant Ombrien met, par intervalles inégaux, son art charmant au service des cardinaux de la Rovère et Cebo, dont il décore les palais. Innocent VIII l’emploie aussi, mais sa plus grande part de gloire et son œuvre la plus importante, il les doit au pape Borgia, ce pontife décrié mais artiste, capitaine espagnol parvenu, par la plus invraisemblable fortune, jusqu’à la chaire de Pierre. On raconte que Pinturicchio, qui fréquentait l’Albergo dell’ Orso, y rencontra César Borgia, le fils du pape, qui devint par la suite aussi célèbre que son père. Une amitié solide lia les deux jeunes gens, et César amena son compagnon de plaisirs au redoutable pontife, qui lui confia la décoration de l’appartement des Borgia, au château Saint-Ange. C’est l’œuvre capitale de Pinturicchio; il y a déployé toutes les ressources de sa brillante imagination, de son étourdissante fantaisie, de sa profonde science du coloris. Raphaël, qui s’y connaissait, s’émerveillait toujours devant cette œuvre grandiose et charmante.
Le Retour d’Ulysse est une fresque transportée sur toile. Elle fait partie de l’ancienne collection de la “National Gallery” où elle figure dans la salle VI, réservée à l’école ombrienne.
Hauteur: 1.24.—Largeur: 1.46.—Figures: 1.05.
REMBRANDT
PORTRAIT DE DAME AGÉE
SALLE X.—ÉCOLE HOLLANDAISE
107
Portrait de Dame âgée
LA “National Gallery” possède vingt-deux toiles de Rembrandt,
elles sont toutes de premier ordre. Qu’il s’agisse de scènes
religieuses, de sujets mythologiques ou de portraits, la manière
fougueuse et puissante de l’illustre maître s’y manifeste avec une égale
supériorité. Tel est le génie de ce géant de la peinture qu’il traite avec
la même sublimité d’exécution l’Adoration des Mages, la Femme
adultère et l’idyllique groupe de ses Femmes au bain. Quant à ses
portraits, ils demeurent, avec ceux du Titien, peut-être même avant
eux, comme la suprême expression de l’art de peindre.
Quel magnifique chef-d’œuvre que ce portrait de Dame âgée!
Et quelle intensité de vie dans ces traits ravinés par le temps et
sillonnés de rides! Quelle pensée dans ces yeux éclairés d’intelligence
et de bonté! Ce visage a le relief de la sculpture, il semble qu’on a
véritablement devant soi une personne en chair et en os, dont les
lèvres vont s’ouvrir pour parler.Il est superflu, quand on parle de Rembrandt, de s’attarder aux éloges. Les siècles, dans leur unanime admiration, ont épuisé le vocabulaire des dithyrambes et, devant de pareilles œuvres, on n’a d’autre ressource que d’admirer en silence. Tout a été dit—et combien éloquemment—par d’éminents critiques, sur Rembrandt dessinateur et coloriste; on a célébré sur tous les tons le magistral emploi qu’il fit du clair-obscur, formule d’art qu’il n’a pas inventée mais qu’il porta à une hauteur jamais atteinte après lui. Il fut, sans 108 contredit, le plus merveilleux manieur de lumière qu’ait connu le monde; à son gré il en joue, la faisant tour à tour briller en notes éclatantes ou l’épandant parmi les ombres les plus opaques pour les animer et les faire vibrer.
Cet art incomparable, nous le retrouvons dans ce portrait de vieille dame où, en quelques touches vigoureuses et heurtées, Rembrandt exprime avec un rare bonheur les rides profondes et les méplats séniles. Quelques traits de pinceau, et le visage s’illumine de clartés, les ombres se dessinent fortement et la lumière qui se joue sur le front et le nez accuse énergiquement le caractère du modèle.
Dans la série des coloristes, le peintre de la Ronde de Nuit a trouvé une gamme nouvelle. Il semble qu’un vernis d’or, pareil à ces tons fauves de harengs saurs qui font l’effet d’être glacés de bitume sur du paillon, ait légèrement enfumé ses toiles. Dans ses plus grandes vigueurs, Rembrandt n’est jamais noir. Une chaleur rousse circule sous ses obscurités et les rend transparentes. Le peintre le plus sombre est celui qui a le plus de lumière. Amsterdam, grâce à Rembrandt, peut lutter avec Venise, et les deux villes dont les pieds baignent dans les canaux sont les reines de la couleur.
Cette peinture qualifiée de «surhumaine» par Raphaël Mengs, hachée d’éclairs et de ténèbres, fait invinciblement penser à la vie même de Rembrandt qui fut le plus glorieux et le plus infortuné des hommes. Son existence nous offre l’émouvant et terrible spectacle d’un génie s’écroulant, du faîte de la richesse, dans la plus noire misère. Sans doute il fut le premier artisan de son infortune. Prodigue et fastueux, il dépensait sans compter des sommes considérables; son atelier regorgeait de meubles précieux, de tapisseries rares; il achetait à sa femme Saskia un collier de perles qui valait une fortune; il payait au poids de l’or des tableaux de Rubens et un album de dessins de Lucas de Leyde. La formation de sa collection, sa vie large et imprévoyante, entretenue par les marchands, 109 commencèrent le désastre, malgré qu’il eût plus de commandes qu’il n’en pouvait exécuter. La mort de sa femme, qu’il adorait, émoussa sa force de résistance et bientôt il lui fut impossible de lutter contre le flot montant de ses dettes. Dans le même temps, son indépendance d’esprit et la façon dont il menait son existence indisposèrent contre lui les rigides bourgeois d’Amsterdam et les commandes de portraits s’espacèrent. Sa fidèle servante, devenue sa femme, essaya héroïquement de faire face à la ruine menaçante; elle mourut à la peine, laissant une douleur de plus dans le cœur du pauvre artiste. Malgré cette suite d’infortunes, Rembrandt s’acharne à son labeur, accumulant chefs-d’œuvre sur chefs-d’œuvre pour apaiser la meute hurlante des créanciers. Mais, à son tour, il doit plier sous les coups du destin; sa maison est vendue aux enchères et il meurt dans le dénûment le plus complet. On dépensa treize florins pour les obsèques de ce génie qui a laissé au monde six cents toiles immortelles.
L’injustice du sort s’acharna sur Rembrandt, même après sa mort. Pendant longtemps ses œuvres furent méconnues, pis même, oubliées; le silence se fit sur son nom. Mais la revanche a été éclatante: Rembrandt est aujourd’hui considéré comme l’un des plus grands génies que le monde ait connus.
Le portrait de Dame âgée fut acquis en 1899, à la vente de la collection Saumarez, pour 187.125 francs; il figure aujourd’hui à la “National Gallery”, dans la salle X, réservée à la peinture hollandaise.
Hauteur: 0.68.—Largeur: 0.53.—Figure grandeur nature.
LE CORRÈGE
MERCURE INSTRUISANT CUPIDON
SALLE IX.—ÉCOLE LOMBARDE
113
Mercure instruisant Cupidon
MERCURE, fils de Jupiter, est assis sur un tertre de gazon;
tout son costume se borne à son casque, à ses sandales et à
un pan de manteau bleu qui ne cache rien de sa parfaite
anatomie. Son corps est une merveille de force élégante, comme il
convient à un dieu qui a pour mission de porter aux confins de la
terre les ordres du maître de l’Olympe. Mais ce robuste messager est
en même temps le dieu de l’éloquence: Corrège a tenu à le bien
indiquer en lui prêtant une physionomie ouverte et intelligente; il
nous le montre dans son rôle d’Olympien cultivé: dans sa main
gauche il tient un papier sur lequel Cupidon, très attentif, s’efforce
d’épeler les mots en suivant les lignes avec son doigt. Tout le corps
du jeune dieu de l’amour trahit l’effort: sa blonde tête ébouriffée est
appliquée vers le papier, les jambes et les ailes se contractent dans
un mouvement très naturel de tension.
Debout à côté du maître et de l’élève, Vénus, déesse de la beauté,
assiste à cette scène charmante. S’y intéresse-t-elle vraiment? On ne
saurait le dire, car le sourire de ses yeux et de ses lèvres semble
porter plus loin que le groupe de Mercure et de son fils. Quoi qu’il en
soit, jamais Corrège n’a peint un plus magnifique corps de femme.
Dans cet incomparable chef-d’œuvre, Vénus est elle-même un chef-d’œuvre
surprenant et réalise la perfection de la beauté féminine. Les
plus grands artistes n’ont rien produit qui égale cet inoubliable
morceau de peinture. Dans la tête auréolée de cheveux blonds
114
bouclés et retombants, il y a de la grâce, de la finesse, de la noblesse
et de la naïveté. De même que Léonard excellait à donner à ses figures
de femmes un caractère énigmatique, Corrège excellait à imprimer
aux siennes un je ne sais quoi de chaste et de puéril qui nous les fait
aimer dès le premier regard. Quant aux lignes du corps de la Vénus,
elles sont d’une perfection «à dissuader de jamais toucher un
pinceau», suivant le mot d’Annibal Carrache.Le coloris est celui du Corrège, c’est-à-dire du plus étonnant magicien dans l’art de poser et de distribuer les couleurs. Les chairs sont palpitantes de vie, ambrées, dorées; et cela, avec une simplicité de moyens, une sobriété de touche qui n’ont jamais été égalées. Des frottis légers, à peine perceptibles, et voilà des ombres lumineuses qui s’indiquent, des raccourcis prodigieux qui se dessinent. Aucune habileté douteuse, aucune ficelle de métier ne diminue cet art loyal où tout est net, précis et noble. Raphaël Mengs proclamait que Corrège avait rendu, mieux qu’aucun autre maître, l’illusion des corps; et cette observation est parfaitement vraie. Il suffit de voir le tableau que nous donnons ici, l’Antiope du Louvre et la petite Madeleine du musée de Dresde, pour reconnaître qu’aucun peintre n’a modelé les formes avec autant de vérité.
Ce qui ajoute, s’il est possible, à la gloire du Corrège, c’est que ce génie s’est épanoui spontanément, s’est développé tout seul, à Correggio, dans une bourgade obscure du duché de Modène. On ne lui connaît pas de maître ou, s’il en eut, il ne tarda pas à les surpasser. Jamais il n’alla à Rome, bien qu’on l’ait prétendu. «S’il était allé à Rome, affirme Vasari, il est aisé de voir qu’il y eût fait des merveilles et causé bien des soucis à ceux qui y brillaient dans son temps.» Ceux-là s’appelaient Raphaël, Michel-Ange, Jules Romain. Tandis que Raphaël, entouré de ses disciples, étale aux yeux des Romains le luxe d’un prince suivi de sa cour, tandis que la République de Venise, François Ier, Léon X et Charles-Quint se disputent le 115 Titien, Corrège, son émule, vit et meurt sans gloire, n’ayant d’autres Mécènes qu’un petit prince lombard et quelques moines ignorants. Timide et mélancolique, homme de sentiment, amant désintéressé de l’art, génie créateur au suprême degré, il ne demandait rien à ses contemporains que des toiles pour y faire naître ses madones, ses saints, ses martyrs, ses gracieux enfants, ses Vénus et ses Lédas; des murs pour les couvrir de fresques aux feuillages semés de fruits, de fleurs, d’oiseaux éclatants; des coupoles de cathédrales où son génie pût évoquer toute la milice chrétienne, les docteurs, les vierges, les armées de chérubins qui peuplent le ciel. Car ce génie a été le plus souple, le plus varié, le plus universel dont l’histoire fasse mention.
Si les contemporains ne rendirent point à Corrège toute la justice due à son génie, la postérité n’a pas tardé à le placer à la tête des maîtres qui ont reculé les bornes de l’art. Nul peintre n’a suscité des enthousiasmes plus sincères, des admirations plus passionnées. «O maître, c’est toi seul que j’aime!» s’écriait Annibal Carrache, devant son Saint Jérôme. Tous les siècles ont eu pour Corrège les yeux de Carrache; il plane aujourd’hui à l’empyrée de l’art.
Mercure instruisant Cupidon a malheureusement subi de maladroites restaurations. Acquis par Charles Ier avec la collection du duc de Mantoue (1630), il appartint ensuite au duc d’Albe. En 1801, il est entre les mains de Godoï, le prince de la Paix, puis passe dans celles du roi Murat. Cette peinture appartenait au marquis de Londonderry quand elle fut achetée, en 1834, par le gouvernement anglais. Elle figure aujourd’hui à la “National Gallery”, dans la salle IX, réservée à l’école lombarde.
Hauteur: 1.54.—Largeur: 0.91.—Figures grandeur dem.-nature.
TURNER
ULYSSE S’ÉLOIGNANT DE POLYPHÈME
SALLE TURNER.—ÉCOLE ANGLAISE
119
Ulysse s’éloignant de Polyphème
TURNER! écrit M. Armand Dayot, nom magique qui, comme
ceux de Rembrandt, du Lorrain, évoque tout un monde
de lumineuse féerie et d’Arcadies éblouissantes! Œuvre de
lumière et de rêve due au pinceau du plus inspiré des visionnaires!
Œuvre sacrée aussi dans son apaisante ou tumultueuse beauté! Car
telle est la douce et caressante magie du paysage de Turner, qu’on
le contemple avec une mélancolie nostalgique comme un paradis
perdu; et on se surprend à remercier avec émotion le puissant
artiste qui a su nous arrêter au milieu des durs chemins de la vie,
pour nous faire un moment retourner la tête vers les pays bienheureux
où nous avons tant rêvé de vivre que nous croyons parfois
y avoir vécu.»
C’est bien vers des régions chimériques et prodigieuses que nous
conduit Turner, sur la galère dorée du roi d’Ithaque. L’immortel poème
d’Homère s’évoque tout entier devant nos yeux ravis et ces terres
fabuleuses nous apparaissent encore plus étonnantes dans l’éblouissante
parure dont le peintre les a revêtues. Et nous éprouvons une
jouissance profonde à contempler ces ciels d’une irréelle splendeur,
et ces flots d’un azur comme aucun œil humain n’en a jamais vu.La scène représentée ici nous transporte dans le légendaire royaume des Cyclopes. Dans la demi-lumière d’une nuit combattue par l’aube naissante s’aperçoit, à gauche, la masse abrupte d’un rivage tourmenté et hérissé de rocs. Par places s’enlèvent sur la mer 120 d’étranges rochers qu’une formidable convulsion volcanique semble avoir vomis des entrailles du gouffre. Au bas de la falaise flamboie dans une grotte le feu qui servit à rougir l’épieu avec lequel Ulysse vient de crever l’œil de Polyphème, vengeant ainsi ses compagnons dévorés par le Cyclope. Au haut de la montagne, le géant aveuglé tord ses membres énormes sous l’action de la douleur et de la rage impuissante; on aperçoit dans la poussière brillante du matin son corps étendu et sa tête appuyée sur la main gauche. Au premier plan, la galère royale se balance mollement sur l’onde calme et s’apprête à quitter l’inhospitalière et tragique contrée. La manœuvre s’active; les rames se soulèvent, les marins grimpent au haut des mâts pour déployer les voiles. L’une d’elles flotte déjà dans la brise matinale avec une bannière où s’inscrit le nom d’Ulysse, en lettres grecques. Sur l’autre voile est représentée la guerre de Troie et le cheval fameux. A droite du tableau, le reste de la flotte tourne également ses proues vers la haute mer. L’armée du roi d’Ithaque va partir vers de nouvelles aventures. Et dans le fond, l’astre du jour, sortant du flot, chasse les dernières ombres de la nuit et illumine l’horizon de ses feux pourpre et or.
Nous avons assez longuement décrit le sujet de ce tableau pour en faciliter la compréhension, bien que, dans les œuvres de Turner, le sujet lui-même importe peu. Ce qui compte vraiment, c’est la prodigieuse manière dont le peintre joue avec la lumière, c’est la fantasmagorique splendeur de ces tons vibrants, éclatants, chargés de soleil et de couleurs insoupçonnées avant lui. Celui-là fut véritablement un magicien, mieux que cela, un créateur, car il a doté la peinture d’une forme d’art toute nouvelle, absolument à lui, tellement à lui que tous ceux qui essayèrent de l’imiter tombèrent aussitôt dans l’incohérence et l’anarchie des tons. Turner restera dans l’histoire de l’art comme le plus génial des coloristes. Avant lui, Claude Lorrain s’était fait le traducteur des aurores brillantes, avec 121 un goût peut-être plus certain, mais avec moins de virtuosité et de richesse. Turner, il faut le dire, n’est pas toujours également inspiré et trop souvent sa profusion de lumière tourne au vertige, ressemble presque à de la folie. Mais jusque dans ses toiles les plus extravagantes, il est des détails par où s’impose malgré tout l’admiration.
«Ce peintre de génie, cet incomparable poète du ciel et des eaux, ce puissant évocateur de la beauté antique dans les plus merveilleux décors de rêve, était grossier de manières, commun de visage, taciturne et presque toujours sordidement vêtu. Son avarice était proverbiale et les histoires qu’on raconte de son âpreté au gain sont nombreuses. Ce qui ne l’empêcha pas de léguer par testament à son pays natal toute sa fortune et tous ses tableaux: don plus que royal. Ce testament spécifiait que l’État pourvoirait à l’aménagement convenable des tableaux et que la plus grande partie de l’argent serait destinée à la fondation d’une institution de bienfaisance pour les artistes pauvres.»
«La fortune de Turner était estimée à 3.500.000 francs. Après de longues discussions entre l’État et la famille de l’artiste qui attaqua le testament, il fut décidé en fin de compte que toutes les œuvres terminées ou non, peintures, dessins, esquisses, appartiendraient à l’État, et que son parent le plus proche hériterait de sa collection d’œuvres gravées et autres propriétés.» (Armand Dayot).
Se conformant au vœu de l’artiste, l’État a aménagé dans la “National Gallery”, une salle spéciale, appelée salle Turner, dans laquelle figure aujourd’hui le magnifique tableau d’Ulysse s’éloignant de Polyphème.
Hauteur: 1.29.—Largeur: 2 m.—Figures: 0.05.
A. VAN DYCK
CORNÉLIUS VAN DER GEEST
SALLE X.—ÉCOLE FLAMANDE
125
Cornélius Van der Geest
NOUS avons peu de renseignements sur ce Van der Geest dont
Van Dyck nous a laissé un si magnifique portrait. Tout ce
que nous en savons, c’est qu’il fut l’ami de Rubens. Il devait
être par conséquent un personnage d’importance et de culture
soignée. N’était pas qui voulait, en effet, l’ami de l’illustre peintre
anversois, diplomate à ses heures et grand seigneur en tout temps. Un
homme sans valeur ou sans crédit n’aurait pas davantage tenté l’aristocratique
pinceau de Van Dyck, peintre officiel des Stuarts.
Tenons donc Van der Geest pour un notable bourgeois d’Anvers.
D’ailleurs, son portrait plaide suffisamment en sa faveur. Il y a de
l’intelligence dans son haut et large front, de la pénétration dans le
regard, de la finesse dans la bouche, et de la race dans l’ovale
allongé du visage. Des cheveux gris soyeux encadrent le front et une
courte barbe en pointe affine encore cette sérieuse et sympathique
physionomie. La large fraise qui enserre le cou met en valeur les
moindres détails d’une figure brossée avec une étonnante légèreté de
touche. Quant au vêtement, noir sur le fond sombre du tableau, il a
volontairement été traité dans la note obscure, suivant la technique de
Rembrandt, afin de laisser toute son importance au visage du modèle.La “National Gallery” est assez riche en tableaux de Van Dyck, cet artiste ayant passé en Angleterre une grande partie de son existence. Ils sont tous supérieurs, mais je ne crois pas qu’aucun d’eux surpasse celui-ci pour la perfection du rendu et le fini de l’exécution.
126 Van Dyck avait été l’élève de Rubens; il ne pouvait trouver un maître plus habile. Mais s’il profita des leçons de l’illustre auteur de la Descente de Croix, il trouva dans sa propre personnalité suffisamment de moyens pour ne pas subir son empreinte; il sut garder intact son génie.
Rien ne ressemble moins, en effet, à la manière de Rubens que la manière de Van Dyck. Le premier est fougueux, impétueux, débordant de fantaisie et d’imagination, affectionnant les truculences de la chair et les truculences de la couleur. Rubens étonne, éblouit, emporte dans le mouvement formidable de ses compositions; sa palette est chargée de couleurs éclatantes qu’il répand à profusion sur les draperies, sur les ciels, sur les épidermes des femmes.
Tout autre est Van Dyck: de tempérament plus flegmatique, il est égal, ordonné, on pourrait presque dire mathématique. Son pinceau ne s’aventure pas aux scènes tumultueuses; son génie est fait de sagesse, d’équilibre, du juste sentiment de l’harmonie des choses. Adorateur passionné, comme son maître, de la nature, il ne l’habille pas de parures voyantes, mais il la serre de près, il la scrute, minutieusement, patiemment, pour en saisir les plus fugitives manifestations. Sa couleur est comme son dessin, précise, calme, mais nette, sans apprêts, sans empâtements, sans violences. Quand il s’asseoit devant son chevalet, il ne regarde pas sa toile avec un verre grossissant mais avec ses yeux, des yeux qui savent voir et observer.
Avec un génie moins complet que celui de Rubens, il a su, par son extraordinaire capacité observatrice, s’élever jusqu’aux côtés du maître et ne pas lui être inférieur.
On comprend qu’avec des qualités de cet ordre, Van Dyck se soit plus volontiers adonné à l’art du portrait. Ce n’est pas qu’il n’ait abordé d’autres genres, et avec succès. La “National Gallery”, notamment, possède de lui des tableaux comme le Miracle des Poissons, Saint Ambroise interdisant à l’empereur Théodose 127 l’entrée du temple, Renaud et Armide, etc., qui démontrent que nulle forme de peinture ne lui était étrangère, mais c’est surtout dans le portrait qu’il a acquis sa plus durable gloire. Là, il est en possession de tous ses moyens, qui sont merveilleux. Personne, comme lui, n’a su capter le caractère d’un modèle, ni fixer la vie sur ses traits. Les êtres, hommes ou femmes, dont il nous a légué les effigies, arrêtent sur nous leurs regards profonds, nous subissons la hantise de leur physionomie et nous ne pouvons plus les oublier.
Chez Van Dyck, l’exécution est poussée aux plus extrêmes limites de la perfection. Par la connaissance profonde de la technique, il l’emporterait même sur Rubens, si nous oublions un instant la somptueuse prodigalité de celui-ci, sa fougue étonnante, son extraordinaire fécondité. S’il a moins d’éclat et d’énergie, en revanche il a plus d’élégance, de tendresse et de goût. Il a su garder à côté du maître une indéniable originalité et se placer, en compagnie de Titien, de Velazquez et de Rembrandt, au premier rang des portraitistes de tous les temps.
Cornélius Van der Geest est peint sur bois. Il faisait partie de la collection Angerstein et entra avec elle à la “National Gallery”, où il figure dans la salle X, réservée à l’école flamande.
Hauteur: 0.78.—Largeur: 0.66.—Figure grandeur nature.
MURILLO
JEUNE BUVEUR
SALLE XIV.—ÉCOLE ESPAGNOLE
131
Jeune buveur
MURILLO, peintre de genre! Il semble qu’on profère une sorte
de blasphème d’associer à ce nom glorieux une forme d’art
réputée inférieure. Murillo, le peintre des Madones
souriantes et des anges roses, descendre ainsi des régions célestes
et se complaire au vulgaire spectacle des mendiants, des bouffons
et des buveurs! Certes, la palette de Murillo se charge plus
habituellement des couleurs tendres et délicates avec lesquelles on
sertit de clartés la tunique des vierges ou l’auréole des saints;
mais ce merveilleux ouvrier de Paradis était un homme, un
Espagnol, un Sévillan. Redescendu de ses hauteurs, il s’intéressait
en curieux et en artiste à tout ce qui sollicitait sa vue par le
pittoresque ou la couleur. Tous les types séculaires de la vieille
Espagne l’attiraient et il se plaisait à noter leurs gestes, leurs
attitudes, à peindre leurs voyantes guenilles et leurs fiers haillons
avec la méticuleuse précision d’un Flamand.
Ne dirait-on pas, en effet, une création flamande, ce Jeune buveur
que nous reproduisons ici? Ne nous rappelle-t-il pas ces piliers
d’estaminet que Vermeer de Delft et Jan Steen excellaient à peindre?
Ne lit-on pas dans ce visage allumé de plaisir et dans le mouvement
du bras qui serre amoureusement le flacon la même satisfaction
sensuelle que nous trouvons sur les faces rubicondes des buveurs
de Brauwer? Le type seul diffère: le jeune buveur de Murillo
est Espagnol; ses traits n’ont pas l’ampleur ni le jovial épanouissement
132
du masque hollandais, mais, à cela près, c’est la même
solide facture, la même couleur sobre, le même réalisme, la même
recherche du détail.Phénomène curieux et qui démontre bien la souplesse du génie de Murillo, cet extraordinaire coloriste, l’un des plus chatoyants et des plus brillants qui soient, a su trouver les tons fauves et sourds qui conviennent à ces modèles de cabaret. Le Jeune buveur porte une souquenille couleur de bure; autour de son cou est négligemment noué un foulard blanc. Dans cette peinture il semble que l’artiste se soit complu à déployer sa virtuosité. Lui qui ne travaille qu’en plein ciel, dans l’éblouissante lumière des apothéoses, a voulu manier le clair-obscur et il a noyé d’ombre la tête de son personnage. Il s’y montre supérieur comme il est supérieur en tout. Habitué à dessiner des mains fuselées de Madones ou des menottes potelées d’angelets, il a trouvé des vigueurs rembranesques pour modeler ces mains nerveuses et solides de paysan qui sont des merveilles d’exécution.
Bartolomé Esteban, plus connu sous le nom de Murillo, naquit à Séville à la fin de l’année 1617, dans une modeste maison de la calle de las Tiendas, louée par son père aux religieux de San Pablo. Ce quartier était le plus misérable de la ville et avoisinait le quartier juif; là, l’enfant vagabondait avec les petits mendiants qu’il devait immortaliser plus tard par son pinceau. Ses parents étaient pauvres et il eut le malheur de les perdre à dix ans. La protection de son oncle, médecin sans grande clientèle, lui valut d’entrer chez un peintre comme élève. Il y fit surtout métier de domestique, balayant l’atelier, broyant les couleurs, nettoyant les brosses. Mais cela n’empêcha pas Murillo de travailler, et avant d’avoir atteint sa seizième année, il avait déjà placé des œuvres de lui dans plusieurs maisons religieuses de la ville.
Son maître ayant quitté Séville, il demeura seul; et pour gagner 133 sa vie, il travailla pour la feria qui avait lieu une fois par semaine; les fermiers, les marchands, leurs transactions terminées, ne dédaignaient pas d’acquérir quelque Madone ou de poser séance tenante pour quelque portrait rapide que le jeune artiste leur livrait à très bon compte.
Persuadé qu’il avait encore à apprendre, Murillo, ne pouvant aller en Italie, résolut de se rendre à Madrid; il s’y présenta à Velazquez qui l’accueillit de suite, lui donna des conseils et lui ouvrit les portes des galeries royales; et quand il rentra à Séville, il était véritablement un peintre.
Il eut la chance d’obtenir une commande pour le couvent des Franciscains; cette peinture fraîche, harmonieuse, colorée, eut un succès immédiat. La réputation lui vint, et bientôt la fortune. Le pauvre petit peintre qui, trois ans auparavant, peignait à vil prix des tableaux pour la foire, épousa doña Beatrice de Cabrera y Sotomayor, de famille noble et riche. Il devint un personnage et quelques années après, il fondait à Séville une Académie publique d’art.
Son œuvre, qui est immense, fut surtout consacrée à la glorification de l’Église; c’est surtout par les scènes religieuses qu’il a assis sa réputation dans l’histoire de l’art. Néanmoins, il aborda tous les genres avec un égal bonheur; il peignit des paysages d’un très grand caractère, de nombreux portraits répandus aujourd’hui dans tous les musées du monde et surtout des types de pouilleux et de mendiants, observés dans sa vieille cité andalouse.
Le Jeune Buveur a été légué à la “National Gallery”, par M. John Staniforth Beckett en 1889; il figure dans la salle XIV, réservée à la peinture espagnole.
Hauteur: 0.62.—Largeur: 0.46.—Figure grandeur nature.
FRANZ HALS
GROUPE DE FAMILLE
SALLE X.—ÉCOLE HOLLANDAISE
137
Groupe de famille
FRANZ HALS ne peignait pas uniquement les personnages isolés.
Groupes de régents, groupes de corporations et groupes de
famille se sont multipliés sous son pinceau; Franz Hals
a été en quelque sorte l’historiographe politique, social et domestique
de Haarlem. Ses groupes de famille sont particulièrement nombreux:
on en trouve à Haarlem, à Berlin, au Louvre, en Irlande, à Munich.
Celui de la “National Gallery”, que nous donnons ici, est un des plus
intéressants. Suivant une manière chère au peintre, les personnages y
sont singulièrement pressés, tassés les uns sur les autres, dans un coin
de la toile, devant un rideau épais et sombre de grands buissons et
d’arbres; les claires notes des visages, des mains, des cols et des
bonnets s’en détachent avec une vigueur de contraste très puissant,
peut-être trop aisé et à coup sûr monotone, malgré le soin que prend
Hals d’interrompre soudain ce fond sur un vaste et calme paysage
mouvementé par le passage au ciel de grands nuages qui se bousculent.
Tous les personnages ne s’enlèvent pas sur le fond uniforme; les
derniers vers la gauche ont débordé sur l’espace plus ouvert, mais
derrière leurs têtes les nuages et le ciel sont peints dans une teinte
bistre et obscure. La plaine, les prairies sont immenses, et, accident
unique dans l’œuvre du maître, on y aperçoit deux vaches tachetées
au pâturage.
Les grands-parents sont assis avec la famille groupée debout
autour d’eux. Cette famille appartient évidemment à la petite bourgeoisie
138
hollandaise: sans doute des marchands que l’on devine
endimanchés à l’allure un peu guindée de leurs attitudes. Franz Hals
n’était pas d’ailleurs un metteur en scène bien habile; il lui importait
peu que les personnages fussent écrasés sur un petit espace; une seule
chose l’inquiétait, la traduction fidèle des visages et des caractères.
Néanmoins, il y a de la bonhomie, du naturel et même de la grâce
dans le mouvement des jeunes enfants qui s’ébattent au premier plan,
et dans celui de la fillette qui tend si gentiment les menottes vers la
grand’mère. Quant à la ressemblance, on la devine parfaite, on se
persuade facilement que ces modèles alignés sur un fond de paysage
n’avaient pas plus de distinction qu’il ne leur en a donné. Hals est un
traducteur irréprochable de la nature, mais il se contente d’en
exprimer ce que voient ses yeux, et rien de plus. Ne cherchons pas
les pensées secrètes, les sentiments ou même les particularités de
caractère qui peuvent différencier cet homme et ces femmes des
autres habitants de la cité, n’essayons pas de descendre dans ces âmes
que l’observation de l’artiste n’a même pas cherché à pénétrer. Franz
Hals est réaliste, certes, mais son art ne dépasse pas, le plus souvent,
la physionomie superficielle des personnages qu’il peint; il entend
peu de chose au mystère de l’âme. Les lignes de la figure humaine,
l’aspect variable que leur confèrent les mille jeux du modelé et de la
lumière, c’est là ce qui le retient; il surprend au passage les transformations
sans nombre qui vont de la plus grave sérénité à des
explosions de douleur ou de joie; il transcrit les symptômes révélateurs
de tous les sentiments, et lui-même, au gré de son humeur ou selon
son âge, sait en provoquer l’éveil. Il ne se laisse diriger, circonscrire,
absorber par personne. S’il n’a pas poursuivi les hautaines chimères
sur les cimes infréquentées, il a vibré de plaisir et de souffrance. Son
art n’est pas le miroir froidement exact des réalistes absolus. Le
mouvement trahit, dans les images d’hommes et de femmes qu’il
nous a laissées, leur résignation ou leur joie. Au lieu de n’être que
139
véridique scrupuleusement, il l’est avec une fougue incomparable.Franz Hals naquit à Haarlem, vers 1580, de parents qui avaient occupé d’honorables fonctions dans la cité. Après un court séjour à Anvers, il rentra dans sa ville natale, y fut l’élève de Karl Van Mauder, s’y maria et s’y fixa pour le reste de ses jours. Dès le début de son mariage, sa conduite donne lieu à de fâcheux commentaires: il se montre violent, extravagant et ivrogne, et il est réprimandé par les bourgmestres pour s’être porté à des sévices sur sa femme et pour avoir abusé de la bouteille. Néanmoins, il jouit de la considération publique, car il ne fait pas scandale et de plus il a du talent. Des notables de la cité lui demandent leur portrait; il a des commandes nombreuses et il arriverait à une belle fortune s’il savait conduire ses affaires et gouverner ses vices. Il a des dettes criardes et doit laisser des tableaux en gage pour payer son boulanger. Les Hollandais, gens pratiques, prennent prétexte de ses besoins pour obtenir des portraits à bas prix. Même à l’époque de sa plus grande vogue, ses tableaux sont cotés assez bas.
Hals produit avec une incroyable facilité et son œuvre est immense, mais elle ne peut le sauver de la misère. Devenu vieux, il doit implorer les secours de la municipalité qui lui consent une aumône de cinquante florins. Et quand il meurt, dénué de tout, la dépense pour son enterrement ne dépasse pas quatre florins.
Le Groupe de Famille fut longtemps conservé chez lord Talbot, au château de Malahide, en Irlande; il a été récemment acheté par la “National Gallery” pour la somme de 725.000 francs. Bien que partiellement repeint, il compte parmi les œuvres maîtresses de Franz Hals. Il figure dans la salle X, réservée à la peinture hollandaise.
Hauteur: 0.74.—Largeur: 1.23.—Figures: 0.40.
W. HOGARTH
LA FILLE AUX CREVETTES
SALLE XIX.—VIEILLE ÉCOLE ANGLAISE
143
La Fille aux crevettes
CERTAINS critiques et même des peintres comme Reynolds,
ont dénié à Hogarth la qualité de peintre. Observateur
ingénieux, physionomiste spirituel, dessinateur satirique;
mais peintre, non. Pourquoi? Sans doute à cause que le genre adopté
par lui—et qui est tout simplement le genre—ne jouissait d’aucun
crédit à l’époque où vivait Hogarth.
Il en a été de même dans tous les pays pour tous les peintres qui
se spécialisèrent dans cette peinture anecdotique. Decamps, chez nous,
éprouva les mêmes injustices et subit les mêmes attaques. La postérité
s’est chargée de les venger l’un et l’autre.«N’est-elle pas d’un beau peintre de race, cette vivante figure de la Fille aux crevettes, dont le joyeux et blanc sourire, fixé d’un pinceau si rapide et si sûr, d’un pinceau d’impressionniste, semble éclore dans le brouillard de Londres, comme une fleur dans la nuit?» Où trouver une plus gracieuse figure de plébéienne, plus fraîche, plus saine, plus vraie? Sous la charge de la corbeille remplie de crevettes, et dans l’encadrement des cheveux noirs, le visage apparaît épanoui dans une gaîté splendide qui fait rire les yeux, retrousse le nez, fait éclore des fossettes et découvre les dents, de vraies perles. A la contempler, on songe à la Bohémienne de Franz Hals; mais le rire de la Fille aux crevettes, moins appuyé par le pinceau, acquiert une légèreté, une sorte de «flou» qui en augmente le charme. Ce type est bien celui de la jeune Anglaise, si fine et si précieuse—quand elle est jolie—qu’elle 144 ressemble à un bibelot d’étagère. Quant à la couleur, elle est sobre, chargée de tons bruns, très chauds, qui font penser à la manière de Ribera quand il peignait les vermineux mendiants de Séville.
Hogarth fut avant tout le peintre des types populaires de Londres; ses prédilections et ses aptitudes l’inclinaient vers la notation des laideurs et des ridicules de son temps. Il y eut en lui, dès les débuts, un satirique et un observateur original. Né dans le peuple, en 1725, il trouva ses premiers modèles dans les tavernes, les cafés, les carrefours et les faubourgs de la grande cité.
«Tout concourait, écrit M. Philarète Chasles, à cette éducation spéciale; tout l’éloignait de l’idéal grec, de l’unité, de la règle antique et du type sévère du beau. Tout le préparait à devenir non l’élève du Titien, du Corrège et de Raphaël, mais le satirique vigoureux et souvent brutal, le peintre moral et souvent cynique du XVIIIe siècle anglais, le violent adversaire de la convenance attitrée et de la fausse élégance dans l’art, même du grand style et de l’idéal...»
Il voulut quand même aborder le grand style: il peignit la Fille de Pharaon, Sigismond et Danaé, le Bon Samaritain, la Prédication de Saint-Paul, etc., mais ce ne furent que des velléités passagères dans la carrière de l’artiste; il n’était manifestement pas taillé pour la grande peinture. Il appartenait plutôt à la race des peintres moralistes, et sa manière s’apparente à celle des petits maîtres hollandais, observateurs narquois des vices de leur époque, et à leurs qualités Hogarth ajoute cette pointe ironique et «pince sans rire» qui constitue l’humour anglais.
Nous retrouverons Hogarth au cours de cette publication, dans la scène du Mariage à la mode qui porta à l’apogée sa réputation et qui le classe parmi les plus grands maîtres de la peinture de «genre». Sur l’art d’Hogarth, nous ne saurions mieux faire que de citer l’opinion d’Armand Dayot, dans sa belle étude sur la Peinture anglaise:
«Faut-il voir dans Hogarth un des grands maîtres de la peinture 145 anglaise, un technicien exemplaire? Assurément non; le don de composer lui fait souvent défaut. Dans la plupart de ses œuvres, voire même celles où l’intention philosophique est la plus lisible et où il paraît avoir voulu s’attacher plus aux idées qu’aux formes, l’envahissement souvent vulgaire de l’accessoire, la confusion de détails inutiles nuit à l’expression du sujet principal. Souvent aussi sa touche âpre et lourde, son dessin sec et heurté, sont en complet désaccord avec le caractère du sujet. On a pu dire que Hogarth avait quelque chose de Swift pour l’amertume et de Daniel de Foë pour la vérité. On aurait pu aussi ajouter que malheureusement dans toute son œuvre n’existe pas l’unité de forme et de pensée qui domine celle des deux grands écrivains.
«Ces réserves faites et en admettant même avec Mérimée que William Hogarth fut plutôt poète comique que peintre, il faut bien reconnaître que dans l’œuvre, si frémissante, de cet extraordinaire artiste, le plus anglais peut-être des peintres anglais, il existe des pages où l’expression de la critique des mœurs est d’une technique très adroite et qui fait songer parfois à celle de notre grand Chardin, avec plus de fluidité peut-être dans la caresse du pinceau et souvent autant de légèreté dans le clair-obscur des fonds. Assurément ces pages, véritables petites merveilles de métier, sont assez rares. Mais on les trouve encore sans trop de peine dans le prodigieux amoncellement des œuvres de l’artiste.»
La Fille aux crevettes (Shrimp Girl) compte parmi les toiles les mieux venues d’Hogarth. Elle a été léguée par M. Richard Wheeler Fund, en 1884, à la «National Gallery», où elle figure dans la salle XIX, consacrée à la vieille école anglaise.
Hauteur: 0.63.—Largeur: 0.50.—Figure grandeur nature.
GABRIEL METSU
LA LEÇON DE MUSIQUE
SALLE XII—COLLECTION PEEL
149
La Leçon de musique
ON doit placer Gabriel Metsu—c’est ainsi qu’il signe son nom—parmi
les peintres les plus habiles de l’école hollandaise.
Il a un dessin juste et vrai, une couleur harmonieuse, une
touche libre et facile. Chez lui, chaque coup de pinceau, bien posé,
exprime une forme, et ce n’est point en polissant et en blaireautant
qu’il arrive au fini. Son art est chose si admirable, qu’il sait rendre
intéressants des objets qu’on ne regarderait pas dans la nature, des
ustensiles de cuisine, des bottes d’oignons, des bocaux, des pots de
grès, du gibier, des poissons et de la volaille plumée par quelque
maritorne.
Dans cet ordre d’idées, il a produit des tableaux qui sont de vrais
chefs-d’œuvre, notamment le Marché aux herbes d’Amsterdam, une
des plus précieuses toiles hollandaises du musée du Louvre. Le plus
gai mouvement anime la composition. Les commères, les chiens, la
volaille, les ivrognes y grouillent et s’y bousculent, et tout cela est vif,
amusant, plein d’observation et peint avec une rare maestria.Cependant Metsu se souvenait volontiers qu’il avait été l’élève de Gérard Dow. Très souvent il traita les intérieurs reluisants de la Hollande, aux meubles bien frottés, aux cuivres brillants, mais il s’attardait moins que son maître à ce polissage minutieux et légèrement exagéré. D’ailleurs, chez lui, le décor n’est pas, comme pour Gérard Dow, la partie capitale de l’œuvre; il n’y joue que le rôle qui lui convient, un rôle d’accessoire. Ce qu’il traite avec le plus de soin, et 150 avec une évidente prédilection, ce sont les personnages: et il rentre alors dans le genre élégant pratiqué par Terburg et Netscher. Mais il est moins compassé que celui-ci et moins précieux que celui-là. Terburg cherche à affiner ses modèles, Netscher à les ennoblir; Metsu se contente de les peindre tels qu’il les voit et tels qu’ils sont certainement. Il ne lui viendrait pas à l’esprit de convertir en petits maîtres musqués et pomponnés, comme faisait Terburg, les fils de famille hollandais dont la roture éclatait malgré tout sous les flots de rubans, ni de les poser en grands seigneurs allant au petit lever du roi Soleil à Versailles, suivant la manière de Gaspard et de Constantin Netscher. Ses personnages à lui sont de bons bourgeois cossus, vêtus de bonnes et solides étoffes, mais dénués de prétentions. Ils ont du naturel, de la jovialité, des mines bien portantes et se distinguent tous par un tour spirituel et bon enfant que l’artiste tirait de son propre fonds pour le leur donner.
Ce sont des personnages de cette catégorie que nous montre Metsu dans sa Leçon de musique. Étrange leçon de musique que celle-là! Certes, on aperçoit bien le clavecin, grand ouvert devant la dame et nous pouvons admettre à la rigueur que le papier qu’elle tient à la main est un morceau de musique. Mais il faut croire que la leçon n’est pas trop sérieuse, à en juger par l’attitude du professeur. Nous le voyons plus occupé du vin contenu dans son verre que des progrès de son élève. Son violon d’accompagnateur repose oisif sur la table voisine et rien n’annonce que la leçon va bientôt reprendre. Il a bien tous les dehors de son emploi, le joyeux professeur. Il appartient évidemment à cette race, vieille comme le monde, des coureurs de cachet, dont Aristophane faisait déjà des gorges chaudes.
Il a dans l’attitude et dans le costume, quelque chose du pédant et du pique-assiette, pour qui chaque leçon est une aubaine, un prétexte à décrocher quelques miettes. Peut-être aussi est-il tout simplement Hollandais, c’est-à-dire ami de la bouteille et ayant besoin, pour 151 retrouver son éloquence professionnelle, d’aller la chercher de temps en temps au fond du verre.
La dame, elle, regarde son professeur en souriant. Elle est habituée sans doute à ces intermèdes bachiques. Et la conversation va son train. Elle n’est pas très jeune ni extrêmement jolie, cette blonde Hollandaise, avec ses cheveux tirés et roulés sur la nuque, avec son front bombé, son nez qui relève et son menton qui tombe; elle n’est pas non plus d’une élégance bien raffinée dans le corsage rouge et dans l’ample robe jaune qui drapent ses robustes appas. Mais il y a quand même du charme dans ce visage fleuri et bien portant qui sourit avec complaisance aux explications du musicien; il y a de la finesse aussi dans le plissement des yeux bridés et dans le pincement des lèvres.
Il faut également noter dans ce tableau, avec le naturel des personnages, l’art supérieur du coloris dans lequel les Hollandais furent toujours des maîtres. Les tons vifs et les teintes discrètes s’y distribuent avec une ingéniosité parfaite, les unes faisant valoir les autres, et toutes se fondant dans le plus harmonieux ensemble. A l’habile opposition des lumières et des ombres, il est facile de deviner que Metsu travailla dans l’atelier de Rembrandt et y apprit à manier le clair-obscur.
Si la “National Gallery” est riche aujourd’hui en tableaux de l’école hollandaise, elle le doit à la munificence d’un collectionneur éclairé, M. Robert Peel, qui lui en a légué un nombre considérable, en 1871. Parmi ces toiles, la plus précieuse est certainement cette charmante Leçon de musique, que nous donnons ici. Elle figure dans la salle XII, réservée aux œuvres de la collection Peel.
Hauteur: 0.38.—Largeur: 0.31.—Figures: 0.23.
ROSA BONHEUR
LE MARCHÉ AUX CHEVAUX
SALLE XVI.—ÉCOLE FRANÇAISE
155
Le Marché aux chevaux
CONDUITS ou montés par les meneurs, les jeunes chevaux
se bousculent et se ruent, par le boulevard Saint-Marcel, vers
la rampe qui donne accès au marché aux chevaux. A gauche,
fermant la perspective, se dresse le dôme de la Salpêtrière.
Il se dégage de ce tableau célèbre, une impression de mouvement
frénétique et d’irrésistible puissance. Voici de vigoureux percherons,
à robe pommelée, la queue roulée, qui tirent violemment sur le
bridon et frappent le sol de leurs membres solides. Entraînés par le
vertige de la course, d’autres chevaux les suivent, animés, les naseaux
fumants, la crinière envolée, élégants ou trapus, selon la race. Au
centre du tableau, un magnifique étalon noir, ardente bête aux yeux
de feu, se cabre en un mouvement superbe, tandis que son meneur
le frappe sur la tête pour l’obliger à reprendre pied. Derrière ces
chevaux de premier plan, d’autres s’aperçoivent et l’on devine que
d’autres encore suivent, et l’on croit entendre le fracas, sur le sol,
des sabots impatients ou furieux.Cette ruée vertigineuse d’une force formidable et aveugle est traduite avec une prodigieuse intensité. Par cette œuvre admirable, Rosa Bonheur se classa, du jour au lendemain, au premier rang des peintres animaliers de son temps.
Dès sa plus tendre enfance, Rosa Bonheur avait marqué une prédilection toute particulière pour les bêtes. Elle les connaissait, les comprenait et les aimait. Aux alentours de la maison paternelle, 156 à Neuilly, se trouvaient des fermes abondamment pourvues de vaches, de moutons, de porcs, de volailles. Munie de ses crayons, elle allait s’y installer et pendant la journée entière, elle essayait de surprendre et de noter les différentes attitudes de ses modèles préférés. Bientôt il ne lui suffit plus de les étudier au dehors, elle veut en avoir chez elle. Elle obtient de son père d’hospitaliser un mouton dans l’appartement: peu à peu la ménagerie s’accroît d’une chèvre, d’un chien, d’un écureuil, d’oiseaux en cage et de cailles qui évoluent en liberté dans sa chambre. Plus tard, à sa propriété de Chevilly ou à son château de By, elle y ajoutera des gazelles, des cerfs, des daims, des chevaux, des chiens de toute espèce, des taureaux, des vaches, des mouflons, des isards, des singes, des yacks, des sangliers, des aigles, des lions.
Rosa Bonheur avait trente ans lorsqu’elle exécuta son Marché aux chevaux dont l’histoire mérite d’être relatée.
Malgré son succès triomphal, cette toile ne trouva pas immédiatement acheteur et rentra dans l’atelier de l’artiste. Elle ne fut acquise que plus tard par un grand marchand de Londres, M. Gambard, qui la paya 40,000 francs. Quand elle traita avec M. Gambard, Rosa Bonheur, qui ne fut jamais avide, craignit d’avoir demandé une somme trop forte. Comme son acquéreur désirait faire reproduire le tableau par la gravure et que celui-ci était de dimensions considérables, peu commodes pour le travail du graveur, elle offrit à M. Gambard de lui faire, à titre gracieux, une réduction du Marché aux chevaux au quart de l’original.
M. Gambard, qui faisait une excellente affaire, accepta, on devine avec quel empressement. La réduction fut livrée et immédiatement achetée par un amateur anglais, M. Jacob Bel, pour une somme de 25.000 francs. Quant à l’original, il fut exposé dans la galerie du Pall-Mall; mais ses grandes dimensions rebutaient les acheteurs. Il fut enfin acquis par un Américain, M. Wright, au prix de 30.000 francs, 157 avec la clause que M. Gambard le conserverait encore deux ou trois ans pour l’exposer en Angleterre et aux États-Unis. Quand le moment de la livraison fut arrivé, l’Américain prétendit avoir droit à la moitié des bénéfices produits par les diverses expositions de l’œuvre. Si bien que le tableau original acheté 40.000 francs par M. Gambard, ne lui fut définitivement payé que 23.000 francs, tandis que la réduction qui ne lui avait rien coûté lui en avait rapporté 25.000. Bien plus tard, l’Américain possesseur de l’original ayant fait de mauvaises affaires, le Marché aux chevaux fut mis aux enchères et adjugé 265.000 francs à M. Vanderbilt qui en fit don au musée de New-York.
Quant à la réduction que nous donnons ici, M. Jacob Bel la légua à la “National Gallery” où elle se trouve actuellement.
Quand Rosa Bonheur apprit que cette réduction allait entrer au musée de Londres, elle fut prise d’un scrupule qui montre bien sa probité. Croyant n’y avoir pas apporté le même fini qu’à l’original, elle recommença une troisième fois le Marché aux chevaux et y mit une telle conscience, y déploya tant de talent que d’aucuns estiment cette deuxième réplique supérieure à l’original. La toile achevée, elle l’offrit à la “National Gallery”. Les autorités anglaises, très touchées du désintéressement de l’illustre artiste, la remercièrent vivement, mais, se jugeant liées par le legs de Jacob Bel, ne crurent pas pouvoir accepter son offre généreuse. Cette réplique fut achetée pour 25.000 francs par M. Mac Connel.
Le Marché aux chevaux figure dans la salle XVI, réservée à la peinture française.
Hauteur: 1.19.—Largeur: 1.06.—Figures: 1 mètre.
DAVID TÉNIERS (le Jeune)
VIEILLE FEMME PELANT UNE POIRE
SALLE X.—ÉCOLE FLAMANDE
161
Vieille femme pelant une poire
DANS le royaume fantaisiste qu’il s’est choisi comme domaine,
David Téniers le Jeune est resté maître incontesté. Il ne
cherche pas ses sujets dans le monde élégant et il n’use pas
sa palette à peindre les somptueuses décorations des maisons riches.
En Flamand de pure race, il se sent davantage attiré vers les scènes
plus vulgaires mais plus pittoresques de la vie campagnarde. Il adore
peindre les cabarets embués de la fumée des pipes, les ivrognes à
trogne joviale, les paysans balourds et les femmes plantureuses des
Flandres. Il n’est certes pas le peintre de la beauté, dans son
acception la plus généralement admise, mais il a su démontrer—avec
beaucoup d’autres peintres de son pays—que l’art ennoblit
tout, embellit tout, même les sujets qui nous paraissent au premier
regard les moins dignes de la peinture.
On s’explique mal aujourd’hui, devant ces tableaux charmants,
le discrédit qui les frappa pendant si longtemps. Louis XIV, à qui
l’on montrait quelques œuvres de Téniers, eut un geste de dégoût:
«Qu’on ôte de devant moi ces magots!» s’écria-t-il.A la rigueur on excuse la colère du grand roi, qui n’admettait en art que les compositions solennelles et nobles. Possédant Le Brun, il ne pouvait honorer même d’un regard Téniers le Jeune.
Celui-ci d’ailleurs ne travaillait pas pour Versailles. Son ambition ne visait pas si haut. Il n’en avait d’autre que de traduire fidèlement et aussi spirituellement que possible les scènes quotidiennes de la 162 vie paysanne de son temps. Par l’exactitude, la diversité et la vérité de son œuvre, il se classe comme l’historiographe le plus complet des mœurs flamandes au XVIIe siècle.
Mais Téniers n’est pas que cela; il est en même temps un merveilleux artiste. Peu de peintres ont manié le pinceau avec plus de légèreté et plus de science. Sous l’apparent laisser-aller de ses compositions, le dessin s’affirme net, solide, avec des contours accusés et précis; sa couleur est blonde, transparente, lumineuse et chaude. Ce virtuose de la palette, qui brossait un tableau en quelques heures, possédait une sûreté de main que les artistes les plus scrupuleux et les plus savants lui auraient enviée.
Nous trouvons un exemple de ces remarquables qualités dans le tableau de la Femme pelant une poire, reproduit ici.
Dans un taudis de village, moitié grange et moitié logement, une vieille femme est assise, dans un rai de lumière, tombant d’une fenêtre qu’on ne voit pas. Elle porte le costume des paysannes flamandes, sur lequel est noué un tablier bleu. Le couteau à la main, elle pèle une poire qu’elle jettera sans doute après dans la terrine de grès posée à côté d’elle. Les autres poires qui gisent à terre semblent indiquer qu’elle prépare des confitures. A en juger par le titre, c’est là tout le sujet, et l’on serait tenté de dire, avec les contempteurs des Flamands, qu’il est bien mince pour retenir l’attention d’un peintre. Ne nous y trompons pas. Cet épisode banal n’est qu’un prétexte dont Téniers s’est servi pour nous montrer un intérieur campagnard de son époque.
Voyez avec quelle entente de son art il a disposé toutes les parties de son tableau. Tout près de la brave femme assise, il a placé, dans un pêle-mêle pittoresque, les principaux attributs d’une cuisine de campagne. Sur une cuve retournée, un chaudron fait étinceler ses cuivres, tandis que sur un billot une bouteille fermée d’un bouchon de papier et une casserole voisinent avec une pipe, celle du maître 163 du logis. On ne voit pas le paysan, seigneur du lieu, mais sa présence se révèle à la veste et au chapeau jetés négligemment, entre deux poutrelles, au haut du four. A la droite de la femme se tient une levrette. Dans le fond de la pièce, éclairée par la porte ouverte, on aperçoit un bahut, une chaise et une sorte de cabestan sur lequel s’enroule une corde. L’ensemble de cet intérieur est modeste, presque pauvre, mais en dépit de l’apparent désordre qui y règne, tout y est d’une propreté parfaite.
Tout l’intérêt de ces détails, en apparence insignifiants, réside dans la manière supérieure dont ils sont traités. Ce qui frappe notamment dans ce tableau, c’est l’admirable distribution de la lumière, un art difficile entre tous. Seul un grand peintre pouvait trouver ces tons dorés, cette atmosphère transparente qui éclaire si harmonieusement la partie gauche de la toile. Pas de lueurs brutales, faciles à produire par des oppositions de touche, mais une lumière égale, tamisée, qui se pose sur les objets, doucement, et qui donne l’illusion complète de la réalité. Plus extraordinaire peut-être est la pénombre dans laquelle est plongé le reste de la pièce. Ombre lumineuse, merveille de clair-obscur, qui ne laisse dans la nuit aucun détail, et qui permet de voir jusque dans les coins les plus assombris de la chaumière.
La Vieille femme pelant une poire fait partie de l’ancienne collection de la “National Gallery”. Elle y figure dans la salle X, réservée à la peinture flamande.
Hauteur: 0.48.—Largeur: 0.66.—Figure: 0.22.
RAPHAËL
LA VIERGE ET L’ENFANT
SALLE VI.—ÉCOLE OMBRIENNE
167
La Vierge et l’Enfant
CETTE magnifique peinture, plus connue sons le nom de
Madone degli Ausidei, peut être considérée comme l’un des
plus purs chefs-d’œuvre de Raphaël. Jamais «l’ange d’Urbino»
ne s’est élevé à une plus grande hauteur d’expression ni à une
plus sublime perfection.
La Vierge est assise sur un trône élevé auquel on accède par des
degrés; au-dessus du trône, un baldaquin frangé de vert s’avance et
abrite la mère de Dieu. La Madone est vêtue d’une robe de
pourpre recouverte d’un large manteau bleu. Sur son genou droit
est assis l’Enfant Jésus, tout nu, les jambes croisées, une menotte
ramenée sur la poitrine. De la main gauche, la Vierge maintient
sur son autre genou un livre d’heures dont elle montre les enluminures
à son divin Fils. Sa tête auréolée s’incline vers le livre, en
une attitude où se lisent l’attention, le respect et l’infinie tendresse de
son cœur.Debout à la droite du trône se tient saint Jean-Baptiste, revêtu d’une cape rouge admirablement drapée. Ce personnage peut passer pour l’un des plus beaux morceaux qui soient jamais sortis de la palette d’un peintre. On ne peut guère lui comparer que le fameux Saint Jérôme du Corrège. Il est impossible de rêver, pour un corps humain, plus de noblesse et de perfection des formes. Quant au visage, il est un vrai prodige d’expression et d’exécution. Posée en un raccourci d’une grande hardiesse, cette figure est un miracle de vie 168 et d’éloquence. On y lit la ferveur, l’adoration, l’extase, poussés à des limites de réalisation que nul peintre, après Raphaël, n’a jamais atteintes.
A la gauche du trône, se tient saint Nicolas de Bari, en habits épiscopaux, crossé et mitré. Sa belle et fine figure est inclinée sur un missel qu’il paraît lire avec beaucoup d’attention. Aux pieds de l’évêque, on ne devine pourquoi, sont représentées trois pommes. La présence de ce saint s’explique sans doute par quelque lien de parenté qui l’aurait uni à la famille Ausidei, donatrice du tableau.
Au-dessous du fronton du trône se lit l’inscription: Salve, Mater Christi. Derrière, une grande fenêtre à plein cintre, par l’ouverture de laquelle la vue s’étend sur un panorama de ville et sur un horizon formé de montagnes bleues.
Toute la composition est équilibrée sur un rythme savant, harmonieux comme de la musique, et les lignes s’y combinent, s’y répondent en formant les plus heureuses oppositions. La beauté du dessin, la noblesse des types, la pureté des contours, le beau jet et le grand goût des draperies n’ont rien à envier à la statuaire grecque. Dans ce chef-d’œuvre, le spiritualisme chrétien idéalise la perfection plastique. Ce ne sont pas seulement de beaux corps que nous avons sous les yeux, ce sont des âmes célestes. Raphaël les créait à son image.
Personne n’a su comme Raphaël donner à la mère de Jésus cette beauté à la fois idéale et réelle, virginale et féminine, cette pureté de regard, ce sourire charmant qui est le sourire de l’âme, plus encore que celui des lèvres. Il a fixé à jamais le type de la Madone, et c’est toujours avec les traits d’une Vierge de Raphaël que l’idée de «Marie pleine de grâce» se présente au dévot, au poète, à l’artiste.
Nous parlons ici de la Madone telle que le peintre d’Urbin la comprenait dans les derniers temps de sa vie, au sommet de sa troisième manière. Dans ses seconde et première manières, lorsqu’il se souvient encore des leçons du Pérugin, Raphaël représente la Vierge 169 d’une façon plus naïve, plus timide, non moins charmante, qui se sent encore un peu du style gothique. Il la place dans des paysages ornés de villes et de fabriques qui n’ont rien de commun avec la Judée, et, sur le ciel clair, il profile des petits arbres au feuillage sobre et rare.
C’est à cette manière qu’appartient la Madone degli Ausidei. Raphaël n’avait que vingt-trois ans quand il l’exécuta. La Vierge, en dépit de sa beauté, n’y a pas cette suavité céleste que le peintre lui donnera plus tard; elle tient encore par quelques traits à la matérialité terrestre. Le tableau n’en est pas moins un pur chef-d’œuvre.
Cette Madone avait été peinte par Raphaël pour la chapelle de famille de Filippo di Simoni de Ausidei, dans l’église de Saint-Florent, à Pérouse, petite église sans grand aspect architectural que l’on peut voir encore de nos jours dans cette ville. Vers la fin du XVIIIe siècle ce tableau devint la propriété du troisième duc de Marlborough, à qui il avait été signalé par son frère, lord Robert Spencer. Lorsque le bruit se répandit, en 1884, que le huitième duc était sur le point de vendre sa collection, l’Angleterre fit tous ses efforts pour conserver la précieuse Madone. Le directeur de la “National Gallery”, Sir Frederick Burton, chargé d’estimer cette peinture, l’évalua 2.773.000 francs. M. Gladstone, qui était à cette époque, chancelier de l’Échiquier, en offrit 1.720.000 francs au duc de Marlborough. Cette transaction fut sanctionnée par un acte spécial du Parlement, et la Madone degli Ausidei est aujourd’hui la propriété de l’Angleterre. Elle figure à la “National Gallery” dans la salle VI, réservée à l’école ombrienne.
Hauteur: 2.15.—Largeur: 1.48.—Figures grandeur nature.
REYNOLDS
LADY COCKBURN ET SES ENFANTS
SALLE XVIII.—ÉCOLE ANGLAISE
173
Lady Cockburn et ses enfants
LADY COCKBURN, drapée sous sa robe blanche, d’un ample
manteau couleur safran bordé d’hermine, est représentée
assise avec ses trois enfants. Le plus jeune, baby d’un an à
peine, est posé tout nu sur les genoux de la jeune femme et, dans un
geste d’un naturel charmant, saisit son pied avec sa menotte. Un autre,
également potelé et presque aussi peu vêtu, se dresse sur les genoux
de sa mère dont il accapare l’attention en lui contant quelque naïve
et puérile histoire. Un troisième, placé derrière la chaise, se hisse
vers la maman dont il emprisonne le cou avec les bras, et passe
sa tête éveillée par-dessus l’épaule maternelle. A côté du groupe,
sur un perchoir, près du soubassement dune colonne, un magnifique
ara des îles étale son éclatant plumage. Une draperie d’un rouge
éteint sert de fond au tableau et laisse apercevoir, en se relevant,
un coin de paysage et un pan de ciel bleu.
Tout est charmant dans ce tableau, comme agencement et comme
exécution. Tout au plus pourrait-on lui reprocher de manquer un peu
d’atmosphère, de situer les personnages dans un cadre dépourvu de
profondeur, sur un plan trop uniforme. Mais, ces légères réserves
faites, il convient d’admirer la gracieuse disposition du groupe, le
charme délicat de tous ces visages—celui de la mère aussi bien que
celui des enfants—la souplesse du dessin, la précieuse harmonie des
tons.Reynolds restera, dans l’histoire de l’art anglais, comme le peintre 174 de la grâce aristocratique, dans ce qu’elle a de plus délicat et de plus raffiné. Il fut moins bien doué que certains de ses rivaux; Gainsborough, notamment, avait plus de spontanéité, de sensibilité et, disons le mot, de génie. Mais tout ce qu’on peut acquérir par une volonté de fer et un travail opiniâtre, Reynolds se l’assimila et en tira des effets merveilleux.
«Reynolds, écrit Armand Dayot, puisait son génie dans une sorte d’enthousiasme réfléchi, après avoir tout d’abord nourri son esprit des sages et graves conseils de Richardson et rempli ses yeux de la plus pure lumière des écoles de Rome, de Parme et de Venise. Phénomène très curieux dans l’histoire de l’art, l’œuvre de Michel-Ange pesa de son poids formidable sur la volonté du maître anglais, et le peintre gracieux de la femme et de l’enfant, le peintre exquis, un peu superficiel, de la grâce blanche et rose des ladies aux robes légères et des babys aux yeux couleur de ciel et aux cheveux d’or fin, se prosternait avec une ferveur passionnée devant les terribles peintures de la chapelle Sixtine et devant les tombeaux de la chapelle des Médicis...
«Malgré son admiration profonde pour Michel-Ange, Reynolds fut avant tout un élève des Vénitiens. Le Titien, Véronèse et le Tintoret furent ses maîtres véritables. Dans ses recherches infinies pour pénétrer le secret de ces grands artistes, dont il aimait instinctivement l’art fastueux, le coloris éclatant, dans ses élans de passion pour saisir le secret de leur génie, on le vit sacrifier des toiles dues à leurs divins pinceaux, afin d’en décomposer les couleurs, d’en découvrir les pratiques mystérieuses.
«N’hésitons pas à nous ranger parmi ceux qui déplorent cet excès de conscience et de curiosité artistiques.
«En résumé Reynolds est parvenu, à force d’habileté, à dissimuler et à fondre dans une unité, qui cependant lui est bien propre, les divers emprunts de sa palette, et si, en sacrifiant des tableaux du Titien et du Tintoret, pour découvrir par le frottement les diverses couches 175 de couleurs que ces maîtres avaient employées, il eut la curiosité un peu excessive du passé, on est obligé de reconnaître qu’il sut, avec une science et un art incomparables, surtout dans les portraits de la femme et de l’enfant (genre où il est supérieur), donner à ses personnages, par l’esprit naturel des attitudes, par des arrangements de fond appropriés au sujet, par des effets de lumière très imprévus, un caractère tout particulier que souligne encore l’emploi de rouges et de bruns qui appartiennent à sa palette.»
C’est par des œuvres de grâce exquise, comme ce portrait de Lady Cockburn que le nom de Reynolds rayonne si doucement au ciel de l’art. Il manque certainement d’observation, de pénétration psychologique. De ses modèles il ne peint que le visage, sans chercher l’âme. Mais n’est-ce pas déjà une belle gloire que d’avoir exprimé avec tant de délicatesse toutes les distinctions et toutes les élégances de la femme et toutes les grâces de l’enfant?
Le portrait de Lady Cockburn et ses enfants avait été légué en 1892, à la “National Gallery” par lady Hamilton. Mais comme plusieurs héritiers de sir James Cockburn firent valoir leurs droits sur cette peinture, elle fut restituée en 1900 à ses légitimes propriétaires qui la mirent en vente. M. Alfred Beit l’acheta pour 500.000 francs et, quatre ans après, en fit don à la “National Gallery”, où elle figure aujourd’hui dans la salle XVIII réservée à la peinture anglaise.
Hauteur: 1.37.—Largeur: 1.10.—Figures grandeur nature.
LE TITIEN
BACCHUS ET ARIANE
SALLE VII.—ÉCOLE VÉNITIENNE
179
Bacchus et Ariane
GUSTAVE GEFFROY, dans ses Musées d’Europe, décrit
ainsi cette magnifique peinture:
«Bacchus roi, vainqueur de l’Inde et de ses monstres,
traîné par des tigres sur le char de triomphe, suivi de Ménades et
d’Ægipans qui brandissent les membres déchirés des animaux consacrés
dans le mystère de la passion dyonisienne, parmi le tumulte des
tambourins et des tympanons, Bacchus revient des contrées barbares
vers une Grèce lucide et limpide, peuplée de villes et de paysages.
Ariane, effarée, court vers le rivage, près de la mer où disparut Thésée,
et sa main retient le désordre de ses vêtements, en un geste charmant
qu’indiqua, que dessina Catulle dans la fermeté plastique de ses vers.
Les arbres frémissent. Une constellation bienveillante luit au ciel. Le
dieu, transporté, saute à bas du char, et l’image légère de la délaissée,
à demi drapée dans l’ampleur de ses voiles, qui laissent voir la richesse
blonde de sa chair vénitienne, fuit devant l’élan du triomphateur qui
semble s’envoler, soutenu par son manteau. Un délicieux petit faune
aux yeux brillants traîne la tête d’une victime, un chien aboie, les cymbales
et les tambourins retentissent.»Ce splendide chef-d’œuvre fut exécuté par Titien vers 1523 pour le duc Frédéric de Gonzague. C’est peut-être le plus beau morceau de peinture italienne que possède la “National Gallery”. Jamais Titien n’a poussé plus loin la perfection de la forme et la magie de la couleur. Les personnages y sont d’une beauté qui rappelle les œuvres 180 les plus accomplies de la statuaire grecque. Quant au paysage, il s’accorde parfaitement au caractère fantastique de l’œuvre. Rembrandt, qui s’y connaissait en coloris, voyant ce tableau, se plaignait de ne pas trouver de termes assez forts pour le vanter. Il s’extasiait surtout sur «l’impossible magnificence de ce bleu» qui s’épand sur le ciel et sur les flots de la mer.
Il est évident que Turner, qui a traité aussi Bacchus et Ariane, s’est inspiré, pour les deux principales figures, du tableau du Titien.
Quand on a contemplé cette harmonieuse composition, quand on l’a bien comprise, on est en mesure d’apprécier l’influence que l’école vénitienne a exercée sur la peinture de tous les temps et de tous les pays.
De cette école, Titien possède toutes les qualités, portées à leur suprême degré de perfection. Son coloris est le plus beau que jamais palette humaine ait posé sur une toile; son dessin n’est pas moins sûr que sa couleur; il a de la vigueur, de la souplesse, de l’élégance, du modelé; il est le maître que l’on consulte toujours utilement, avec la certitude de n’être jamais trompé.
Le Titien a été l’un des plus prodigieux artistes que le monde ait connus. Sa vie s’est prolongée durant un siècle, sans que sa main, même aux heures extrêmes de la vieillesse, ait eu la moindre défaillance. C’est un astre qui n’a pas connu de déclin. Lorsque la peste l’emporta, en 1575, il avait conservé intacte la plénitude de son génie. Les plus belles de ses peintures furent faites par lui alors qu’il avait dépassé les années que le Psalmiste concède à l’homme.
Il traita tous les sujets, tableaux d’autel, portraits, tableaux historiques, mythologiques, allégoriques, et il serait malaisé de décider une préférence pour l’une ou l’autre de ses œuvres. Il n’a pas consacré de toile spécialement au paysage, mais le sentiment de la nature alla toujours en augmentant chez lui; et depuis le moment où il acheva la dernière peinture de son maître Bellini jusqu’au jour où la peste vint 181 le saisir à son travail, devant son chevalet, il ne cessa d’exprimer, comme dans Bacchus et Ariane, le charme de la campagne tel qu’il le ressentait.
Comme peintre allégorique et mythologique, il restera fameux, parce qu’il est celui dont l’œuvre s’adresse le plus à la sensualité humaine. Sans scrupule, avec une audace extraordinaire, il a donné au monde des peintures païennes, exécutées par lui avec la joie d’un écolier qui a trouvé la porte d’un verger ouverte. Il s’y échappe libre et enthousiaste; bien qu’atténuée par les années, cette fougue subsiste jusqu’à la fin de sa carrière, où son œuvre exulte encore de la joie de vivre et reste l’expression la plus intense du mouvement de la Renaissance, avec la glorification de l’amour et du corps humain.
Supérieur dans tous les genres, génie puissant et créateur, Titien fait partie de cette élite glorieuse qui honore l’art et l’humanité.
Bacchus et Ariane fut acheté pour la “National Gallery” en 1826, en même temps que le Quo vadis d’Annibal Carrache et la Bacchanale de Poussin, pour une somme globale de 225.000 francs. De la sorte cela mettait à un prix très modeste le merveilleux chef-d’œuvre du Titien, qui figure aujourd’hui dans la salle VII, réservée à l’école vénitienne.
Hauteur: 1.75.—Largeur: 1.90.—Figures grandeur nature.
JAN VERMEER
LA FEMME A L’ÉPINETTE
SALLE XI.—ÉCOLE HOLLANDAISE
185
La Femme à l’épinette
IL a fallu trois siècles pour rendre à Jan Vermeer de Delft la
justice qui lui est due et jusqu’au nom qui fut le sien. Bien que
fort estimé de son vivant, son œuvre suivit dans la disgrâce
celui de tous les peintres hollandais et flamands du XVIIe siècle.
Cette époque, subissant l’ascendant de Versailles, n’avait plus d’yeux
pour la peinture familière, minutieuse, un peu mesquine des «petits
maîtres»; la mode était aux grandes compositions, pompeuses et
nobles, célébrant des actions héroïques ou de fabuleux exploits.
L’évolution qui s’opéra, dans le siècle suivant, ne fut pas plus
favorable aux Hollandais: on changea la formule, mais les peintres
qui donnèrent le ton s’appelaient Boucher, Fragonard, Watteau, et
la société du moment était la plus élégante et la plus raffinée que
le monde eût jamais connue. C’était le siècle des madrigaux et des
boudoirs, des conversations galantes, des robes à paniers, des
perruques poudrées, des pastorales fleuries et enrubannées. Quelle
figure auraient pu faire les tableaux de Téniers ou de Van Ostade
dans les coquettes demeures dorées et festonnées du règne
Louis XV? De quel œil horrifié les délicates marquises de l’époque
auraient-elles vu les fantaisies de Van Steen ou les intérieurs
Terburg sur les panneaux laqués de leur salon?
Loin de servir les «petits maîtres», la venue de David ne fit
que les enfoncer davantage dans la réprobation et le mépris. Le
grand pontife du classicisme n’admettait même pas qu’on pût
186
compter au rang des peintres, des hommes ayant ravalé leur pinceau
à d’aussi misérables objets.Il ne fallut rien moins que la poussée naturaliste de 1850 pour rendre à ces parias de la peinture la part de gloire qu’ils méritaient. L’art de Courbet, une fois accepté, permit de comprendre le charme de ces tableaux familiers, sans prétentions, mais si parfaits qu’on y découvre toutes les qualités de la grande peinture. Et bientôt surgirent à nouveau, des limbes profondes de l’oubli, tous ces noms aujourd’hui glorieux, les Téniers, les Van Ostade, les Brauwer, les Nicolas Maës, les Terburg, les Peter de Hooch, les Vermeer.
De tous ces peintres, Vermeer est celui à qui le désastre fut le plus fatal, il y perdit jusqu’à son nom. Dans ces derniers temps encore, une similitude de nom le fit confondre avec les Van der Meer de Haarlem. Et même, aujourd’hui, bien des œuvres qui lui appartiennent sont arbitrairement attribuées à d’autres Hollandais de la même époque. Seules, les toiles qui portent sa signature sont admises comme siennes, et cela explique la rareté des œuvres de Vermeer, qui fut cependant un artiste remarquablement fécond.
Jan Vermeer naquit à Delft où il fut baptisé le 31 octobre 1632. Les détails sur sa vie sont assez rares. Certains commentateurs croient qu’il étudia la peinture avec Fabritius, d’autres nomment Rembrandt comme son maître. Mais rien dans sa manière n’indique qu’il ait fréquenté l’atelier du grand peintre d’Amsterdam. Quant à Fabritius, il était du même âge que Vermeer et il y a peu d’apparence qu’il ait été son maître puisqu’ils brillèrent en même temps à Delft. Il est plus logique de supposer, avec M. Havard, qu’il fut l’élève de Bramer, peintre de Delft, ami et allié de la famille Vermeer.
Quoi qu’il en soit, Vermeer, tout jeune, jouit d’une grande réputation dans sa ville natale. A l’exemple de bien des artistes de son temps, comme Brauwer, comme Franz Hals, comme Rembrandt 187 lui-même, il mena une existence assez décousue. Malgré de nombreuses commandes, il ne réussit pas à sortir de la médiocrité et très souvent il eut maille à partir avec les créanciers et les hommes de loi. Quand il mourut, en 1675, à l’âge de quarante-trois ans, il ne laissait que des dettes à sa femme et à ses huit enfants.
Très habile en son art, Vermeer, peignit des portraits, des sujets de genre, des paysages, des vues de villes. Toutes ses œuvres connues se distinguent par des qualités de premier ordre: un dessin ferme, vigoureux, une couleur solide, posée par larges traits qui rappellent la manière des peintres romantiques; il avait le sens de la composition et il savait exprimer avec finesse et légèreté le caractère d’une figure et le charme d’un intérieur.
Voyez dans quelle jolie lumière baigne cette Femme à l’épinette, reproduite ici. Par la grande fenêtre aux vitraux cernés de plomb, le jour arrive dans la chambre qu’il emplit d’une gaîté rayonnante. Pas un coin d’ombre dans cette chambre, pas un détail d’ameublement n’échappe à l’œil amusé et ravi. La femme elle-même, bien qu’elle tourne le dos à la fenêtre, est comme baignée de clarté. Elle est charmante, cette jeune femme blonde, avec ses frisures voletant sur le front, avec son jovial et plein visage de Hollandaise heureuse et bien portante. A la façon dont elle tourne la tête, on devine qu’il s’agit d’un portrait; l’épinette sur laquelle elle appuie les mains, n’est là, évidemment, que pour lui donner une contenance. La Femme à l’épinette est, avec la Dentellière du Louvre, l’une des meilleures œuvres connues de Jan Vermeer; elle figure dans la salle XI, réservée à la peinture hollandaise.
Hauteur: 0.50.—Largeur: 0.45.—Figure: 0.34.
CLAUDE LORRAIN
PORT DE MER AVEC PERSONNAGES
SALLE XVI.—ÉCOLE FRANÇAISE
191
Port de mer avec personnages
MÊME s’il n’avait pas été le plus merveilleux manieur de
lumière de la peinture, Claude Lorrain se fût acquis une
gloire immortelle comme peintre architectural. Il n’a pas
son égal pour dresser de nobles monuments, ornés de colonnes
élégantes, de statues décoratives, d’escaliers à double révolution
développant leurs gradins de marbre entre des balustres de porphyre.
Nul, comme lui, ne sait prolonger à l’infini une enfilade de
palais dont il encadre la blancheur dans les vertes frondaisons des
grands arbres.
Cette science difficile de la perspective linéaire, qui faisait le
désespoir de Véronèse, Claude Lorrain l’acquit, bribe par bribe,
dans l’atelier d’un vieux peintre romain, où il remplissait le double
rôle d’apprenti et de domestique. Venu à Rome avec une troupe de
cuisiniers lorrains, la fortune lui avait été hostile dès les premiers
jours et, pour vivre, il avait dû renoncer à la pâtisserie pour entrer
en condition.Le hasard, qui fait parfois des miracles, lui donna pour maître un peintre médiocre, bourru, paresseux, mais tout de même un peintre. Et le jeune pâtissier ignorant qui, durant toute sa vie, fut presque incapable de signer son nom, sent s’éveiller en lui, au contact de la peinture, une obscure vocation. Dès lors, pendant les absences du peintre, il s’empare de ses crayons, et, seul, durant de longues heures, il s’exerce à dessiner, entassant ébauche sur ébauche, 192 puis se risquant à poser la couleur sur ces essais. Un jour son maître le surprend en plein travail et demeure interloqué. Bon homme au fond, il l’encourage au lieu de se fâcher. Et bientôt, le jeune Claude Lorrain pourra voler de ses propres ailes.
Cependant, une chose lui manque et lui manquera toujours: la science technique, le métier. Par le fait de cet enseignement rudimentaire, l’éducation, les notions premières lui font défaut, comme lui font défaut les éléments de la grammaire. Mais, par un prodige unique, son instinctive intuition de la nature, sa merveilleuse acuité de vision, son imagination supérieure suppléeront à tout. Il est un ignorant sublime.
Impressionné comme tous les paysans par les majestueux palais des grandes villes, Claude Lorrain croit devoir introduire dans ses tableaux les somptueuses demeures Renaissance qui l’ont ébloui dès son arrivée à Rome. On les y retrouve toujours et peut-être, dans l’esprit du peintre, sont-elles l’objet véritable de la toile, mais en réalité, dans l’œuvre de Lorrain, tout ce qui n’est pas lumière est accessoire. C’est le soleil, à son lever ou à son déclin, qui est le véritable et le seul protagoniste de ses tableaux; son éclat y domine tout, les flots, les verdures et la terre; il flamboie triomphalement sur les voiles des navires et sur les marbres des palais; sans lui toutes ces mâtures effilées et ces colonnes polies se dresseraient inertes sur un horizon sans splendeur.
Que serait, en effet, le port que nous donnons ici, sans le rayonnement prestigieux de l’astre? Certes, l’ordonnance de la composition est habile. Le monument qui se dresse à droite, avec sa terrasse surplombant la mer et son architecture gracieuse est du plus bel effet. Comme tout véritable artiste, Claude Lorrain possède l’art de varier l’intérêt; il sait, quand il le faut, rompre la monotonie d’une perspective en y interposant un massif de feuillages ou en projetant en avant une tour pittoresque; il sait l’importance des premiers plans 193 qu’il décore toujours d’un vigoureux monument destiné à servir de contrepoids à tout le reste. Dans le port, les vaisseaux et les barques sont distribués avec une entente parfaite de la composition. Mais tout cela ne dépasserait pas l’art précis et documentaire d’un Canaletto si, sur toute cette nature et sur ces choses inertes, ne s’épandait la pourpre caresse du soleil. Là est le tableau tout entier. Cette lumière chaude, dorée, de l’astre qui lentement s’enfonce dans la mer, lumière vibrante qui emplit tout l’espace et dont l’œil chercherait vainement le sillon sur la toile, c’est un miracle de poésie et d’art que Lorrain a été le seul à pouvoir réaliser.
Quels sont les personnages qui peuplent ce Port de mer? Il serait malaisé de le dire et Lorrain lui-même eût été embarrassé pour l’expliquer. Ces élégants conversant à la terrasse, ces badauds assistant au déchargement des barques ne sont là que pour animer le paysage. Ce n’était même pas Lorrain qui les peignait, car il ne savait pas dessiner les figures. Il en laissait le soin à des collaborateurs, comme Bril, mais n’y attachait pas plus d’importance que nous n’y en attachons nous-mêmes. Si l’on en croit le titre, il ne s’agirait de rien moins que de l’Embarquement de la reine de Saba allant visiter Salomon. Mais qu’importe? Le vrai roi n’est-il pas le soleil et lui seul?
Ce magnifique tableau porte cette inscription: Claude Gil. JV., faict pour Son Altesse le Duc de Bouillon, à Roma, 1648. Acquis par M. Augustein, celui-ci le légua, avec sa collection, à la “National Gallery” où il figure dans la salle XVI, réservée à la peinture française.
Hauteur: 1.45.—Largeur: 2 m.—Figures: 0.25.
GHIRLANDAJO
PORTRAIT DE JEUNE FILLE
SALLE III.—ÉCOLE TOSCANE
197
Portrait de jeune fille
C’EST une bien délicate et bien vivante figure que celle de cette
jeune Florentine. Tournée de trois quarts vers la droite, elle
semble fixer l’étonnement de ses yeux bleus sur le mystère
de la vie qui s’ouvre devant elle; il y a, dans ces yeux, bien des choses,
de la candeur, de la sérénité, de la douceur. Tout le visage est éclairé
de cette lueur limpide; des yeux, le sourire descend jusqu’aux lèvres,
sourire presque insaisissable, qui se fixe à peine, mais qui voltige sur le
front, sur les joues qu’il anime, sur le nez dont il fait palpiter les fines
ailes, sourire ému peut-être, car il semble imprimer à ce masque
virginal une sorte de frémissement et de langueur. Cette admirable tête
de patricienne est couronnée de la parure blonde des cheveux, lissés
en bandeau sur le front, nattés sur la nuque et s’épandant en flots
onduleux de chaque côté des tempes.
Le cou nu et la gorge délicate s’enferment dans un corsage de velours
nacarat qui fait valoir le grain de cette chair de blonde sur laquelle
quatre siècles écoulés ont déposé une précieuse patine d’ambre et d’or.Devant cette peinture si légèrement brossée que le travail du pinceau y demeure insaisissable, on ne peut se lasser d’admirer l’art de ces maîtres du XVe siècle qui restent des modèles merveilleux. Quelques frottis à peine appuyés, une touche imperceptible et la chair s’anime, la vie monte du fond de l’être dans le miroir des yeux, les joues se colorent, toutes les impressions de l’âme se révèlent et la vie intime du personnage nous livre ses secrets.
198 De cet art évocateur, Ghirlandajo fut un des plus remarquables virtuoses parmi les peintres de son époque. Et cependant, ces peintres s’appelaient Léonard de Vinci et Michel-Ange.
Né à Florence en 1449, Domenico Ghirlandajo était le plus jeune des trois fils de Tomaso Bigordi, ciseleur florentin très estimé. Son surnom de Ghirlandajo lui fut donné parce que, tout enfant, il fut employé à confectionner les guirlandes tressées dont les belles patriciennes de sa ville natale aimaient à se parer. Mais son goût pour la peinture décida sa famille à le faire entrer dans l’atelier d’Alessio Baldovinetto. Il ne tarda pas à distancer son maître et à se tailler une place de choix dans une ville qui s’honorait déjà de posséder les premiers artistes de l’Italie.
Laurent de Médicis, à qui l’histoire à décerné le surnom de Magnifique, régnait alors sur Florence, qu’il gouvernait avec une main de fer. Mais il avait le goût des arts et des belles-lettres et il mettait sa gloire à s’entourer, dans son palais, de tout ce que la péninsule renfermait en hommes illustres. Sa cour était la plus brillante de cette époque et pouvait rivaliser avec la cour pontificale. Les poètes y disaient leurs vers devant un auditoire cultivé et connaisseur; les peintres, familiers du palais, y étaient toujours assurés d’un accueil agréable et d’une efficace protection. Laurent ne se contentait pas d’honorer les peintres, il les comblait de largesses et leurs confiait la décoration des palais et des églises de la ville.
Ghirlandajo était des mieux en cour. Laurent l’affectionnait particulièrement. Il avait en outre trouvé un protecteur puissant et tout dévoué dans la personne de Francesco Sassetti, banquier florentin devenu l’homme d’affaires des Médicis, qui exerçait à la cour de Laurent les fonctions de fondé de pouvoirs, sinon de ministre du fastueux tyran de Florence.
C’est grâce à lui que Ghirlandajo peignit les fameuses fresques représentant six scènes de la vie de saint François, patron de Sassetti. 199 Cette commande lui en amena d’autres, et bientôt il fut considéré comme le premier peintre de fresques de son temps. Son chef-d’œuvre en ce genre est la série qu’il exécuta, avec son frère David, dans l’église Santa Maria Novella, pour Giovanni Tornabuoni, un autre de ses protecteurs; ces scènes représentent des scènes de la vie de saint Jean-Baptiste et de la Vierge.
Ces œuvres de Ghirlandajo témoignent d’une science de la composition très remarquable pour l’époque; il excellait à distribuer les personnages et les scènes de ses tableaux, sur les vastes murailles des églises, en groupes harmonieux et pittoresques. Mais, venu au monde en un siècle et dans une ville fortement marqués de paganisme, il manque d’émotion religieuse et de sentiment poétique. Il est charmant, ingénieux, habile, coloriste délicat et précieux, il n’est pas véritablement chrétien.
Mais il devient un artiste incomparable dès qu’il aborde le portrait et surtout le portrait de femme. Nul n’a exprimé avec plus de grâce voluptueuse le charme des fines et altières patriciennes de la riche cité toscane. La jeune fille que nous donnons ici est certainement l’une des plus belles qu’il ait peintes.
Quelques critiques pensent que cette peinture n’est pas due, au moins en sa totalité, au pinceau de Ghirlandajo, et l’attribuent à son beau-frère, Mainardi; mais cette opinion ne s’appuie sur aucun document sérieux.
Le Portrait de jeune fille figure à la “National Gallery” dans la salle III réservée à l’école toscane.
Hauteur: 0.43.—Largeur: 0.33.—Figure grandeur demi-nature.
NICOLAS MAËS
LA SERVANTE PARESSEUSE
SALLE X.—ÉCOLE HOLLANDAISE
203
La servante paresseuse
UNE maison bourgeoise de Hollande. Par la porte entr’ouverte
de la cuisine, on aperçoit une confortable salle à manger où
un homme et deux femmes sont en train de déjeuner. La
chaise restée vide est celle de la maîtresse de maison qui, n’entendant
pas dans la cuisine le bruit accoutumé des vaisselles remuées, s’est
dérangée, ménagère attentive, pour connaître les raisons de ce silence.
Et que voit-elle? Accroupie sur une chaise, la tête dans sa main, la
cuisinière s’est endormie sur son ouvrage, devant les plats et les
casseroles étalés en désordre. Pendant qu’elle dort ainsi, le chat de la
maison, grimpé sur le buffet, profite de son inattention et mord à
belles dents dans un gigot. La maîtresse de maison est une brave
femme, selon toute apparence. Au lieu de se fâcher et d’éveiller
rudement la dormeuse, elle épanouit sa bonne figure en un large
sourire et montrant la servante, elle semble prendre le spectateur à
témoin de la difficulté que l’on a à se faire servir. Le grave problème
des domestiques, on le voit, ne date pas d’aujourd’hui, il se posait déjà
au XVIIe siècle, mais avec moins d’acuité peut-être. Il y avait alors,
entre maîtres et serviteurs, des liens de cordialité qui n’existent pas de
nos jours et il entrait dans leurs rapports journaliers, plus de déférence
d’un côté, et de l’autre plus d’indulgence.
Nicolas Maës était passé maître dans la peinture de ces épisodes
familiers de la vie domestique. Avec lui nous pénétrons dans les
intérieurs hollandais et nous en surprenons l’existence intime, faite de
204
menus détails, notés d’un pinceau alerte et humoristique. Il ne se
complaît pas, comme Jan Steen ou Brauwer, au spectacle des buveurs
aux trognes enluminées, il ne va pas chercher ses modèles dans les
bouges enfumés du port d’Amsterdam ni dans les carrefours populaires
où se déchaînent les rondes bruyantes des maritornes et des paysans.
Son pinceau n’aime pas à s’encanailler. Les scènes de la vie bourgeoise
conviennent mieux à sa nature paisible, à son talent pondéré; il aime
peindre les causeries sous la lampe familiale, les parties de cartes près
de la haute cheminée où flambe un joli feu de bois. S’il lui arrive de
descendre dans la rue, les scènes qu’il représente sont pittoresques,
animées, amusantes, mais jamais débraillées. Ses personnages ne sont
pas des muscadins, mais ils ont de la tenue, ils sont décents.Nicolas Maës jouit d’ailleurs, dans sa ville, de l’estime générale; à la différence de la plupart de ses confrères, il mène une vie rangée, laborieuse, exempte de vices et de dettes. Les notables le chargent de portraiturer leurs filles et les magistrats de la cité ne dédaignent pas de poser devant lui.
Cette estime, il la mérite comme homme et comme peintre. Il possède un talent de premier ordre et peut marcher de pair avec les plus célèbres de son temps. Au surplus, il a de qui tenir: il est élève de Rembrandt et le maître, si difficile, apprécie de façon toute particulière le mérite de son élève. A cette rude et géniale école, Maës a appris jusque dans ses moindres détails l’art du dessin, qu’il aura toujours ferme et irréprochable; la science du coloris qu’il emploiera dans des tonalités moins violentes et plus gaies que celles de son maître, enfin le secret du clair-obscur que possédèrent plus ou moins tous ceux qui eurent l’honneur de travailler sous la puissante direction de Rembrandt.
Plus que tout autre, Nicolas Maës profita de ces leçons; il suffit, pour s’en convaincre, de jeter les yeux sur la Servante paresseuse, reproduite ici.
205 La qualité maîtresse de Nicolas Maës est le naturel. C’est un maître charmant que ce peintre et quoique son talent se soit exercé dans un cercle un peu limité de sujets, on ne saurait trop admirer la variété d’invention qu’il y a montrée, la fine observation de nature, l’harmonie de couleur et la finesse de touche qui le caractérisent. N’est-elle pas d’une vérité criante, cette servante endormie, la tête dans ses mains? Et n’est-elle pas aussi bien naturellement campée, la joviale maîtresse qui vient surprendre sa domestique en flagrant délit de paresse?
Quant à la couleur, elle est parfaite. Elle est claire, fraîche, d’une qualité qui lui a permis de résister à l’action du temps. Les ombres et les lumières sont distribuées avec une science, une virtuosité qui trahissent l’élève de Rembrandt. La salle à manger est noyée dans une demi-obscurité qui reste quand même lumineuse et ne laisse échapper aucun détail de l’ameublement et des personnages. Dans la cuisine même, le jour tombe d’une fenêtre qu’on ne voit pas et se distribue habilement sur les personnages principaux de la scène, les deux femmes. Le reste, qui n’est qu’accessoire, se révèle faiblement dans l’ombre, en demi-teintes atténuées et discrètes. Mais cette ombre n’est jamais opaque, la lumière y court et, en regardant bien, on y discerne les objets.
Certaines œuvres, attribuées à Nicolas Maës, ne présentent pas les mêmes qualités; elles sont même si manifestement inférieures qu’on se refuse aujourd’hui à y reconnaître sa main. Il est inadmissible, en effet, que le même artiste ait pu produire des chefs-d’œuvre et des compositions aussi médiocres.
La Servante paresseuse porte, à côté de la signature, la date de 1655. Elle a été léguée à la “National Gallery”, en 1846, par M. Richard Simmons. Elle figure dans la salle X, réservée à la peinture hollandaise.
Hauteur: 0.69.—Largeur: 0.54.—Figures: 0.41.
ROMNEY
Mrs. MARK CURRIE
SALLE XVIII.—VIEILLE ÉCOLE ANGLAISE
209
Mrs. Mark Currie
S’IL avait fondé sa réputation sur les sujets historiques ou
mythologiques auxquels il se complut un moment, Romney
n’aurait acquis qu’un renom médiocre et son œuvre ne lui aurait
pas survécu. Fort heureusement pour sa gloire, il a laissé une
magnifique suite de portraits qui le classent, à la suite de Reynolds et
de Gainsborough, parmi les représentants les plus illustres de la
peinture anglaise au XVIIIe siècle.
Peu connu sur le continent jusqu’à ces derniers temps, Romney
jouit dans son pays d’une vogue considérable, presque aussi éclatante
que celle de ses deux grands rivaux. Il y avait à Londres, dans le
monde des arts et de la Cour, deux partis opposés, l’un tenant pour
Romney, l’autre pour Reynolds. Lord Thurlow, attorney général,
devenu plus tard lord Chancelier, constate cette rivalité de gloire.
«Reynolds et Romney, écrit-il, se disputent les suffrages de la ville
et je suis du parti de Romney.»Dans ce parti se rangeaient aussi la plupart des femmes de la société anglaise dont Romney était devenu le portraitiste préféré. Il y avait une raison à cet engouement. Le pinceau délicat et flatteur de Romney savait trouver sur la palette les couleurs tendres qu’il fallait pour embellir et poétiser ses modèles. Toutes les femmes de Romney ont du charme, de la grâce, de la distinction, et celles qui posaient devant lui lui savaient gré de constater dans leur portrait des avantages que parfois elles ne découvraient pas dans leur miroir.
210 Reynolds ne pouvait s’empêcher de jalouser son rival; il l’appelait, avec un peu de dédain, «l’homme de Cavendish Square». C’est à Cavendish Square, que Romney possédait son atelier, en effet, où se pressait l’élite de l’aristocratie anglaise.
La postérité, qui voit plus juste parce qu’elle voit de plus haut et de plus loin, a départagé les deux rivaux. Elle assigne à Romney, malgré son incontestable talent, une place de second rang, après Reynolds et Gainsborough. Il est le premier parmi les peintres de deuxième ordre. Même dans ses œuvres les meilleures, l’art demeure un peu superficiel; l’âme apparaît rarement sur ses plus charmants visages; il s’inquiète peu de psychologie, de caractère. Le seul effort que l’on discerne dans cette peinture facile et brillante, c’est l’effort vers le «joli», qui fit beaucoup plus pour sa popularité que pour sa gloire véritable. Sa couleur est pure et limpide, sa manière simple et distinguée, son dessin gracieux et plaisant, mais son œuvre témoigne d’une absence de profondeur qui devient encore plus manifeste quand on l’examine d’ensemble. Ses toiles apparaissent alors avoir été coulées dans le même moule, exécutées d’après une formule invariable. Si Reynolds et Gainsborough firent de fâcheuses concessions aux conventions superficielles de leur époque, Romney en fut l’esclave absolu.
Il n’en a pas moins produit des œuvres qui, par la maîtrise de l’exécution, le brillant du coloris, l’élégante perfection du dessin, peuvent se comparer aux plus belles de Reynolds. Certains de ses portraits furent célèbres et le sont encore. De ce nombre est la gracieuse effigie de Mrs. Mark Currie, reproduite ici.
La jeune femme est représentée assise dans un parc, devant un fond de verdure qui met en pleine valeur sa fine beauté blonde. Ses cheveux abondants et bouclés encadrent le plus délicieux visage qu’on puisse voir. Elle incline légèrement la tête vers la droite, dans une attitude de rêverie; son coude gauche s’appuie à une balustrade de 211 pierre. Elle est vêtue dune robe de mousseline blanche, serrée à la taille par une ceinture d’un rouge éteint; des rubans de même couleur sont noués aux bras et à l’échancrure du corsage. Le cou et les bras sont d’une admirable pureté de lignes. A travers les balustres de la terrasse, le regard s’étend sur un paysage de verdure et d’eau et sur un beau ciel bleu.
Charme, finesse, distinction, toutes les qualités de Romney se retrouvent dans ce charmant portrait. Il n’en a jamais peint de supérieur à celui-là, exception faite toutefois pour la Fille du pasteur, que nous retrouverons d’ailleurs dans cette galerie.
Mrs. Mark Currie s’appelait Élizabeth Cloze, de son nom de jeune fille. Elle épousa, en 1789, M. Mark Currie, riche banquier qui résidait à Upper Gatton, dans le Surrey.
«En réalité, écrit M. Armand Dayot, c’est à la peinture du portrait que Romney doit le plus pur de sa gloire. Il n’a ni la science profonde, ni la somptuosité de touche de Reynolds; la distinction acquise de son art ne s’élève pas à l’aristocratique instinctivité des Gainsborough; et si la sécheresse de son dessin, parfois un peu hésitant, impressionne péniblement le regard, l’œil se réjouit au spectacle des colorations délicates et chaudes qui, comme un doux reflet corrégien, baignent ses gracieuses figures de femmes.»
Mrs. Mark Currie fut acheté en 1898 au Révérend Sir Frederick T. Currie pour 87.500 francs. C’est le prix le plus élevé qu’ait payé la “National Gallery” pour une peinture anglaise. Elle figure dans la salle XVIII, réservée à l’ancienne école anglaise.
Hauteur: 1.51.—Largeur: 1.20.—Figure grandeur nature.
PIERO DELLA FRANCESCA
NATIVITÉ
SALLE VI.—ÉCOLE OMBRIENNE
215
Nativité
QUELLE ravissante chose que cette Nativité si l’on se reporte
à l’époque où vécut son auteur! Quel charme dans le
détail et quel délicat parfum de piété véritable dans cette
composition naïve! Conçu dans une forme inattendue et pittoresque,
l’événement fameux de la naissance du Christ nous captive et nous
enchante par sa variété, son imprévu et aussi sa beauté réelle.
Rien ne rappelle la scène admise et consacrée par les Livres Saints.
L’étable creusée dans le roc s’est transformée en une sorte de
hangar, fait de quelques planches disposées en auvent. Contrairement
aussi à toutes les traditions, ce n’est pas dans la nuit glacée de
décembre que se déroule le grand prodige, mais sous le clair soleil de
l’Italie, dans un paysage toscan où se profilent les tours de la ville
d’Arezzo.
Mais si le décor est moderne, le sujet est bien conforme à la vérité
historique. Le lieu où le peintre l’a placé est une lande aride et désolée
et tout, dans les personnages et les choses, trahit la pauvreté dans
laquelle voulut naître l’Homme-Dieu. Le voici, Celui qui commande
dans les Cieux et sur la terre, couché tout nu sur un pan du manteau
de la Vierge, à même le sol raboteux et dur. Devant lui, agenouillée
dans une pose de prière et d’adoration, sa divine Mère joint les mains
et contemple, avec un respect mêlé d’amour, le fruit béni de ses
entrailles. Piero della Francesca, ignorant du costume comme tous les
peintres de son époque, a revêtu la Vierge d’une robe bien ajustée,
216
comme en portaient alors les dames florentines. Un peu en arrière et
à droite, saint Joseph se tient assis sur le bât de son âne. Comme
étranger à la scène, il croise ses mains sur sa jambe repliée. Il porte
une sorte de souquenille noire et un bonnet où pend un gland d’or. A
côté de lui, debout, on aperçoit deux bergers. Au fond, sous l’auvent
de l’étable, le bœuf allonge sa bonne tête aux yeux ronds tandis que
l’âne, le museau levé, la bouche entr’ouverte découvrant les dents, a
l’air de braire de contentement.Mais le groupe principal du tableau, c’est le groupe des cinq anges qui, debout devant l’Enfant-Dieu, célèbrent sa gloire par leurs chants. Deux d’entre eux s’accompagnent avec des violes.
Ce groupe est une véritable merveille d’exécution. Les visages ont une beauté qui rappelle les plus parfaites créations de Raphaël, la ligne des corps est admirable et les robes sont drapées avec un art supérieur. En présence de ces anges, on ne peut s’empêcher de penser à ces figures célestes que le divin Angelico tressait comme une couronne de clartés autour du trône de la Vierge.
Au temps où vivait Piero della Francesca, les peintres s’attachaient surtout à exprimer le visage humain, et négligeaient assez volontiers l’exécution du corps que leur inexpérience de l’anatomie leur rendait plus difficile. Devançant son époque, Piero della Francesca fit montre, dans l’étude du corps, d’une science remarquable dont on ne trouve aucun autre exemple dans les œuvres de la même période. Il possédait à un égal degré le don de l’observation et il savait donner à ses personnages le caractère qui leur convenait.
On classe généralement Piero della Francesca, ou dei Franceschi comme on l’appelle aussi, parmi les premiers maîtres de l’école ombrienne. Mais né à Borgo San Sepolcro, en Toscane, vers 1415, il doit être rattaché à l’école florentine, qui fut l’inspiratrice de son art. Domenico Veneziano, dont il fut l’élève, l’initia à la technique de la peinture à l’huile et l’incita à la recherche du caractère tandis que 217 l’étude approfondie de Paolo Uccello attirait son attention vers les problèmes de la perspective. Son œuvre est considérable et nous le voyons durant sa vie parcourir toutes les villes de la péninsule pour y exécuter des commandes. Il reste malheureusement peu de chose de cet artiste, mais on peut admirer aujourd’hui encore, dans l’église Saint-François d’Arezzo, des fresques remarquables dues à son pinceau représentant les légendes de la Croix. Esprit scientifique et clair, Piero s’était passionné, dès son jeune âge, pour l’étude des sciences exactes et le fameux mathématicien Luca Pacioli, fut son élève et son ami. Très versé dans son art, il écrivit un traité de perspective, dédié au duc d’Urbin, qui était très estimé et qui pendant longtemps a fait autorité parmi les architectes et les peintres.
Piero della Francesca a manifestement ouvert la voie, par sa technique savante, aux grands peintres qui l’ont suivi et il exerça sur le développement artistique de son temps une influence qui n’est pas douteuse. Il fut le premier peintre qui comprit l’importance de la valeur des tons et qui donna de l’atmosphère à ses tableaux. On pourrait dire qu’il fut le précurseur des peintres de plein air dont le XIXe siècle a marqué l’éclosion.
Aussi comprend-on que le registre mortuaire de sa ville natale, en inscrivant son décès, ait qualifié de peintre fameux Maestro Piero Benedetto dei Franceschi, mort le 12 octobre 1492.
La “National Gallery” a l’heureuse fortune de posséder deux œuvres de cet éminent artiste, le Baptême du Christ et la Nativité, reproduite ici. Elles figurent l’une et l’autre dans la salle VI, réservée à l’école ombrienne.
Hauteur: 1.33.—Largeur: 1.21.—Figures: 0.66.
TERBURG
PORTRAIT D’HOMME
SALLE XI.—ÉCOLES FLAMANDE ET HOLLANDAISE
221
Portrait d’homme
L’APPARITION de Terburg dans l’art hollandais marque
une date intéressante. Avec lui cet art se modifie, s’oriente
vers des routes inusitées et fait effort pour s’élever au-dessus
de la formule en honneur jusque-là. Ce que furent les peintres
qui le précédèrent et même ses contemporains, nous le savons déjà:
de joyeux vivants, artistes remarquables, techniciens de premier
ordre, esprits humoristiques ou truculents, mais bornant leur horizon,
par le fait même de leurs qualités et de leurs défauts, à la taverne où
tous les jours ils venaient s’asseoir. Mêlés à ce monde de buveurs
et de paysans, ils ne conçoivent pas qu’on puisse chercher ailleurs
les modèles et les sujets de peinture. Ceux qui ne peignent pas les
ivrognes ne placent guère plus haut leur idéal: du cabaret ils passent
à la cuisine, ou s’il leur arrive de monter jusqu’au salon, ce
n’est jamais que dans le salon de petits bourgeois où leur tournure
d’esprit railleuse leur fait encore découvrir des laideurs et des ridicules.
Ne les chicanons pas sur ce goût, puisqu’il a produit ces œuvres
charmantes de fantaisie et de couleur que les musées et les collections
se disputent aujourd’hui. Ces piliers d’estaminet furent d’incomparables
maîtres: à Jean Steen, à Franz Hals, à Brauwer, à Van Ostade,
à Nicolas Maës on doit de connaître et d’aimer cette Hollande de
jadis, joviale et débraillée, qui nous semble si pittoresque dans ses
oripeaux brillants et dans ses frénésies de ripailles.
Terburg, lui, ne fréquente pas les auberges; sa palette ne traîne
222
pas sur les tables, au milieu des chopes et des pipes. Il appartient à
une famille où l’on a de la tenue et à un siècle qui tend déjà à l’élégance.
Comme tous les autres pays d’Europe, la Hollande subit
l’influence, occulte d’abord, victorieuse ensuite, de l’esprit et du goût
français, entrés dans les Pays-Bas à la suite des armées du Grand Roi.
La société hollandaise, insensiblement, s’affine et, comme il arrive
toujours, elle trouve son peintre et son historiographe.Ce peintre fut Terburg. Il a consacré son pinceau aux personnages de bonne compagnie; les intérieurs qu’il nous montre sont riches, confortables et élégants. Il fait aussi des portraits, mais seulement de gens bien nés, ayant de l’éducation et du linge.
Ce n’est évidemment pas un homme du commun, le personnage représenté ici, dans son pompeux costume noir. Il appartient à l’aristocratie, à en juger par la distinction de son visage et la finesse de sa main. Mais quel bizarre accoutrement! Sur la perruque aux boucles ondulées est posé un chapeau à larges bords et terminé en pyramide, assez semblable à celui des médecins de Molière. Sous la collerette de dentelle s’agrafe un manteau de cour, qui cache à demi le justaucorps et les manches de linon. Le haut-de-chausses affecte la forme d’un tablier et les jambes sont ornées de bouffettes noires qui les couvrent entièrement et qui ne laissent apercevoir que le bout carré d’un soulier à la plus pure mode du temps.
Pour adoucir un peu la sévérité de ce portrait, traité dans la note sombre, Terburg l’a fort habilement encadré entre la double tache pourpre d’un tapis et d’une chaise, placés à côté du personnage.
Très Hollandais en dépit de ses tendances novatrices, Terburg a toutes les qualités des peintres de son pays, un souci minutieux du détail, la constante préoccupation de la vérité et une splendeur de coloris remarquable. A ces dons, il ajoute le mérite d’avoir élégantisé la manière hollandaise, sans lui rien enlever de sa saveur pittoresque. 223 Bien que vêtus élégamment, ses personnages fleurent bon le terroir néerlandais; ils sont bien de Haarlem ou d’Amsterdam.
Terburg naquit à Zwolle en 1617. Il étudia tout d’abord la peinture avec son père, artiste d’un certain mérite qui avait voyagé en Italie; il entra ensuite dans l’atelier de Peter Molyn le Vieux, avec lequel il travailla à Haarlem jusqu’en 1635. Dès son jeune âge, Terburg manifesta une véritable vocation pour l’art, ses premiers dessins témoignent d’un talent précoce et remarquable. Mais, désireux de se perfectionner, il voyage en Europe, visite l’Italie, l’Espagne, la France et l’Angleterre, où il fait un assez long séjour. Puis, après un passage assez court à Amsterdam, nous le retrouvons, de 1646 à 1648, fixé à Munster où il exécute sa toile célèbre de La paix de Westphalie, qui est son chef-d’œuvre. Les autorités de la ville refusèrent de lui payer les 6.000 florins qu’il réclamait pour ce tableau et il dut le garder dans son atelier jusqu’à sa mort. En Espagne, où il se rend ensuite, il est flatteusement accueilli par le roi Philippe IV, protecteur de Velazquez; et quand il rentre à Zwolle, son pays natal, il jouit d’une réputation considérable. L’aristocratie et la haute bourgeoisie de Hollande l’adoptent comme peintre et il ne peut suffire aux commandes de portraits qui lui arrivent de toutes parts. Il se délasse de ces travaux en exécutant ces ravissantes scènes d’intérieurs, ces Conversations, ces Leçons de musique, aujourd’hui si célèbres et si recherchées.
Terburg fut le maître de Gaspard Netscher qui accentua encore sa note élégante, avec une pointe d’afféterie qui marque déjà la décadence. Le Portrait d’homme fut acheté par la “National Gallery” à Sir Charles Eastlake, pour la somme de 1.875 francs. Il figure dans la salle XI, réservée aux écoles flamande et hollandaise.
Hauteur: 0.66.—Largeur: 0.53.—Figure: 0.61.
TINTORET
L’ORIGINE DE LA VOIE LACTÉE
SALLE VII.—ÉCOLE VÉNITIENNE
227
L’origine de la voie lactée
VASARI, qui n’aimait pas Tintoret, lui décerne cependant
cet éloge, dans son livre des Vies des Peintres:
«Il charme en jouant sur des instruments de musique
variés; il a la main la plus capricieuse, le cerveau le plus
hardi, le plus obstiné qui ait jamais appartenu à un peintre. La
preuve en est dans ses œuvres d’une composition si capricieuse et si
différente de toutes les autres.»Avec un peu plus de justice, Vasari aurait pu pousser plus loin son dithyrambe et mesurer l’éloge d’une main moins parcimonieuse. La postérité s’est, d’ailleurs, chargée de rendre à Tintoret sa véritable part de gloire et elle l’a définitivement placé à côté de ses deux grands rivaux vénitiens, Titien et Véronèse.
Tintoret fut, avec Véronèse, l’élève du Titien, dans l’atelier duquel il entra tout jeune. Si l’on en croit Ridolfi, le maître et l’élève ne sympathisèrent pas, Titien s’étant montré jaloux, dès le début, des éminentes qualités de peintre qu’il découvrit chez le jeune artiste. Des querelles s’élevèrent et, un jour, Titien ayant trouvé des copies de ses propres œuvres si habilement faites qu’on les pouvait confondre avec l’original, il chassa Tintoret de son atelier. Il affecta toujours d’ignorer son mérite; grand dispensateur des commandes officielles, il n’en réserva jamais aucune à son ancien élève.
Mais celui-ci était doué d’une foi robuste et d’un courage à toute épreuve. Admirateur passionné d’un maître dont il n’estimait pas le 228 caractère, il s’efforça de pénétrer la manière du Titien, de surprendre le secret de sa couleur, en un mot de devenir un maître à son tour. Il y parvint à force de persévérance et de travail: il était d’ailleurs servi par une prodigieuse facilité. Toujours le pinceau à la main, il acceptait toutes les commandes, quel qu’en fût le prix, plutôt que de rester désœuvré; il était devenu la terreur de ses concurrents qui l’avaient surnommé Il Furioso. Sa production est extraordinaire: quoique nombre de fresques et de tableaux aient été détruits, il existe encore de lui plus de six cents ouvrages créés pendant les soixante-quinze années de sa vie; ce qui se trouve au palais des Doges, à Venise, suffirait seul à glorifier une longue existence d’artiste laborieux.
Ce n’est pas de sa faute si le spectateur se déconcerte devant ses toiles; on ne saurait l’étudier rapidement. En passant des autres peintres à lui, il faut une attention durable, une connaissance expérimentée. C’était un artiste d’une vision si large, d’une conception si magnifique qu’on ne doit l’approcher qu’avec une sorte de vénération; nous ne pouvons aller à lui comme au Titien ou à Véronèse et apprécier d’un regard des toiles qui coûtèrent des années de travail. John Ruskin, devant son formidable Paradis de la Salle du Grand Conseil, à Venise, demeure confondu et se résigne à l’admirer par fragments, se sentant écrasé par l’immensité de l’œuvre. A lire certains critiques qui n’ont pas su s’élever à la hauteur du Tintoret, on se rend compte que si des restrictions ont été faites, c’est parce que le thème si vaste, la facture si brillante ont déconcerté les générations successives; sa théorie de la relativité des couleurs a été mal comprise et mal interprétée: il fallait l’éclosion de l’impressionnisme pour que justice lui soit pleinement rendue.
On ne le discute plus aujourd’hui: peintre de fresques, peintre d’histoire, d’allégories, de mythologie, portraitiste, il apparaît toujours prodigieux, par sa profonde science technique, par la beauté de son coloris et par la fantaisie de son imagination.
229 Ces qualités maîtresses de Tintoret, on les retrouve à un degré supérieur dans ce magnifique tableau de la Voie lactée, l’un des plus beaux chefs-d’œuvre du maître, que nous donnons ici.
Rien de plus ingénieux et de plus harmonieux à la fois que la composition de cette œuvre. On connaît la légende mythologique: Junon, en allaitant Hercule, laissa échapper de son sein quelques gouttes de lait qui, en se répandant sur le firmament, formèrent cette traînée blanchâtre et lumineuse qu’on aperçoit au ciel, pendant les nuits sereines. C’est cet épisode de la Fable que Tintoret a traité avec une prodigieuse fantaisie.
Dans un lit de repos porté sur les nuages, Junon, reine de l’Olympe, est à demi couchée et sa splendide nudité blonde fait une tache de lumière dans la splendeur azurée du ciel. Apporté par Jupiter, Hercule s’accroche au sein de la déesse et nous voyons des fusées de lait jaillir en étoiles. On aperçoit au pied du lit le paon, l’oiseau symbolique de Junon et, au second plan, l’oiseau de Jupiter, tenant entre ses serres la foudre du maître des dieux. Tout autour de Junon volètent des amours, porteurs de flèches et de flambeaux.
On a tout dit sur l’incomparable beauté du coloris vénitien, porté par Tintoret et Véronèse aux dernières limites de la perfection et que l’action corrosive des siècles n’a pu réussir à éteindre. Signalons aussi la prodigieuse science de Tintoret dans l’art du raccourci, et l’extraordinaire tour de force de ces amours et de Jupiter suspendus en plein ciel. On ne peut leur comparer que l’ange figurant dans le Miracle de Saint Marc, du même peintre.
L’origine de la voie lactée appartient à l’ancienne collection; elle figure à la “National Gallery” dans la salle VII, réservée à l’école vénitienne.
Hauteur: 1.47.—Largeur: 1.66.—Figure grandeur nature.
GÉRARD DAVID
UN CHANOINE ET SES SAINTS PATRONS
SALLE IV.—ÉCOLE PRIMITIVE FLAMANDE
233
Un chanoine et ses saints patrons
GÉRARD DAVID est l’un des plus illustres successeurs de
Hans Memling; beaucoup de critiques le considèrent même
comme son égal. Avec Gérard David, qui est représenté
à la “National Gallery” par deux de ses plus beaux chefs-d’œuvre,
l’art flamand du XVe siècle touche à sa fin. C’est le suprême et complet
épanouissement de cette école glorieuse dont les frères Van Eyck
furent les fondateurs. David est le dernier représentant d’une tradition;
ses élèves ne le suivront que de très loin et laisseront déchoir un art
qui fut porté si haut.
L’année 1500 marque le point de départ d’une ère malheureuse
pour Bruges; le XVIe siècle fut particulièrement néfaste à cette
ville jusqu’alors si florissante. Commercialement, elle fut détrônée par
Anvers, et les luttes provoquées par la Réforme achevèrent sa ruine.
Mais en 1483, à l’époque où y arriva Gérard David, venant de
Hollande, Bruges était encore la reine des Flandres. Dès l’année
suivante, sa réputation de peintre lui valait l’admission comme
membre de la Gilde de saint Luc.Comme la plupart des peintres qui illustrèrent les Flandres, Gérard David venait du Nord. La Flandre positive et mercantile n’avait que peu de dispositions naturelles pour les arts, et si les peintres s’y établirent, c’est que la richesse de ses villes leur offrait de plus grandes chances de fortune,
Fiers de leurs trésors, les marchands enrichis commandaient de 234 nombreux retables et des tableaux qu’ils offraient aux églises, conciliant ainsi leur piété réelle avec leur vanité de parvenus. Gérard David fut un des fournisseurs les plus appréciés de la bourgeoisie brugeoise. Il jouissait de l’estime générale, et il épousa en 1496 Cornélia Knopp, fille d’un riche et habile joaillier de la cité, où il résida jusqu’à sa mort, survenue le 18 août 1523.
L’art de Gérard David présente de nombreuses analogies avec celui de Quentin Matsys, son grand rival d’Anvers. C’est la même noblesse dans l’expression des physionomies, la même minutieuse recherche du détail, le même fini de l’exécution mis en honneur, dès l’origine, par les frères Van Eyck. L’un et l’autre s’efforcèrent de découvrir des expressions nouvelles, des idées nouvelles, un style nouveau; l’un et l’autre ils surent imprimer à leurs créations une intense ardeur de vie, une émotivité profonde dont aucun de leurs prédécesseurs, Memling excepté, n’avait su animer sa peinture.
Gérard David a de la flamme, de l’émotion, de la sensibilité; sa piété n’est pas seulement apparente, elle est réelle, intime et transparaît sur le visage de ses Vierges et de ses Saints. Son art a de la magnificence, sa technique de la vigueur, son coloris un éclat incomparable. Il possède la palette de Van Eyck avec l’âme de Memling. De Memling à Gérard David, la filiation est directe, immédiate, incessante; et l’influence exercée par l’œuvre de Gérard David sur les destinées ultérieures de la peinture flamande n’est pas niable, c’est elle qui a éveillé et entretenu dans l’âme de Rubens le culte de la beauté.
Un chanoine et ses saints patrons, que nous donnons ici, est une des plus admirables œuvres de l’artiste. Elle représente le donateur, Bernardino de Salviatis, chanoine de l’église Saint-Donatien de Bruges, agenouillé, les mains jointes, vêtu d’un long surplis sur sa soutane bordée de fourrures. A côté de lui, le regardant, se tient debout saint Donatien, patron de son église, en costume épiscopal avec 235 la mitre d’or, tenant la crosse de la main droite et portant dans la main gauche son symbole, une roue piquée de sept chandelles. Derrière lui, le patron du donateur, saint Bernard, revêtu de la robe de son ordre, pose légèrement la main sur l’épaule du chanoine, suivant l’usage adopté dans ces tableaux, comme pour bien montrer qu’il a placé son protégé sous son égide. A la droite de saint Bernard, se trouve saint Martin, couvert d’une somptueuse chape pourpre et or, mitre en tête et s’appuyant sur une riche crosse d’or ciselé; de la main droite levée, il bénit le donateur agenouillé. En arrière du groupe, dans un sentier, on aperçoit un mendiant qui chemine en s’appuyant sur une béquille.
Gérard David a situé la scène de son tableau dans un magnifique cadre de verdure qui montre bien à quel degré les Flamands de cette époque—supérieurs en cela aux Italiens—possédaient le sentiment de la nature. Il est impossible de trouver un paysage plus parfait, avec de plus opulents feuillages, des collines plus fraîches, un ciel plus limpide.
Quant à la couleur, elle est absolument admirable, par sa fraîcheur et son éclat, demeurés, après quatre siècles, aussi brillants qu’au premier jour. Et elle est aussi harmonieuse que brillante, parce qu’elle est distribuée avec une science que les Flamands et les Hollandais possédèrent au plus haut degré.
Cette magnifique peinture appartint, de 1792 à 1859, à M. Thomas Barrett, de Lec Priory, dans le Kent. Elle fut acquise, en 1859, par M. William Benoni White, qui l’a léguée, en 1878, à la “National Gallery”, où elle figure aujourd’hui dans la salle IV, réservée à la peinture flamande.
Hauteur: 1.02.—Largeur: 0.93.—Figure: 0.93.
C. CRIVELLI
L’ANNONCIATION
SALLE VIII.—VIEILLE ÉCOLE VÉNITIENNE
239
L’Annonciation
VOILA certainement l’une des plus extraordinaires interprétations
des scènes du «Nouveau Testament». Jamais
peut-être la fantaisie d’un peintre ne s’est donné plus
libre carrière, jamais en tout cas on n’a traité un sujet religieux
avec un plus parfait dédain de la vraisemblance et de la vérité
historique. Et cependant cette peinture, anachronique au premier
chef, nous ravit dès l’abord; elle nous enchante par l’abondance du
détail pittoresque, par les trouvailles ingénieuses ou naïves d’une imagination
fertile, par le luxe de l’ornementation et la richesse architecturale
et, disons-le aussi, par la science d’une technique très avancée
pour l’époque où vécut Crivelli.
Que de charmantes choses dans ce tableau, l’un des plus grands
que possède la “National Gallery”! Dans l’esprit du peintre, la Mère
de Dieu ne pouvait être placée que dans un cadre somptueux et, sans
plus de recherches, il lui aménage la plus brillante demeure qui se
puisse voir. Comme nous voilà loin de l’humble maison de Galilée
où nous savons que vivait Marie! Ici, tout n’est que marbres,
colonnes décorées, frises sculptées, plafonds à caissons, tapis aux
couleurs éclatantes. A ce palais on accède par une ruelle magnifique
bordée d’autres palais; au second plan, un beau portique supporte
une terrasse où se promènent de riches oisifs. Par la porte entr’ouverte
de la maison de la Vierge, on aperçoit un intérieur coquet, orné de
jolis meubles et de tapis riants. Sur une tablette accrochée au mur,
240
sont posés des objets familiers, les flacons voisinant avec les livres.
Mais voici la Vierge elle-même, agenouillée et lisant un livre pieux
placé sur un prie-Dieu. Au-dessus de son front plane l’Esprit-Saint,
venu du ciel bleu dans un rai de lumière d’or. C’est le premier acte de
la maternité divine qui s’accomplit. D’ailleurs, l’archange est au dehors,
envoyé par Dieu le Père pour annoncer à son humble servante
qu’il l’a choisie pour devenir la mère du Rédempteur. C’est un véritable
bijou de compréhension naïve et charmante que ce messager
céleste. Le peintre l’a revêtu des plus somptueux habits; sa robe est
toute de pourpre et d’or et ses ailes s’ornent de plumes multicolores.
Sous le casque, insigne de son rang, une abondante chevelure blonde
encadre un visage plein de grâce; dans sa main gauche, il tient un lis,
emblème de la pureté de la Vierge. A côté de l’archange, le peintre a
placé saint Égide, patron d’Ascoli, le tableau étant destiné au couvent
de l’Annonciation de cette ville. Ce bienheureux a, sous la mitre et la
chape épiscopales, un joli visage de jeune homme, presque d’enfant.
Pour ne laisser aucun doute sur sa personnalité, Crivelli lui a mis
entre les mains le plan en relief de la cité dont il est le protecteur.Autour de ces personnages principaux, le peintre a multiplié les comparses. Dans le fond de la venelle, on aperçoit des bourgeois et des dames qui circulent. Au second plan à gauche, sur une terrasse étroite, trois hommes s’entretiennent pendant qu’un enfant se penche pour contempler la scène inusitée qui se déroule au-dessous de lui. Que de détails encore, gracieux ou bizarres, on trouve dans ce tableau! Ici, c’est un paon qui étale son plumage multicolore; là, des oiseaux s’ébattent sur des perchoirs piqués dans le mur; un peu partout, ce sont des pots de fleurs, et, sur le sol, au tout premier plan, on s’étonne de trouver un concombre et une pomme. Au bas du tableau, entre les armes de l’évêque d’Ascoli, devenu pape plus tard sous le nom d’Innocent VIII, on lit la devise latine Libertas ecclesiastica, donnée par ce pontife à la cité dont il avait été le pasteur. Elle signifie: 241 «Indépendance sous la protection de l’Église.» Au bas du chambranle gauche de la porte, le peintre a mis sa signature: Opus Caroli Crivelli Veneti.
Crivelli appartenait, en effet, à une famille vénitienne. On ne sait que peu de chose sur sa jeunesse, sur ses maîtres et l’on ignore même la date précise de sa naissance, que l’on place approximativement à l’année 1430. On sait toutefois qu’il vient en 1468 à Ascoli, dans les marches d’Ancône, et on l’y voit travaillant pour les églises de la ville, peignant des fresques et des autels. L’un de ses plus beaux tableaux de cette époque, qui se trouve également à la “National Gallery”, est la Vierge et l’Enfant sur le trône, entourés de Saints. Son œuvre fut très considérable; mais elle subit le sort de la plupart des fresques, qui disparurent avec les monuments qu’elles décoraient ou qui se sont effritées sous l’action du temps.
Mais ce qui en reste suffit à témoigner de l’originalité du talent de Crivelli. Il fut le contemporain de Mantegna et de Pérugin. Il ne posséda ni le savoir profond du premier ni la suavité du second, mais il n’en est pas moins un peintre de premier ordre par la beauté classique du dessin et par l’harmonieuse variété de sa couleur. Ses figures ont un charme teinté de mélancolie encore accentuée par la teinte porcelainée qu’il donne aux carnations.
Venu un siècle plus tard, Crivelli, avec son instinctive science de la peinture et son intarissable richesse d’invention, serait peut-être devenu un second Véronèse. Tel quel, il est un des peintres les plus charmants du XVe siècle.
Peinte à la détrempe, pour le couvent d’Ascoli, l’Annonciation y demeura jusqu’en 1770. Elle fut offerte à la “National Gallery”, en 1864, par lord Taunton, alors M. Labouchère. Elle figure dans la salle VIII, réservée à l’école de Padoue et à la vieille école vénitienne.
Hauteur: 2.09.—Largeur: 1.48.—Figures: 0.52.
HOGARTH
LE MARIAGE A LA MODE
SALLE XIX.—VIEILLE ÉCOLE ANGLAISE
245
Le Mariage à la mode
HOGARTH a été le peintre le plus parfait des ridicules anglais
au XVIIIe siècle, dans le peuple, dans la bourgeoisie et dans
l’aristocratie. Ces divers mondes, il les connaît à fond pour
les avoir successivement fréquentés et observés. Enfant, il avait vécu
dans des ateliers d’imprimerie et le temps que n’absorbait pas son
métier d’apprenti, il l’employait à vagabonder à travers les rues du
quartier avec les polissons de son âge. Plus tard, il s’éleva d’un
échelon, gravit la classe supérieure et pénétra dans la bourgeoisie
dont les qualités, en Angleterre comme partout, s’accompagnent
presque toujours de certaines manies. Hogarth que la causticité naturelle
de son esprit et sa gouaille populaire inclinaient à la satire,
observait tout, notait tout et transcrivait ses impressions en des caricatures
et des tableaux d’une verve cinglante. Le grand monde ne
tarda pas à lui ouvrir ses portes, quand la réputation lui fut venue, et
ne se douta pas qu’il introduisait chez lui un impitoyable critique, à
qui rien n’échapperait de ses vices ou de ses tares. Il fut le premier
des grands humoristes, le précurseur d’un genre que l’esprit français
a, de nos jours, porté aux extrêmes limites de la perfection.
La transposition de ses œuvres satiriques en planches gravées
contribua puissamment à sa réputation en répandant à des milliers
d’exemplaires ses boutades et ses railleries. «Ce qui, dans ses peintures
nerveuses et cruelles, excitait surtout la curiosité publique, c’était
la mimique grotesque des physionomies derrière lesquelles le spectateur
246
se plaisait à rechercher et à découvrir, sans grande difficulté
d’ailleurs, des figures très connues. Dans ses tableaux comme dans
ses dessins, gravures, documents d’histoire physionomiques, du plus
grand intérêt, Hogarth a fixé d’un trait sûr et impitoyable les traits,
les gestes, les grimaces des gens du peuple observés dans la rue, dans
les tavernes, dans tous les mauvais lieux et aussi les mises et attitudes
fausses ou maniérées des gens du théâtre ou du monde, utilisant pour
le dessin de sa vaste comédie humaine la somme énorme des
matériaux documentaires recueillis dans ses flâneries à travers les
bouges, les tripots, les coulisses et les salons.» (Armand Dayot.)C’est le monde des salons, précisément, que met en scène Hogarth, dans sa série du Mariage à la mode qu’il exécuta en 1745 et qui comprend une suite de six peintures, actuellement exposées à la “National Gallery”. Cette étincelante satire en six actes suffirait à la gloire d’un peintre. «A vrai dire, c’est la plus complète expression des tendances philosophiques et satiriques du maître, et jamais la causticité de son pinceau n’eut de plus savantes affirmations. Ici, le peintre se révèle avec éclat à côté du moraliste, et l’œil et l’esprit se réjouissent également au spectacle lumineux et vivant des pièces diverses qui forment la série des multiples péripéties du Mariage à la mode et qu’on peut examiner tout à loisir sur une des cimaises de la “National Gallery”.»
«Hogarth a divisé son drame comique en six actes, disons en six tableaux: le Contrat de mariage, l’Intérieur du jeune ménage, la Visite chez l’empirique, le Petit lever de la comtesse, le Duel et la mort du comte, la Mort de la comtesse.» (Armand Dayot.)
C’est le deuxième acte, l’intérieur de la comtesse, que nous montre le tableau représenté ici. Peu après le mariage, dit la notice. Cet intérieur ne manque pas, certes, de pittoresque et, au premier coup d’œil, nous découvrons que l’ordre et l’économie n’y règnent pas. Le décor est très riche, l’appartement se prolonge en un salon tout peuplé de tableaux de maîtres, mais il suffit de regarder les personnages pour 247 se convaincre que la gêne, peut-être même la ruine, menacent ce luxueux logis. Nous sommes au petit jour; le mari vient de rentrer, après une nuit de débauche; il s’affale sur un fauteuil, l’habit défait, débraillé et, les mains enfoncées dans les poches, il subit d’un air indifférent les invectives de sa femme qui a passé la nuit à l’attendre.
A gauche du tableau, on aperçoit le vieux maître d’hôtel, les mains pleines de billets qu’on n’a pu payer et qu’on ne payera pas; il s’éloigne navré, en levant les yeux au ciel. Évidemment, Hogarth a connu ce ménage, et peut-être beaucoup de ménages semblables; nous savons trop bien que cette histoire est éternelle.
«Il est difficile de découvrir dans l’histoire de la peinture anglaise des documents plus fidèlement représentatifs d’une époque. Dans le cadre si précis des accessoires, les personnages apparaissent doués d’une vie si réelle, qu’à leur vue l’évocation historique se produit immédiate et le spectateur se trouve immédiatement transporté au foyer dévasté d’une de ces familles de la haute société anglaise atteinte par la dissolution générale des mœurs.» (Armand Dayot.)
Hogarth ne toucha que 3.150 francs, en 1750, pour les six toiles du Mariage à la mode que Sir Augustin paya, trente ans plus tard, 34.325 francs. C’est ce collectionneur qui les a léguées à la “National Gallery” où elles figurent aujourd’hui dans la salle XIX, réservée à la vieille école anglaise.
Hauteur: 0.68.—Largeur: 0.88.—Figures: 0.34.
VELAZQUEZ
PHILIPPE IV
SALLE XIV.—ÉCOLE ESPAGNOLE
251
Philippe IV
LE Philippe IV de la “National Gallery” représente le
monarque aux environs de la quarantaine. Ce n’est plus le
mince jeune homme qu’une haute stature fait paraître légèrement
efflanqué; ses joues maigres se sont emplies, un double menton se
pose sur la fraise de dentelle et un léger embonpoint lui donne une
plus grande apparence de majesté. Mais la chair envahissante a
transformé le masque sans l’altérer: toutes les caractéristiques de la
race s’y retrouvent. C’est le même visage étroit, aplati sur les
tempes; l’œil a cette même fixité inquiétante de jadis, où se lisent
l’orgueil de la race et une sorte d’hébétude tranquille, un peu cruelle,
qu’on remarque dans le regard des fauves. Le haut du visage, avec le
front haut, ne manque pas d’intelligence; le bas, au contraire, avec la
lèvre autrichienne tombante, le menton empâté et lourd, accuse la
déchéance commençante qui, si vite, va plonger dans une quasi-imbécillité
les tristes descendants de Charles-Quint. La rude griffe du
destin ne s’est pas encore trop violemment imprimée sur la face
ronde de Philippe IV; ce monarque n’est qu’au premier échelon de
cette émouvante et tragique descente d’une dynastie s’abîmant dans
le néant. Ce roi possède un certain air de noblesse qui trahit son
illustre origine; on ne devinerait pas, au seul examen de ces traits,
que, derrière le masque énergique, se cache une volonté faible, une
humeur fantasque, un médiocre esprit. Comme tous ceux de sa
famille, Philippe IV, héritier de Charles-Quint aux cheveux rouges
252
et du blafard Philippe II, porte en lui cette langueur autrichienne
qui se manifeste par l’excessive blondeur des cheveux et des
moustaches. Il n’a rien d’espagnol, ce roi, ni le feu sombre des yeux,
ni la vivacité des mouvements, ni le goût du plaisir. Son humeur est
morose, son esprit inquiet, il règne sur des peuples qu’il ne connaît
pas et, comme ses ancêtres, il gouverne deux mondes du fond d’une
cellule de l’Escorial. S’il chasse, car il est grand chasseur, c’est moins
par plaisir véritable que pour tromper l’ennui mortel qui le dévore.
Son costume est toujours de couleur sombre, comme celui des moines
dont il fait son habituelle compagnie, et tout le luxe de ce monarque,
possesseur des plus beaux diamants du monde, se borne au collier
qui soutient la Toison d’Or.
Tel est le personnage dont Velazquez nous a laissé de si nombreux
et si puissants portraits. Peintre officiel de la cour, il a eu à
peindre son souverain en de nombreuses circonstances. On trouve
des portraits de Philippe IV dans presque toutes les galeries d’Europe
et nous l’y voyons à tous les âges. Celui que nous donnons ici est un
des plus beaux avec celui du Louvre.Quand on parle de Velazquez, il semble superflu de s’attarder aux beautés de son œuvre. Elles brillent d’un tel éclat et s’emparent si vivement de notre esprit que tout commentaire affaiblirait l’impression reçue. Ne suffit-il pas de contempler ce portrait pour sentir que l’on est en présence d’un maître? N’est-ce pas une âme qui transparaît derrière ce masque indolent et altier? Cette toile est vraiment émouvante: la physionomie est empreinte de désillusion, de tristesse, on y devine la lassitude de toutes les obligations du rôle officiel, toute la désespérance de l’homme qui a perdu sa première femme et son fils, ainsi que deux des enfants de sa seconde femme et dont l’intelligence est à peu près annihilée par la dévotion.
Il faudrait la plume d’un Michelet pour décrire ces effigies royales laissées par Velazquez; ce sont, en même temps que d’admirables 253 morceaux de peinture, des documents révélateurs, on pourrait même dire indiscrets. L’artiste se montre là un pénétrant psychologue: grâce à lui, nous connaissons à fond la psychologie du morne Philippe IV, et d’après sa physionomie, nous comprenons les causes de l’inéluctable décadence de l’Espagne.
Philippe IV, disons-le à sa louange, fut toujours un parfait protecteur de Velazquez. Il fit même mieux que le protéger, il l’aimait autant que pouvait aimer cette nature indolente et mélancolique. En 1625, après son premier portrait, il le gratifie d’un présent de trois cents ducats, d’une pension de même valeur et d’un logement à la Cour. Très souvent, il s’échappe de ses appartements et vient passer de longues heures dans l’atelier de Velazquez et s’entretient avec lui en le regardant travailler; en 1651, il le nomme maréchal du Palais, avec un superbe traitement et un logement princier dans la maison du Trésor. Cette charge oblige le peintre à organiser des fêtes pour la nouvelle reine Mariana d’Autriche, jeune princesse de dix-sept ans, que la triste cour d’Espagne ennuie et que le roi veut distraire. Enfin, en 1668, Philippe IV le fait chevalier de Santiago, malgré les résistances du Conseil de l’ordre qui ne le trouve pas d’assez bonne noblesse et refuse de l’admettre. C’est une gloire, la meilleure pour le roi, d’avoir toujours défendu son peintre contre l’hostilité de la cour; il s’opposa même plus tard, avec une louable énergie, aux entreprises de ceux qui voulurent, après sa mort, salir sa mémoire.
Le portrait de Philippe IV appartient à l’ancienne collection; il figure dans la salle XIV, réservée à la peinture espagnole.
Hauteur: 0.63.—Largeur: 0.52.—Figure grandeur nature.
PISANELLO
SAINT ANTOINE ET SAINT GEORGES
SALLE VIII.—VIEILLE ÉCOLE VÉNITIENNE
257
Saint Antoine et saint Georges
SOUS les regards d’une Vierge, dans le ciel, au milieu d’une gloire
d’or, saint Antoine et saint Georges se rencontrent, aux confins
de la solitude où vit le saint ermite. Amusante et pittoresque
rencontre que celle de ces deux personnages, si différents d’allure et de
condition. Saint Antoine s’est porté au-devant du noble chevalier
venu, sans doute, pour le visiter: il porte le costume traditionnel des
anachorètes, une longue robe de bure dont le capuchon se rabat sur sa
tête chenue. Du visage amaigri par les mortifications et envahi par une
grande barbe blanche, on n’aperçoit que deux yeux pleins de feu et de
vie. Dans sa main gauche le vénérable vieillard tient la clochette
qu’agitaient autrefois les cénobites, en temps d’orage, pour prévenir le
voyageur que, tout près de lui, se trouvaient un refuge et un abri. A
ses pieds se tient couché le cochon, habituel compagnon du saint.
Tout différent est saint Georges, patron des cavaliers. Il est jeune,
élégant et porte le riche costume des chevaliers du XVe siècle, avec
cuirasse, jambières et brassards. Sous son armure est attaché un
mantelet où se trouve brodée la croix de Jérusalem.Ce qui donne à ce guerrier bardé de fer son caractère pittoresque, c’est le chapeau à larges bords, orné d’une plume, dont le peintre l’a gratifié. Rien de moins martial que ce couvre-chef en paille surmontant un appareil aussi belliqueux. Mais la rencontre des deux saints a sans doute lieu en Italie, aux environs de Vérone, où le soleil est très ardent et le saint gentilhomme a jugé plus commode de troquer son 258 haubert contre une coiffure plus légère. Tout près de lui, on aperçoit les têtes des chevaux qui l’ont amené jusqu’ici, avec son écuyer. Couché à ses pieds, le peintre a placé le dragon grimaçant qui roule ses anneaux tout près du cochon: les deux bêtes paraissent, d’ailleurs, vivre en bon voisinage. Le tableau se complète par un paysage de forêt dont on aperçoit les arbres, pressés, serrés les uns contre les autres, presque au même plan que les personnages.
Pour juger une œuvre comme celle-là, il est absolument nécessaire de la voir avec des yeux non prévenus et, pour cela, nous devons remonter jusqu’à l’époque où vécut l’artiste. Vers la fin du XIVe siècle, l’art s’est à peine débarrassé, sous l’heureuse influence de Giotto, de la raideur hiératique; progressivement, mais lentement, le byzantinisme disparaît, les personnages s’animent, les anatomies se dessinent, la vie pénètre dans le corps humain, jusque-là momifié.
Pisanello fut l’un des principaux artisans de cette première renaissance qui prépara l’autre, la grande, et qui ouvrit la voie que devaient suivre plus tard, si glorieusement, les Raphaël et les Corrège. A titre de précurseur, Pisanello mérite une place de choix dans la lignée des grands peintres. On fait aujourd’hui bon marché des quelques incorrections et des naïvetés de cette peinture pour n’en retenir que les qualités supérieures qui s’y révèlent: un sens très poussé de la composition, un effort réel vers l’expression des physionomies, une connaissance, intuitive peut-être, mais certaine, de l’anatomie des corps.
Aussi Pisanello, dont les œuvres sont aujourd’hui très rares, jouit-il d’une estime méritée. Les musées se disputent ses tableaux et s’enorgueillissent d’en posséder.
Pisanello naquit à Vérone, en 1397. Son père était originaire de Pise, d’où le surnom donné au peintre. Pisanello, dès sa jeunesse, subit l’influence d’Altichiero da Zevio et de Jacopo d’Avanzi, aussi bien que des autres peintres et miniaturistes qui florissaient à Vérone 259 dans la deuxième moitié du XIVe siècle. En 1421, nous le trouvons à Venise, engagé par Gentile da Fabriano pour la décoration de la salle du Grand Conseil au Palais Ducal. Il ne reste rien aujourd’hui de ces fresques qui furent refaites, en 1474, par Gentile Bellini. Pisanello revient ensuite à Vérone, où il décore la plupart des églises de la ville, mais ces œuvres ont été ou dispersées ou si maltraitées par le temps qu’on n’en peut apercevoir sur les murailles que d’insignifiants fragments.
Aujourd’hui, l’art de Pisanello ne peut plus être apprécié que dans quatre peintures de chevalet, précieux joyaux dont s’enorgueillissent le musée de Bergame, le Louvre et la “National Gallery”. Le Louvre possède une délicieuse Princesse de la maison d’Este; la “National Gallery” place au rang de ses plus riches trésors deux œuvres de Pisanello: la Vision de saint Eustache et Saint Antoine et saint Georges.
Pisanello fut, en même temps que peintre, un graveur sur médailles de très grande valeur. Le British Museum possède un certain nombre de ces médailles qui sont très belles. L’artiste les signait: Opus Pisani pictoris, pour bien montrer cependant qu’il était peintre avant tout.
Saint Antoine et saint Georges fut offert à la “National Gallery”, en 1867, par lady Eastlake; il figure aujourd’hui dans la salle VIII, réservée à la peinture de la vieille école vénitienne.
Hauteur: 0.45.—Largeur: 0.29.—Figure: 0.27.
HOBBEMA
L’ALLÉE DE PEUPLIERS
SALLE XII.—ÉCOLE HOLLANDAISE
263
L’Allée de peupliers
LE paysage n’a guère été cultivé par les Italiens, trop occupés de
l’homme pour faire grande attention à ce qu’on appelle
aujourd’hui la nature. On peut dire que Michel-Ange n’y jeta
pas un seul coup d’œil, et chez les autres maître de la péninsule, le
paysage n’intervient que pour servir de fond aux figures et les faire
valoir. Sans y attacher d’importance, Titien en fit d’admirables, mais
le paysage n’était pas un art séparé, ayant sa valeur propre; c’est
vers les pâles climats du Nord, sous les tristesses d’un ciel souvent
brumeux, que le sentiment de la nature se développa dans une
rêveuse contemplation. Ruysdaël fit de magnifiques paysages entièrement
débarrassés d’histoire et de mythologie, où l’homme n’intervenait
qu’accessoirement et dans sa proportion réelle. Il peignit des forêts
sans nymphes où, sous l’obscurité des branches, cheminait quelque
paysan ou quelque vieille portant un fagot; de grands arbres
frissonnant au vent d’automne sur un ciel grisâtre encombré de nuages
gros de pluie, des buissons échevelés au sommet de quelque tertre
sablonneux, des torrents écumant contre des pierres, des digues et
des estacades de poteaux battues par l’eau jaunâtre de la mer du
Nord, avec une voile au loin s’inclinant sous la rafale.
Qui fut le père de ces admirables paysagistes? Berghem peut-être,
ou plutôt Everdingen, sinon par leçons directes, du moins par
influence; en tout cas la nature. Presque tous ces peintres, dont la vie
reste obscure malgré les recherches, ne quittèrent jamais les environs
264
de leurs villes natales; mais il n’y a pas besoin de voyager pour être
un grand artiste, il suffit d’ajouter son âme à la nature qui vous entoure.Ruysdaël est, certes, le plus grand paysagiste de Hollande, mais c’est aussi un grand artiste que Minderhout Hobbema. Après sa mort, dont on ignore la date précise, la renommée de ce peintre, qui dut être apprécié de son vivant, subit, on ne sait pourquoi, une longue éclipse. Il disparut dans l’oubli avec toute son œuvre, et ne reparut aux ventes que vers 1739. Mais on ne faisait aucun cas de ses tableaux, qu’on paye aujourd’hui des sommes folles. Ils se vendaient à bas prix et souvent, pour leur donner de la valeur, on en effaçait la signature et l’on y substituait celle de peintres plus en vogue, de Ruysdaël, dont il se rapproche, ou de Dekker. Son œuvre ainsi débaptisée se fondit peu à peu dans celle d’autres artistes et les tableaux authentiques d’Hobbema sont devenus d’une excessive rareté. A la célèbre vente Patureau, les Moulins montèrent à cent mille francs.
Hobbema n’a pas la poésie de Ruysdaël, mais il possède un profond sentiment de la nature, et il exprime d’une manière admirable la puissante vie végétale de la forêt. Ses vieux chênes au tronc rugueux, aux fortes branches, aux feuilles épaisses, sont pleins de sève, et ses sous-bois, où cheminent des bûcherons ou des paysannes, ont bien la fraîcheur humide de la Hollande.
La caractéristique du talent d’Hobbema est la vigueur, vigueur de dessin, et vigueur de coloris. Examinons sa magnifique Allée de Peupliers, reproduite ici. La manière habituelle d’Hobbema s’y révèle toute. Ces grands arbres au fût grêle, couronnés d’un minuscule bouquet de feuilles, acquièrent une force exceptionnelle à se profiler ainsi en plein ciel.
Cette allée de Middelharnis, en Hollande, est une merveille de perspective; ses ornières s’enfuient en se rétrécissant jusqu’aux premières maisons du village, dont on aperçoit la masse rouge dominée par le clocher. On pourrait dire de cette route qu’elle est 265 tout le tableau si le peintre, avec sa minutie toute hollandaise, n’avait prodigué autour de ce motif central des détails d’une étonnante virtuosité. A droite et à gauche de l’avenue, les prés s’étendent et le vert des champs prend des colorations atténuées sous la grisaille d’un ciel où roulent des nuages. Le vide que laisse, de chaque côté, la haute stature des peupliers, est heureusement rempli, à gauche par un sombre massif d’arbustes, à droite par un corps de ferme qui se prolonge jusqu’au premier plan par une rangée d’arbres.
Ça et là, de minuscules personnages sont représentés, comparses indifférents qui disparaissent dans la majestueuse grandeur du paysage. D’ailleurs Hobbema, comme Claude Lorrain, ignorait l’art de dessiner les figures; il en laissait le soin à des collaborateurs spéciaux, qui étaient eux-mêmes des maîtres. Ruysdaël qui était son ami, lui rendait volontiers le service de placer au bon endroit les petits bonshommes dont s’animent ses paysages; Adrien Van de Velde y travailla aussi souvent.
Malgré cela, Hobbema fut peu prisé de son vivant et il vendait si mal ses tableaux qu’il dut accepter pour vivre un modeste et absorbant emploi dans les douanes, qui lui laissait peu de loisirs pour peindre, ce qui explique la rareté de ses œuvres.
L’Allée de Peupliers, qui est le chef-d’œuvre d’Hobbema, date vraisemblablement de la fin de sa vie. Elle est entrée à la “National Gallery” en 1871, avec la collection Peel, en même temps que cinq autres toiles du même peintre et figure avec elles dans la salle XII, réservée aux toiles de cette collection.
Hauteur: 1.02.—Largeur: 1.40.
HANS HOLBEIN
LES AMBASSADEURS
SALLE XV.—ÉCOLE ALLEMANDE
269
Les Ambassadeurs
DANS une remarquable conférence sur le portrait, le maître
Albert Besnard s’exprime ainsi:
«Il est incontestable que ce que l’homme aime le mieux
dans la nature, c’est encore lui-même; voilà pourquoi le portrait est
l’œuvre dont l’intérêt résiste le plus au temps et aux esthétiques
dévastatrices... Le portrait est le point de repère de l’histoire, qu’il
renseigne, par la physionomie, le costume et l’attitude. Les héros
disparus sans laisser d’effigies ne nous intéressent que comme des
abstractions. Nous admirons leurs actions comme de beaux nuages
dans le ciel sans savoir d’où ils viennent. De quels frissons, au
contraire, ne sommes-nous pas saisis devant les faces pâles aux petits
yeux bridés d’un Charles IX ou d’un Henri III! Leur costume que
nulle description ne rétablirait symbolise l’époque et aide puissamment
à la classer dans le recul des temps. Le chapeau au panache blanc
d’Henri IV, c’est la victoire; de Louis XIII les cheveux plats et les
culottes bouffantes racontent toute une époque de luttes philosophiques,
mystiques et littéraires, que vient dramatiser la cape rouge de
Richelieu...»En dépit de lui-même, s’il peint le milieu dans lequel il vit, le peintre fait œuvre d’historien, il documente les générations futures sur un temps qu’elles n’ont pas connu. En ce sens, Holbein aura été l’évocateur d’une des plus curieuses époques de l’Histoire. Par ses portraits il fait revivre tous les personnages qui jouèrent un rôle dans la première 270 moitié du XVIe siècle. Mêlé au mouvement intellectuel qui secouait le vieux monde, le peintre connut à Bâle les principaux protagonistes des idées nouvelles, Erasme et Amerbach; c’est tout le scepticisme ironique des humanistes, précurseurs de la Réforme, qu’on lit sur le mince et intelligent visage d’Erasme. Plus tard, admis à la cour d’Angleterre, il peindra le lourd et brutal Henri VIII et, sur ses traits, il inscrira ineffaçablement la cruauté, la luxure, la violence de ce tueur de femmes. En même temps que le bourreau il a peint les victimes, Anne Boleyn, Jane Seymour, et d’autres.
Il est historien encore, d’une moins dramatique histoire, dans le tableau que nous reproduisons ici. Les deux personnages accoudés à cette table sont des ambassadeurs: l’un, celui de gauche, richement habillé d’un manteau bordé de fourrures, est Jean de Dinteville, seigneur de Polésy, ambassadeur de France: à son cou est attaché le collier de l’ordre royal de Saint-Michel; l’autre est George de Selve, évêque de Lavaur, portant un costume noir ecclésiastique avec le bonnet carré. Sur la table qui les sépare sont disséminés des objets divers, instruments scientifiques, et l’on y aperçoit même une viole. Entre les deux personnages, à terre, se remarque un objet bizarre dans lequel on a voulu voir la déformation d’un crâne humain.
Ce qui est admirable dans cette peinture, c’est la beauté des têtes, leur vérité d’expression, la puissance de vie qui les anime et qui fait de ce peintre l’un des plus étonnants portraitistes connus.
Le magnifique tableau des Ambassadeurs, un des chefs-d’œuvre d’Holbein, fut peint en 1533. Entre 1790 et 1795, il passa par vente aux mains du comte de Radnor et resta dans la famille jusqu’en 1891. A cette époque, la “National Gallery” l’acheta à un prix très élevé et le plaça dans la salle XV réservée à la peinture allemande.
Hauteur: 2.08.—Largeur: 2.08.—Figures grandeur nature.
TABLE DES MATIÈRES
| Pages. | |
| Avertissement | 1 |
| Arnolfini et sa femme, par J. Van Eyck | 5 |
| Portrait de Jeune homme, par Botticelli | 11 |
| Intérieur hollandais, par P. de Hooch | 17 |
| Vénus et Cupidon, par Velazquez | 23 |
| Saint-Georges terrassant le Dragon, par Le Tintoret | 29 |
| Les Grâces couronnant l’Hymen, par Reynolds | 35 |
| Christine de Milan, par Holbein | 41 |
| La Vierge aux Rochers, par L. de Vinci | 47 |
| Mrs. Siddons, par Gainsborough | 53 |
| Les Enfants de Charles Ier, par A. Van Dyck | 59 |
| Élisa Bonaparte, par Louis David | 65 |
| Flatford Mill, par J. Constable | 72 |
| Le Doge Lorédan, par Giovanni Bellini | 77 |
| Le Jugement de Pâris, par Rubens | 83 |
| Une Dame et son Enfant, par Romney | 89 |
| Bacchanale, par N. Poussin | 95 |
| Le Retour d’Ulysse, par Pinturicchio | 101 |
| Portrait de Dame âgée, par Rembrandt | 107 |
| Mercure instruisant Cupidon, par Le Corrège | 113 |
| Ulysse s’éloignant de Polyphème, par Turner | 119 |
| Cornélius van der Geest, par A. Van Dyck | 125 |
| Jeune Buveur, par Murillo | 131 |
| Groupe de Famille, par Franz Hals | 137 |
| La Fille aux crevettes, par W. Hogarth | 143 |
| La Leçon de musique, par G. Metsu | 149 |
| Le Marché aux chevaux, par Rosa Bonheur | 155 |
| Vieille Femme pelant une poire, par David Téniers | 161 |
| La Vierge et l’Enfant, par Raphaël | 167 |
| Lady Cockburn et ses enfants, par Reynolds | 173 |
| Bacchus et Ariane, par Le Titien | 179 |
| La Femme à l’Épinette, par Jan Vermeer | 185 |
| Port de Mer avec Personnages, par Cl. Lorrain | 191 |
| Portrait de Jeune fille, par Ghirlandajo | 197 |
| La Servante paresseuse, par N. Maës | 203 |
| Mrs. Mark Currie, par Romney | 209 |
| Nativité, par Piero Della Francesca | 215 |
| Portrait d’homme, par Terburg | 221 |
| L’Origine de la voie lactée, par Le Tintoret | 227 |
| Un Chanoine et ses saints patrons, par Gérard David | 233 |
| L’Annonciation, par Crivelli | 239 |
| Le Mariage à la mode, par Hogarth | 245 |
| Philippe IV, par Velazquez | 251 |
| Saint Antoine et saint Georges, par Pisanello | 257 |
| L’Allée des peupliers, par Hobbema | 263 |
| Les Ambassadeurs, par Holbein | 269 |
INDEX ALPHABÉTIQUE
| Pages. | ||
| AVERTISSEMENT | 1 | |
| BELLINI (Giovanni) | Le Doge Lorédan | 77 |
| BOTTICELLI | Portrait de Jeune homme | 11 |
| CONSTABLE (J.) | Flatford Mill | 72 |
| CRIVELLI | L’Annonciation | 239 |
| DAVID (Gérard) | Un Chanoine et ses saints patrons | 233 |
| DAVID (Louis) | Élisa Bonaparte | 65 |
| FRANCESCA (P. della) | Nativité | 215 |
| FRANZ HALS | Groupe de famille | 137 |
| GAINSBOROUGH | Mrs Siddons | 53 |
| GHIRLANDAJO | Portrait de Jeune fille | 197 |
| HOBBEMA | L’Allée des Peupliers | 263 |
| HOGARTH (W.) | La Fille aux crevettes | 143 |
| —— | Le Mariage à la mode | 245 |
| HOLBEIN | Christine de Milan | 41 |
| —— | Les Ambassadeurs | 269 |
| HOOCH (P. de) | Intérieur hollandais | 17 |
| LE CORRÈGE | Mercure instruisant Cupidon | 113 |
| LE TINTORET | St-Georges terrassant le Dragon | 29 |
| —— | L’Origine de la Voie lactée | 227 |
| LE TITIEN | Bacchus et Ariane | 179 |
| LORRAIN (Cl.) | Port de mer avec personnages | 191 |
| MAËS (N.) | La Servante paresseuse | 200 |
| METSU (G.) | La Leçon de musique | 149 |
| MURILLO | Jeune Buveur | 131 |
| PINTURICCHIO | Le Retour d’Ulysse | 101 |
| PISANELLO | Saint Antoine et saint Georges | 257 |
| POUSSIN (N.) | Bacchanale | 95 |
| RAPHAËL | La Vierge et l’Enfant | 167 |
| REMBRANDT | Portrait de dame âgée | 107 |
| REYNOLDS | Les Grâces couronnant l’Hymen | 35 |
| —— | Lady Cockburn et ses enfants | 173 |
| ROMNEY | Une Dame et son Enfant | 89 |
| —— | Mrs Mark Currie | 209 |
| ROSA BONHEUR | Le Marché aux chevaux | 155 |
| RUBENS | Le Jugement de Pâris | 83 |
| TÉNIERS (David) | Vieille femme pelant une poire | 161 |
| TERBURG | Portrait d’homme | 221 |
| TURNER | Ulysse s’éloignant de Polyphème | 119 |
| VAN DYCK | Les Enfants de Charles Ier | 59 |
| —— | Cornélius Van der Geest | 125 |
| VAN EYCK | Arnolfini et sa femme | 5 |
| VELAZQUEZ | Vénus et Cupidon | 23 |
| —— | Philippe IV | 251 |
| VERMEER (Jan) | La Femme à l’Épinette | 185 |
| VINCI (L. de) | La Vierge aux rochers | 47 |

Au lecteur.
Ce livre électronique reproduit intégralement le texte original,
et l’orthographe d’origine a été conservée, y compris dans les
noms propres. Seules quelques erreurs typographiques évidentes
ont été corrigées. La liste de ces corrections se trouve ci-après.La ponctuation a également fait l’objet de quelques corrections mineures.
Corrections.
- Page 17: «arges» remplacé par «larges» (Par les larges fenêtres).
- Page 42: «tistique» remplacé par «artistique» (en dehors même de leur valeur artistique).
- Page 90: «déclanchement» remplacé par «déclenchement» (le déclenchement subit du succès).
- Page 103: «fortuue» remplacé par «fortune» (par la plus invraisemblable fortune).
- Page 133: «Figures» remplacé par «Figure» (Figure grandeur nature.).
- Page 139: «boulange» remplacé par «boulanger» (pour payer son boulanger).
- Page 149: «blaiseautant» remplacé par «blaireautant» (en polissant et en blaireautant).
- Page 156: «izards» remplacé par «isards» (des mouflons, des isards, des singes).
- Page 156: «l'histore» remplacé par «l'histoire» (dont l'histoire mérite d'être relatée).
- Page 156: «triomplal» remplacé par «triomphal» (Malgré son succès triomphal).
- Page 223: «Netzcher» remplacé par «Netscher» (Terburg fut le maître de Gaspard Netscher).
- Page 251: «inergique» remplacé par «énergique» (derrière le masque énergique).
- Page 264: «Minder Hont» remplacé par «Minderhout» (un grand artiste que Minderhout Hobbema); mais il conviendrait de lire: «Meindert Hobbema».
- Page 264: «Middelhamis» remplacé par «Middelharnis» (Cette allée de Middelharnis, en Hollande).
- Page 270: «déformaation» remplacé par «déformation» (la déformation d’un crâne humain).
- Page 270: «Raduor» remplacé par «Radnor» (aux mains du comte de Radnor).
- Page 270: «Figure» remplacé par «Figures» (Figures grandeur nature.).
- Index alphabétique: «BOTICELLI» remplacé par «BOTTICELLI» (BOTTICELLI Portrait de Jeune homme).
http://www.gutenberg.org
Inscription à :
Commentaires (Atom)