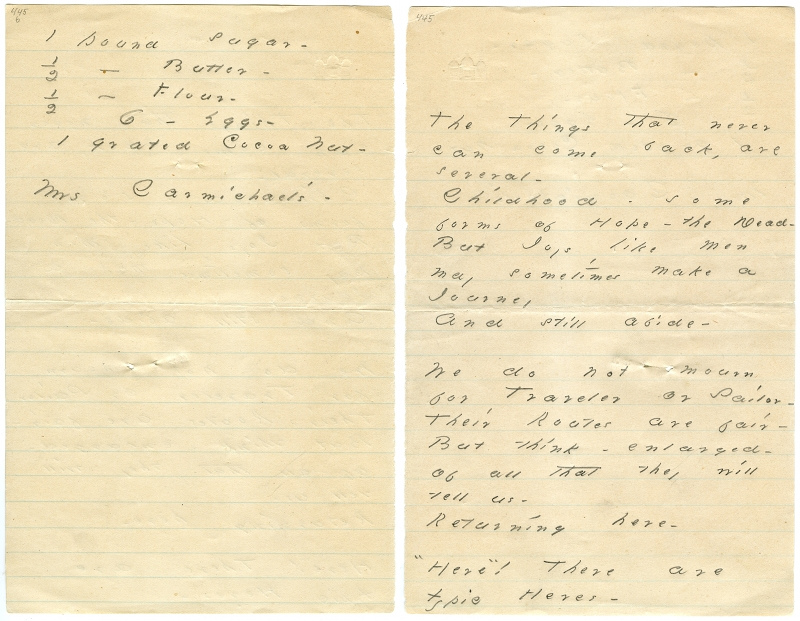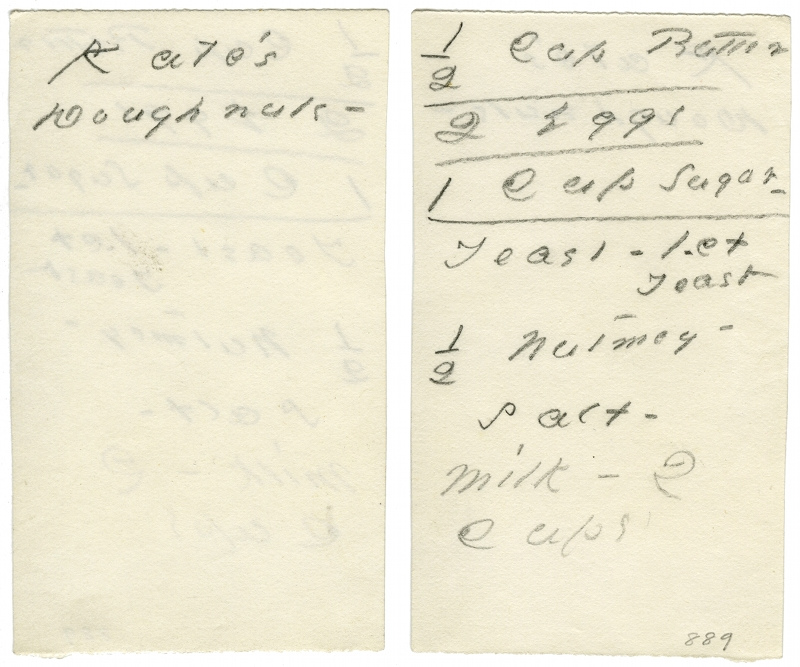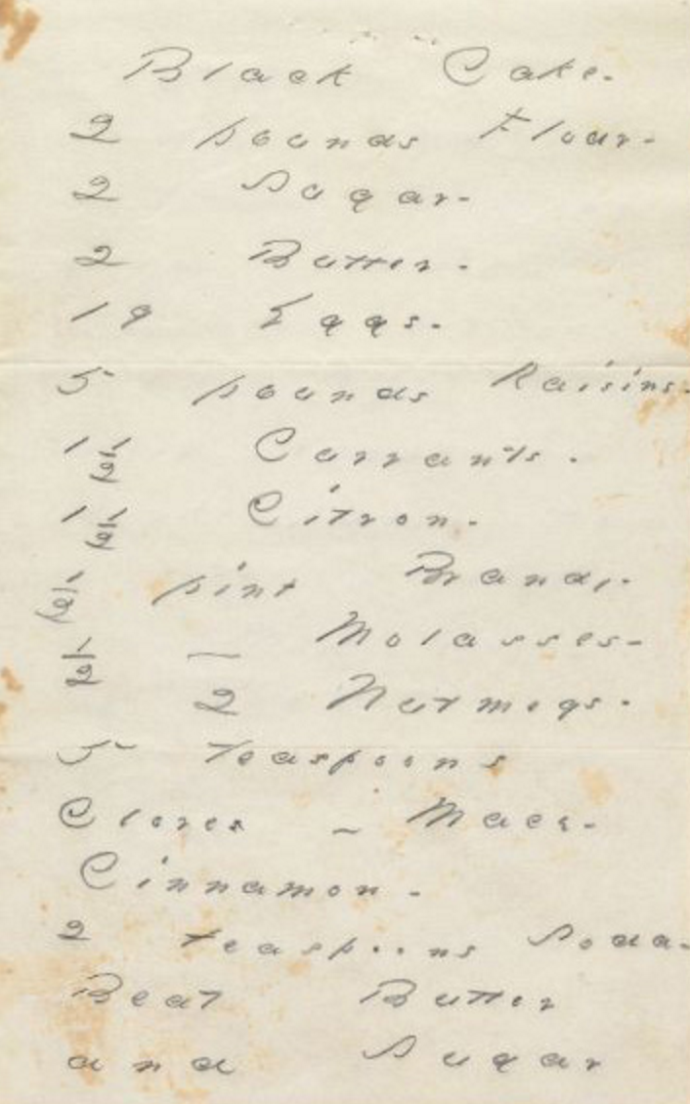Walter Benjamin
Notes
sur les “Tableaux parisiens” de Baudelaire (1939)
L’étude d’une oeuvre lyrique fréquemment se propose pour but de faire entrer le lecteur dans certains états d’âme poétiques, de faire participer la postérité aux transports qu’aurait connus le poète. Il semble, toutefois admissible de concevoir pour une telle étude un but quelque peu différent. Pour le définir de façon positive, on pourrait avoir recours à une image. Mettons qu’une science attachée au devenir social soit en droit de considérer certaine oeuvre poétique – monde suffisant à soi-même, en apparence – comme une sorte de clé, confectionnée sans la moindre idée de la serrure où un jour elle pourrait être introduite. Cette oeuvre se verrait donc revêtue d’une signification toute nouvelle à partir de l’époque où un lecteur, mieux, une génération de lecteurs nouveaux, s’apercevrait de cette vertu-clé. Pour eux, les beautés essentielles de cette oeuvre iront s’intégrer dans une valeur suprême. Elle leur fera saisir, à travers de son texte, certains aspects d’une réalité qui sera non tant celle du poète défunt que la leur propre. Certes, ces lecteurs ne se priveront pas de cette utilité suprême dont, pour eux, l’oeuvre en question fera preuve. Ils ne se priveront donc pas non plus des démarches de l’analyse qui vont les familiariser avec elle.
Le cycle des Tableaux parisiens de Baudelaire est le seul qui ne figure dans Les Fleurs du Mal qu’à partir de la deuxième édition. Il est peut-être permis d’y chercher ce qui en Baudelaire a mûri le plus lentement, ce qui a, pour éclore, demandé le plus d’expériences substantielles. Mieux qu’aucun autre texte, ce cycle de poésies nous fait sentir ce que pouvait être la répercussion des foyers de vie moderne, des grandes villes, sur une sensibilité des plus délicates et des plus sévèrement formées. Telle était la sensibilité de Baudelaire. Elle lui a valu une expérience qui porte la marque de l’originalité essentielle. C’est le privilège de celui qui, le premier, a mis le pied sur une terre inexplorée et qui en a tiré pour ses notations poétiques, une richesse non seulement singulière, mais aussi de portée surprenante. Cette portée n’a point été prévisible dès le début. À preuve certains traits non moins significatifs que beaux dont on ne voit guère qu’ils auraient frappé le lecteur du XIXe siècle. Tant il est vrai que toute expérience originale garde comme enfermés dans son sein certains germes qui sont promis à un développement ultérieur. Dans ces notes, il s’agira donc bien moins de faire revivre le poète dans son milieu que de rendre visible, par l’ensemble de quelques poèmes, l’actualité extraordinaire de ce Paris dont Baudelaire fit, le premier, l’expérience poétique.
Pour approfondir le fond du problème, on pourra partir d’un fait paradoxal. Paul Desjardins en fit la constatation subtile. « Baudelaire, dit-il, est plus occupé d’enfoncer l’image dans le souvenir que de l’orner et de la peindre. » En effet, Baudelaire, dont l’oeuvre est si profondément imprégnée de la grande ville, ne la peint guère. Tant dans Les Fleurs du mal que dans ces Poèmes en prose qui, pourtant, dans leur titre originaire Le Spleen de Paris et tant de passages évoquent la ville, on chercherait vainement le moindre pendant de descriptions de Paris comme elles foisonnent dans Victor Hugo. L’on se souviendra du rôle que la description minutieuse de la grande ville joue chez certains poètes plus récents, surtout d’inspiration socialiste, et on remarquera que s’en être privé constitue un fondement de l’originalité baudelairienne. Ces descriptions de la grande ville s’accordent volontiers avec une certaine foi avec les prodiges de la civilisation, avec un idéalisme plus ou moins verbeux. La poésie de Verhaeren abonde de traits de ce genre :
Et qu’importent les maux et les heures démentes / Et les cuves de vice où la cité fermente / Si quelque jour, du fond des brouillards et des voiles / Surgit un nouveau Christ, en lumière sculpté / Qui soulève vers lui l’humanité / Et la baptise au feu de nouvelles étoiles.
Rien de tel chez Baudelaire. Tout en subissant le prestige de la grande ville, « où tout, même l’horreur, tourne aux enchantements », il garde je ne sais quoi de désenchanté. Paris, pour lui, c’est « cette grande plaine où l’autan froid se joue », c’est « les maisons dont la brume allongeait la hauteur », simulant « les deux quais d’une rivière accrue », c’est l’amoncellement de « palais neufs, échafaudages, blocs, vieux faubourgs », c’est surtout la ville en voie de disparition :
Le vieux Paris n’est plus (la forme d’une ville / Change plus vite, hélas ! que le coeur d’un mortel).
La forme de la ville changeait, en effet, et cela avec une vitesse prodigieuse, du temps de Baudelaire. Il ne faut pas oublier que l’oeuvre de Haussmann, ses larges tracés qui ne s’embarrassaient d’aucune considération historique, étaient bien faits pour constituer un terrible memento mori à l’intention et au coeur de Paris même. Cette oeuvre destructrice, toute pacifique qu’elle fût, illustrait pour la première fois et sur le corps de la ville même ce que pouvait l’action d’un seul homme pour anéantir ce qui, par des générations, avait été érigé. Un sentiment prémonitoire de l’insigne précarité des grands centres urbains n’est nullement absent des Tableaux parisiens. Le frisson nouveau dont Baudelaire, d’après Hugo, aurait doté la poésie, est un frisson d’appréhension.
Le Paris baudelairien est pour ainsi dire une ville minée, ville défaillante, ville frêle. Rien de beau comme le poème Le Soleil qui le montre traversé de rayons comme un vieux tissu précieux et râpé. Le vieillard, image sur laquelle se termine ce chant de la décrépitude qu’est le Crépuscule du matin – le vieillard qui jour après jour avec résignation se remet à la besogne est l’allégorie de la ville :
Et le sombre Paris, en se frottant les yeux, / Empoignait ses outils, vieillard laborieux.
Pour Paris, même les êtres d’élection sont décrépits. Dans la foule immense des citadins, les vieilles femmes sont les seules que transfigurent leur faiblesse et leur dévouement.
Seul un lecteur qui aurait saisi ce que signifie l’effacement de la ville dans la poésie urbaine de Baudelaire, pourra entrevoir la significations de certains vers qui vont à l’encontre de ce procédé. Chez Baudelaire, la discrétion dans l’évocation de la ville n’exclut pas le trait chargé, et même l’exagération. Tel le début du sonnet A une passante :
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Ce n’était pas seulement un accent absolument nouveau dans la poésie lyrique (accent dont la vigueur est doublée du fait qu’il est mis au début du poème), mais encore cette phrase, prise comme un simple énoncé, parait d’une hardiesse provocante. Certes, cette constatation, pour nous, habitués aux bruits ininterrompus des klaxons dans nos rues, n’a-t-elle rien d’étrange. Mais quelle dut être son étrangeté pour les contemporains du poète, et combien est étrange cette conception du Paris de dix-huit cent cinquante d’où elle découlait. Dans ce poème, la singularité de la description va de pair avec la maîtrise poétique. On est en droit d’y voir une évocation puissante de la foule. D’autre part, il n’y a pas, dans cette poésie, un seul passage qui y fasse allusion, à moins, toutefois, qu’on ne veuille la trouver dans son énigmatique phrase initiale. Tant il est vrai que Baudelaire ne peint pas.
On peut, pour les Tableaux parisiens, parler d’une présence secrète de la foule. Danse macabre, Le Crépuscule du soir, Les Petites Vieilles, en sont autant d’évocations. La foule innombrable de ses passants constitue le voile mouvant à travers lequel le promeneur parisien voit la ville. Aussi, les notations sur la foule, inspiratrice souveraine, source d’ivresse pour le passant, ne manquent-elles pas dans les Journaux intimes. Mieux que de se référer à ces passages vaudrait peut-être de relire l’endroit magistral où Poe évoque la foule. On y retrouvera la valeur divinatoire de l’exagération dans ces premières tentatives de rendre la physionomie des grandes villes. « Le plus grand nombre de ceux qui passaient avaient un maintien convaincu et propre aux affaires, et ne semblaient occupés qu’à se frayer un chemin à travers la foule. Ils fronçaient les sourcils et roulaient des yeux vivement ; quand ils étaient bousculés par quelques passants voisins, ils ne montraient
aucun symptôme d’impatience, mais rajustaient leurs vêtements et se dépêchaient. D’autres, une classe fort nombreuse encore, étaient inquiets dans leurs mouvements, avaient le sang à la figure, se parlaient à eux-mêmes et gesticulaient, comme s’ils se sentaient seuls par le fait même de la multitude innombrable qui les entourait. Quand ils étaient arrêtés dans leur marche, ces gens-là cessaient tout à coup de marmotter, mais redoublaient leurs gesticulations, et attendaient, avec un sourire distrait et exagéré, le passage des personnes qui leur faisaient obstacle. S’ils étaient poussés, ils saluaient abondamment les pousseurs, et paraissaient accablés de confusion. »
On pourrait difficilement considérer ce passage comme une description naturaliste. La charge est bien trop brutale. Mais ce passant dans une foule exposé à être bouscule par les gens qui se hâtent en tous sens, est une préfiguration du citoyens de nos jours quotidiennement bousculé par les nouvelles des journaux et de la T.S.F et exposé à une suite de chocs qui atteignent parfois les assises de son existence même. Cette aperception divinatoire qui se trouve dans la description de Poe, Baudelaire l’a faite sienne. Il est allé plus loin : il a bien senti la menace que les foules de la grande ville constituent pour l’individu et pour son aparté. Une pièce singulière et déconcertante, Perte d’auréole, révèle de ses angoisses :
« Vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l’heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n’ai pas eu le courage de la ramasser. J’ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os. »
Quelques remarques des critiques les plus avisés pourront s’insérer ici. Gide, et après lui, Jacques Rivière, ont insisté sur certains chocs intimes, certains décalages, que subit le vers baudelairien dans sa structure. « Etrange train de paroles », dit Rivière. « Tantôt comme une fatigue dans la voix un mot plein de faiblesse :
Et qui sait si les fleurs nouvelles que je rêve / Trouveront dans ce sol lavé comme une grève / Le mystique aliment qui ferait leur vigueur ?
Ou bien
Cybèle, qui les aime, augmente ses verdures.
On pourrait ajouter le célèbre début de poème :
La servante au grand coeur dont vous étiez jalouse.
S’il paraissait hasardeux de rapprocher ces défaillances métriques de l’expérience du promeneur solitaire dans la foule, on pourrait se référer au poète lui-même. On lit, en effet, dans la dédicace des Petits poèmes en prose : « Quel est celui de nous qui n’a pas, dans ses jours d’ambition, rêvé le miracle d’une prose poétique, musicale sans rythme et sans rime, assez souple et assez heurtée pour s’adapter aux mouvements lyriques de l’âme, aux ondulations de la rêverie, aux soubresauts de la conscience ? C’est surtout de la fréquentation des villes énormes, c’est du croisement de leurs innombrables rapports que nait cet idéal obsédant. »
Nous venons de parler d’un promeneur solitaire. Solitaire, Baudelaire l’a été dans l’acception la plus atroce du mot. « Sentiment de solitude, dès mon enfance. Malgré la famille, et au milieu de mes camarades, surtout – sentiment de destinée éternellement solitaire. » Ce sentiment porte, au-delà de sa signification individuelle, une empreinte sociale. Une parenthèse la dégagera brièvement.
Dans la société féodale, jouir de ses loisirs – être exempt de travail – constituait un privilège. Privilège, non seulement de fait mais de droit. Les choses n’en sont plus là dans la société bourgeoise. La société féodale pouvait d’autant plus aisément reconnaitre le privilège du loisir à certains d’entre ses membres qu’elle disposait des moyens d’anoblir cette attitude, voire de la transfigurer. La vie de la cour et la vie contemplative faisaient comme deux grands moules dans lesquels les loisirs du grand seigneur, du prélat et du guerrier pouvaient être coulés. Ces attitudes, celle de la représentation aussi bien que celle de la dévotion, convenaient au poète de cette société, et son oeuvre les justifiait. En écrivant, le poète garde un contact, au moins indirect, avec la religion ou avec la cour, ou bien avec les deux. (Voltaire, le premier littérateur en vue, qui rompt délibérement avec l’Eglise, se ménage une retraite auprès du roi de Prusse.)
Dans la société féodale, les loisirs du poète sont un privilège reconnu. Par contre, une fois la bourgeoisie au pouvoir, le poète se trouve être le désoeuvré, « l’oisif » par excellence. Cette situation n’a pas été sans provoquer un désarroi notable. Nombreuses furent les tentatives d’y échapper. Les talents qui se sentaient le plus à l’aide dans leur vocation de poète prirent leur plus grand essor : Lamartine, Victor Hugo se trouvaient comme investis d’une dignité toute nouvelle. C’étaient en quelque sorte les prêtres laïques de la bourgeoisie. D’autres – Béranger, Pierre Dupont – se contentaient de solliciter le concours de la mélodie facile pour assurer leur popularité. D’autres encore, dont Barbier, firent leur la cause du quatrième état. D’autres enfin, Théophile Gautier, Leconte de Lisle, se réfugièrent dans l’art pour l’art.
Baudelaire n’a su s’engager dans aucune de ces voies. C’est ce qui a été si bien dit par Valéry dans cette fameuse Situation de Baudelaire où on lit : « Le problème de Baudelaire devait se poser ainsi : être un grand poète, mais n’être ni Lamartine, ni Hugo, ni Musset. Je ne dis pas que ce propos fut conscient, mais il était nécessairement en Baudelaire – et même essentiellement Baudelaire. Il était sa raison d’ Etat. » On peut dire que Baudelaire, en face de ce problème, prit le parti de le porter devant le public. Son existence oisive, dépourvue d’identité sociale, il prit la résolution de l’afficher ; il se fit une enseigne de son isolement social : il devint flâneur. Ici comme pour toutes les attitudes essentielles de Baudelaire, il parait impossible et vain de départir ce qu’elles comportaient de gratuit et de nécessaire, de choisi et de subi, d’artifice et de naturel. En l’espèce, cet enchevêtrement tient à ce que Baudelaire éleva l’oisiveté au rang d’une méthode de travail, de sa méthode à lui. On sait qu’en bien des périodes de sa vie il ne connut pour ainsi dire pas de table de travail. C’est en flânant qu’il fit, et surtout qu’il remania interminablement ses vers.
Le long du vieux faubourg, où pendent aux masures / Les personnes, abri des secrètes luxures, /Quand le soleil cruel frappe à traits redoublés / Sur la ville et les champs, sur les toits et les blés, / Je vais m’exercer seul à ma fantasque escrime, / Flairant dans tous les coins les hasards de la rime, / Trébuchant sur les mots comme sur les pavés, / Heurtant parfois des vers depuis longtemps rêvés.
C’est le flâneur Baudelaire qui fit l’expérience des foules dont nous avons parlé. Nous y revenons pour mettre en valeur un autre de ces coups de sonde qu’il portait dans les profondeurs de la vie collective. Une des premières réactions que fit naitre la formation des foules au sein de la grande ville, fut la vogue de ce qu’on nommait les « physiologies ». C’étaient là de petits livrets à quelques sous dont l’auteur s’amusait à classer des types d’après leur physionomie et à saisir au vol aussi bien le caractère que les occupations et le rang social d’un passant quelconque. L’oeuvre de Balzac donne mille échantillons de cette manie. Voilà, dira-t-on, une perspicacité bien illusoire. Illusoire, en effet. Mais il y a un cauchemar qui lui correspond et celui-ci, de son côté, apparait comme beaucoup plus substantiel. Ce cauchemar serait de voir les traits distinctifs qui au premier abord semblent garantir l’unicité, l’individualité stricte d’un personnage révéler à leur tour les éléments constitutifs d’un type nouveau qui établirait, lui, une subdivision nouvelle. Ainsi se manifesterait, au coeur de la flânerie, une fantasmagorie angoissante. Baudelaire l’a développée vigoureusement dans Les Sept Vieillards
Tout à coup, un vieillard dont les guenilles jaunes / Imitaient la couleur de ce ciel pluvieux, / Et dont l’aspect aurait fait pleuvoir les aumônes, / Sans la méchanceté qui luisait dans ses yeux, / M’apparut
Son pareil le suivait : barbe, oeil, dos, bâton, loques, / Nul trait ne distinguait, du même enfer venu, / Ce jumeau centenaire, et ces spectres baroques, / Marchaient du même pas vers un but inconnu. / A quel complot infâme étais-je donc en butte / Ou quel méchant hasard ainsi m’humiliait ? / Car je comptai sept fois, de minute en minute, / Ce sinistre vieillard qui se multipliait !
L’individu qui est ainsi présenté dans sa multiplication comme toujours identique, suggère l’angoisse qu’éprouve le citadin à ne plus pouvoir, malgré la mise en oeuvre des singularités les plus excentriques, rompre le cercle magique du type. Cercle magique qui est déjà suggéré par Poe dans sa description de la foule. Les êtres dont il la voit composée, apparaissent comme assujettis à des automatismes. C’est, du reste, la conscience de cet automatisme strictement réglé, de ce caractère rigoureusement typique qui, lentement acquise, solidement établie, va leur permettre, au bout d’un siècle de se targuer d’une inhumanité et d’une cruauté inédites. Il paraît que, par échappées, Baudelaire ait saisi les traits de cette inhumanité à venir. On lit dans Fusées :
« Le monde va finir… Je demande à tout homme qui pense de me montrer ce qui subsiste de la vie… Ce n’est pas particulièrement par des institutions politiques que se manifestera la ruine universelle… Ce sera par l’avilissement des cœurs. Ai-je besoin de dire que le peu qui restera de politique se débattra péniblement dans les étreintes de l’animalité générale, et que les gouvernants seront forcés, pour se maintenir et pour créer un fantôme d’ordre, de recourir à des moyens qui feraient frissonner notre humanité actuelle, pourtant si endurcie ? … Ces temps sont peut-être bien proches ; qui sait même s’ils ne sont pas venus, et si l’épaississement de notre nature n’est pas le seul obstacle qui nous empêche d’apprécier le milieu dans lequel nous respirons ? »
Nous ne sommes déjà pas si mal placés pour convenir de la justesse de ces phrases. Il y a bien des chances qu’elles gagneront en sinistre. Peut-être la condition de la clairvoyance dont elles font preuve, était beaucoup moins un don quelconque d’observateur que l’irrémédiable détresse du solitaire au sein des foules. Est-il trop audacieux de prétendre que ce sont ces mêmes foules qui, de nos jours, sont pétries par les mains des dictateurs ? Quant à la faculté d’entrevoir dans ces foules asservies des noyaux de résistance – noyaux que formèrent les masses révolutionnaires de quarante-huit et les communards – elle n’était pas dévolue à Baudelaire. Le désespoir fut la rançon de cette sensibilité qui, la première abordant la grande ville, la première en fut saisie d’un frisson que nous, en face de menaces multiples, par trop précises, ne savons même plus sentir. »
Texte
de la conférence prononcée par Walter Benjamin lors de son séjour au
“Foyer d’Etudes et de repos” de l’Abbaye de Pontigny en mai 1939.
Prononcée en français et sténographiée, cette conférence, dont il
déclara qu’elle était un “abrégé” de ses travaux sur Baudelaire est
restée inédite de son vivant.
Traduction:
Nathalie Raoux